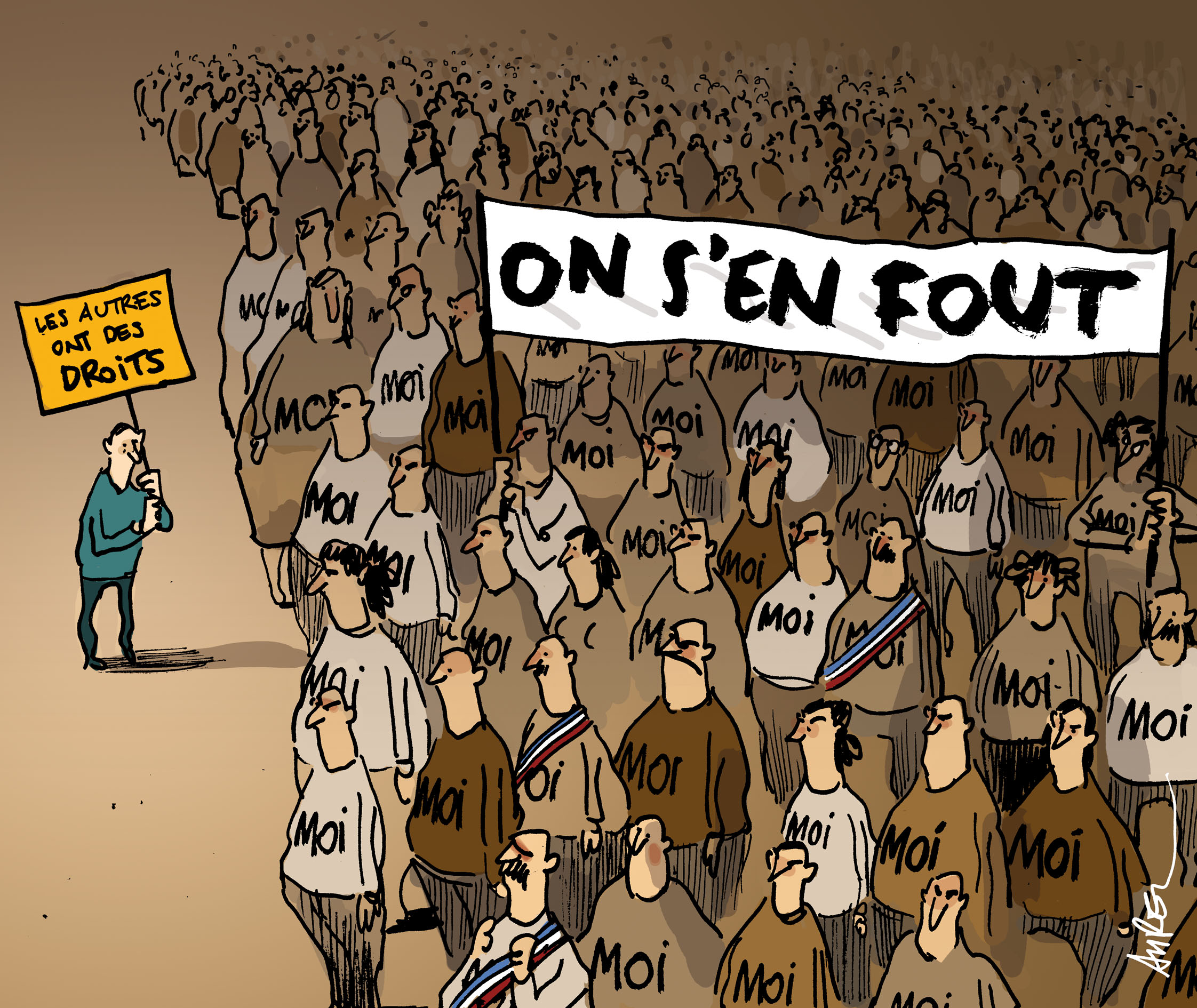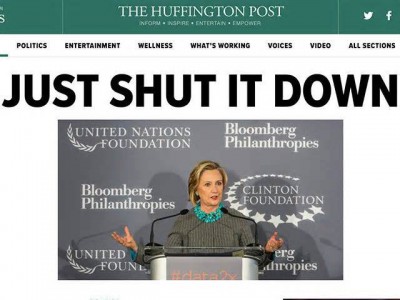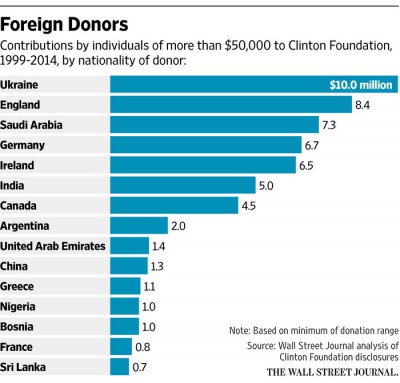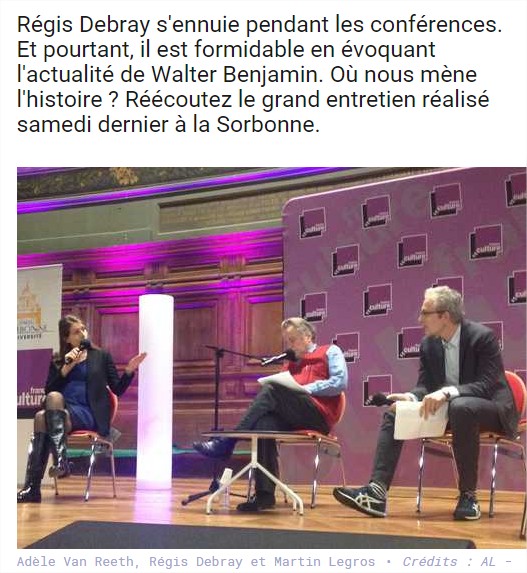Daniel Broudy : Vous êtes en train de boucler le travail sur votre dernier projet dont le titre, semble-t-il, peut également déclencher des sentiments de crainte considérables. Son titre, The Coming War (La guerre qui à venir), est assez déprimant. Pouvez-vous expliquer ce qui provoque chez vous ce regard particulier sur les événements du monde, tels que vous les voyez se dérouler en Asie de l’Est ?
John Pilger : Le film reprend le thème d’une grande partie de mon travail. Il vise à expliquer comment une grande puissance peut s’imposer tout en avançant à visage couvert et en occultant le danger qu’elle représente. Ce film traite des États-Unis – qui doutent désormais de leur pouvoir de domination – qui sont en train de rallumer la guerre froide. La guerre froide a été lancée à nouveau sur deux fronts : contre la Russie et contre la Chine. Je me concentre sur la Chine dans un film sur la région Asie-Pacifique. Il est situé dans les îles Marshall où les États-Unis ont fait exploser 67 bombes atomiques, des armes nucléaires, entre 1946 et 1958, laissant cette partie du monde gravement endommagée en termes humains et environnementaux. Et cet assaut sur les îles Marshall se poursuit. Sur la plus grande île, Kwajalein, il y a une base importante et secrète des États-Unis appelée Ronald Reagan Test Facility, qui fut créée dans les années 1960 pour – comme les archives que nous utilisons le démontrent sans ambiguïté – « lutter contre la menace de la Chine. »
Le film se déroule aussi à Okinawa, comme vous le savez. Une partie du thème est de montrer la résistance au pouvoir et à la guerre par un peuple qui vit le long d’une rangée de clôtures des bases américaines dans leur pays d’origine. Le titre du film est une sorte de mise en garde, car il est conçu comme un avertissement. Les documentaires comme celui-ci ont la responsabilité d’alerter les gens, et si nécessaire les prévenir, et de montrer la résistance aux plans rapaces. Le film montre que la résistance à Okinawa est remarquable, efficace et peu connue dans le monde. Okinawa dispose de 32 installations militaires américaines. Près d’un quart du territoire est occupé par des bases américaines. Le ciel est souvent couvert d’avions militaires ; l’arrogance de l’occupant constitue une présence physique quotidienne. Okinawa est de la taille de Long Island. Imaginez une base chinoise bourdonnante juste à côté de New York.
Je suis allé filmer dans l’île de Jeju, au large de la pointe sud de la Corée, où quelque chose de très similaire est arrivée. Les gens sur Jeju ont essayé d’arrêter la construction d’une base importante et provocatrice à environ 600km de Shanghai. La marine sud-coréenne la gardera prête pour les États-Unis. C’est en réalité une base américaine où des destroyers de la classe Aegis mouilleront ainsi que des sous-marins nucléaires et des porte-avions – juste à côté de la Chine. Comme Okinawa, Jeju a une histoire d’invasions, de souffrances et de résistances.
En Chine, je décidé de me concentrer sur Shanghai, qui a été au cœur de l’histoire moderne et des convulsions de la Chine, et de la restauration moderne. Mao et ses camarades y ont fondé le Parti communiste de Chine, dans les années 1920. Aujourd’hui, la maison où ils se sont rencontrés clandestinement est entourée par les symboles de la consommation : juste en face se trouve un Starbucks. En Chine, on peut croiser l’ironie à chaque coin de rue.
Le dernier chapitre du film se déroule aux États-Unis, où j’ai interviewé ceux qui planifient et « jouent à la guerre virtuelle » avec la Chine et ceux qui nous alertent sur les dangers. J’y ai rencontré des gens impressionnants : Bruce Cummings, l’historien dont le dernier livre sur la Corée retrace l’histoire secrète, et David Vine, dont le travail complet sur les bases américaines a été publié l’année dernière. J’ai filmé une interview au Département d’Etat avec le secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie et le Pacifique, Daniel Russell, qui a dit que les Etats-Unis « n’en étaient plus à construire des bases. » Les États-Unis possèdent environ 5.000 bases militaires – 4000 aux États-Unis et près d’un millier sur tous les continents. Rassembler tout ça, lui donner un sens, rendre justice à chacun autant que possible, constitue à la fois le plaisir et la douleur du cinéma. Ce que le film dira, j’espère, est qu’il existe de grands dangers qui ne sont pas reconnus. Je dois dire que me retrouver aux États-Unis pendant une campagne présidentielle qui n’aborde aucun de ces sujets, c’était comme fouler le sol d’une autre planète. .
Ce n’est pas tout à fait correct. Donald Trump a été pris de ce qui semble être un intérêt sérieux, sinon passager. Stephen Cohen, l’autorité de renom sur la Russie, a effectué un suivi, en soulignant que Trump fait clairement savoir qu’il souhaitait des relations amicales avec la Russie et la Chine. Hillary Clinton a attaqué Trump sur ce point. Soit dit en passant, Cohen lui-même a été insulté pour avoir suggéré que Trump n’était pas un cinglé assoiffé de sang par rapport à la Russie. Pour sa part, Bernie Sanders est resté silencieux ; quoi qu’il en soit, il s’est rallié à Clinton. Comme ses courriels le montrent, Clinton semble vouloir détruire la Syrie afin de protéger le monopole nucléaire d’Israël. Rappelez-vous ce qu’elle a fait pour la Libye et Kadhafi. En 2010, en tant que secrétaire d’Etat, elle a transformé un différend régional en mer de Chine en un litige avec les Etats-Unis. Elle l’a promu en une question internationale, un lieu de crise. L’année suivante, Obama a annoncé son « pivot vers l’Asie », le jargon employé pour désigner la plus grande accumulation de forces militaires américaines en Asie depuis la Seconde Guerre mondiale. L’actuel secrétaire de la Défense, Ash Carter, a récemment annoncé que les missiles et les hommes seraient basés aux Philippines, face à la Chine. Cela se passe alors que l’OTAN poursuit son renforcement militaire étrange en Europe, tout près des frontières de la Russie. Aux Etats-Unis, où les médias sous toutes leurs formes sont omniprésentes et la presse est constitutionnellement la plus libre du monde, il n’y a pas de débat national, et même pas de débat tout court, sur ces développements. Dans un sens, le but de mon film est d’aider à briser le silence.
Daniel Broudy : Il est tout à fait étonnant de voir que les deux principaux candidats démocrates n’ont pratiquement rien dit de concret sur la Russie et la Chine ni sur ce que les États-Unis font et, comme vous l’avez dit, il est ironique de voir Trump, qui est un homme d’affaires, parler de la Chine de cette façon.
John Pilger : Trump est imprévisible, mais il a clairement dit qu’il n’avait pas envie de faire la guerre à la Russie et à la Chine. À un moment donné, il a dit qu’il serait même neutre dans le Moyen-Orient. Ce qui est une hérésie, alors il a fait marche arrière sur ce point. Stephen Cohen a dit qu’il [Cohen] avait été attaqué uniquement pour avoir murmuré [les points de Trump]. J’ai récemment écrit quelque chose de similaire et et mes propos ont bouleversé une certaine base dans les médias sociaux. Plusieurs personnes ont suggéré que je soutenais Trump.
Maki Sunagawa : Je voudrais aborder certains de vos travaux antérieurs qui touchent au présent. Dans votre film, Stealing a Nation, Charlesia Alexis parle de ses plus beaux souvenirs de Diego Garcia, en soulignant que, « Nous pouvions manger de tout ; on n’a jamais manqué de quoi que ce soit, et on n’a jamais acheté quoi que ce soit, sauf les vêtements que nous portions. » Ces paroles me rappellent les lieux et les cultures pacifiques et intactes à travers le monde qui existaient avant que les techniques colonisatrices classiques aient été appliquées aux peuples et aux environnements autochtones. Pourriez-vous détailler un peu ce que vous avez découvert lors de vos recherches sur Diego Garcia qui illustre par des faits cette force insidieuse que nous subissons encore aujourd’hui ?
ohn Pilger : Ce qui est arrivé aux habitants de Diego Garcia fut un crime épique. Ils ont été expulsés, tous, par la Grande-Bretagne et les États-Unis. La vie que vous venez de décrire, la vie de Charlesia, a été délibérément détruite. Depuis leur expulsion, qui a commencé dans les années 70, les habitants des Chagos ont organisé une résistance infatigable. Comme vous le dites, leur histoire est celle des peuples autochtones partout dans le monde. En Australie, les peuples autochtones ont été expulsés de leurs communautés et brutalisés. En Amérique du Nord, l’histoire est similaire. Les populations autochtones sont profondément menaçantes pour les sociétés de colons, car elles représentent une autre vie, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses ; elles peuvent accepter la surface de notre mode de vie, avec des résultats souvent tragiques, mais la perception qu’elles ont d’elles-mêmes n’en est pas prisonnière. Si nous les « modernistes » étions aussi intelligents que nous croyons l’être, nous apprendrions d’elles. Au lieu de cela, nous préférons le confort spécieux et les préjugés de notre ignorance. J’ai eu beaucoup de contacts avec les peuples autochtones de l’Australie. J’ai fait un certain nombre de films sur eux et sur leurs oppresseurs, et j’admire leur résilience et résistance. Ils ont beaucoup en commun avec le peuple de Diego Garcia.
Certes, l’injustice et la cruauté sont similaires : les habitants des Chagos ont été trompés et intimidés pour les obliger à quitter leurs foyers. Afin de les effrayer à partir, les autorités coloniales britanniques ont tué leurs chiens de compagnie bien-aimés. Puis ils les ont embarqués sur un vieux cargo avec une cargaison d’excréments d’oiseaux, puis les ont largués dans des bidonvilles de l’île Maurice et des Seychelles. Cette horreur est décrite en détail d’un ton presque méprisant dans les documents officiels. L’un d’entre eux, écrit par l’avocat du Ministère des affaires étrangères, est intitulé, « Le maintien de la fiction ». En d’autres termes : comment faire passer un gros mensonge. Le gouvernement britannique a menti à l’Organisation des Nations Unies en affirmant que les habitants des Chagos étaient de « travailleurs temporaires ». Une fois expulsés, ils ont en quelque sorte retouché les photos ; un document du ministère de la Défense a même prétendu n’y avait jamais eu de population.
Ce fut un tableau grotesque de l’impérialisme moderne : un mot, d’ailleurs, qui a pratiquement disparu des dictionnaires. Il y a quelques semaines, les Chagossiens ont vu leur appel à la Cour Suprême britannique rejeté. Ils avaient fait appel d’une décision prise par la Chambre des Lords en 2009 qui leur a refusé le droit de rentrer chez eux, malgré une série d’arrêts de la Haute Cour prononcés en leur faveur. Lorsque la justice britannique est appelée à statuer entre les droits de l’homme et les droits d’une grande puissance, ses décisions peuvent se révéler ouvertement politiques.
Daniel Broudy : En entendant les gens parler de la grande beauté de Diego Garcia au cours des deux dernières décennies, et les activités marines de loisirs étonnantes disponibles pour tous ceux qui ont la chance d’y être stationnés ou temporairement affectés, je suis toujours frappé par l’ignorance déterminée de tous ceux qui vont et viennent allègrement sans rien connaître de l’histoire de l’île. C’est peut-être dû aux médias que beaucoup de gens consomment et qui jouent un rôle dans la création de ce détachement. La ligne claire qui autrefois séparait la publicité commerciale civile et les relations publiques militaires semble avoir disparue dans ces médias de masse. De nos jours, les publications civiles affichent des titres tels que Le Classement des Meilleures Bases Militaires Outre-Mer. L’auteur d’un récent article soulignait que les militaires engagés admettent que leur motivation principale d’engagement est de « voir du pays ». Je me demande si le système actuel permet, encourage à se percevoir comme une sorte de voyageur du monde cosmopolite et contribue ainsi à développer un sens superficiel du reste du monde, occultant des réalités et des histoires terribles, comme à Diego Garcia, situées hors de notre perception. Pensez-vous que le processus de commercialisation et de “glamourisation” de ces activités militaires joue un rôle dans le maintien de ce réseau mondial de bases militaires ?
John Pilger : Convaincre les jeunes hommes et femmes à rejoindre une armée de volontaires se réalise en leur offrant une sécurité qu’ils ne pourraient pas avoir dans une période économique difficile et en présentant le tout comme une aventure. Ajoutons à cela la propagande patriotique. Les bases sont autant de petites Amériques ; vous pouvez être à l’étranger sous des climats exotiques, mais sans y être vraiment ; c’est une vie virtuelle. Lorsque vous croisez des « indigènes », vous pouvez supposer que l’aventure dans laquelle vous vous trouvez inclut une autorisation pour les bousculer ; ils ne font pas partie de la petite Amérique, de sorte qu’ils peuvent être maltraités. Les habitants d’Okinawa en savent quelque chose.
Je regardais quelques films d’archives intéressants sur l’une de ces bases sur Okinawa. La femme d’un soldat basé là-bas a dit : « Oh, nous essayons de sortir une fois par mois pour avoir un repas local pour avoir une idée de l’endroit où nous sommes. » L’année dernière, dans l’avion au départ des îles Marshall, mon équipe et moi devions passer par le Ronald Reagan Missile Test Site sur l’atoll Kwajelein. Ce fut une expérience kafkaïenne. On a relevé nos empreintes digitales, enregistré nos iris, mesuré notre taille, nous avons été photographiés sous tous les angles. C’était comme si nous étions en état d’arrestation. Ce fut la porte d’entrée vers une petite Amérique avec terrain de golf, pistes de jogging, pistes cyclables et des chiens et des enfants. Les gens qui arrosent les terrains de golf et contrôlent le niveau de chlore dans les piscines viennent d’une île de l’autre côté de la baie, Ebeye, d’où ils effectuent quotidiennement des allers-retours, transportés par les militaires. Ebeye est longue d’environ un km et demi, et 12.000 personnes s’y entassent ; ce sont des réfugiés des essais nucléaires dans les îles Marshalls. L’approvisionnement en eau et l’assainissement y fonctionnent à peine. C’est de l’apartheid dans le Pacifique. Les Américains de la base n’ont aucune idée de la façon dont les insulaires vivent. Ils [les membres de la communauté militaire] font des barbecues face aux couchers de soleil. Quelque chose de semblable est arrivée à Diego Garcia. Une fois que les gens ont été expulsés, les barbecues et le ski nautique pouvaient se mettre en place.
A Washington, le secrétaire d’Etat adjoint que j’ai interviewé a dit que les États-Unis étaient en fait anti-impérialistes. Il était impassible et probablement sincère, et insipide. Il n’est pas un cas rare. Vous pouvez dire à des gens de niveau académique aux États-Unis que « Les Etats-Unis ont le plus grand empire que le monde a jamais connu, et voici pourquoi, voici la preuve. » Il est probable que cela sera reçu avec une expression d’incrédulité.
Daniel Broudy : Certaines choses dont vous parlez me rappellent quelque chose que j’appris par des amis du Département d’Etat. Il y a toujours un risque que les employés du Département d’Etat ou des personnes qui servent dans l’armée à l’étranger « virent local », c’est-à-dire qu’ils commencent à sympathiser avec la population locale.
John Pilger : Je suis d’accord. Quand ils compatissent, ils se rendent compte que toute la raison de leur présence est absurde. Certains des dénonciations les plus efficaces proviennent d’ex-militaires.
Daniel Broudy : Peut-être que les clôtures, plutôt que de maintenir les étrangers [les locaux] à l’extérieur, servent à rappeler à ceux qui sont à l’intérieur qu’il y a une barrière et que parfois vous n’êtes pas autorisés à franchir cette barrière.
John Pilger : Oui, c’est « eux d’un côté et nous de l’autre ». Si vous allez à l’extérieur de la clôture, il y a toujours le risque d’apprendre quelque-chose sur une autre société. Ce qui peut conduire à se poser des questions sur le pourquoi de la présence d’une base militaire à cet endroit. Cela ne se produit pas souvent, car il y a une autre ligne de clôture qui traverse la conscience militaire.
Maki Sunagawa : Lorsque vous regardez en arrière sur vos lieux de de tournage à Okinawa ou lorsque vous avez filmé certaines scènes pour ce projet, quels sont vos souvenirs les plus marquants et / ou choquants ? Y a-t-il des scènes ou des conversations qui vous collent à la peau ?
John Pilger : Eh bien, il y en a un certain nombre. J’ai eu le privilège de rencontrer Fumiko [Shimabukuro], qui est une source d’inspiration. Ceux qui ont réussi à faire élire le gouverneur Onaga et obtenir que Henoko et toutes les bases entrent dans le débat politique japonais sont parmi les personnes pétris de principes les plus dynamiques que j’ai rencontrés, tellement inventifs et gentils.
En écoutant la mère d’un des jeunes qui est mort suite à ses terribles blessures lorsqu’un chasseur US s’est écrasé sur l’école [à Ishikawa] en 1959, je me suis brutalement rappelé la peur dans laquelle les gens vivent. Un enseignant m’a dit qu’elle n’arrêtait pas de regarder en l’air avec angoisse chaque fois qu’elle entendait le bourdonnement d’un avion au-dessus de sa classe. Lorsque nous tournions à l’extérieur de Camp Schwab, nous étions (ainsi que tous les manifestants) délibérément harcelés par d’énormes hélicoptères Sea Stallion, qui volaient en cercles au-dessus de nos têtes. C’était un avant-goût de ce que les Okinawans subissent tous les jours. On entend souvent cette complainte chez les progressistes dans les sociétés confortables lorsqu’ils sont confrontées à des vérités qui dérangent : « Mais qu’est-ce que je peux faire pour faire changer les choses » ? Je suggère qu’ils fassent comme les habitants d’Okinawa : ne pas baisser les bras ; continuer la lutte.
« Résistance » n’est pas un mot qu’on entend souvent en Occident ou dans les médias. Il est considéré comme un mot « d’ailleurs », qui n’est pas employé par des gens polis, des gens respectables. C’est un mot difficile à détourner et à changer. La résistance que j’ai trouvée à Okinawa est une source d’inspiration.
Maki Sunagawa : Oui, je suppose que lorsque vous faites partie de la résistance, il est pas si facile de percevoir son efficacité. Très souvent, quand je fais des recherches sur le terrain, des interviews, des prises de notes, il me faut un certain temps pour prendre du recul et observer les détails de façon plus objective pour avoir un aperçu plus large du tableau. Au cours de la réalisation de ce film, avez-vous appris quelque chose de nouveau et d’important ?
John Pilger : Eh bien, faire un film comme celui-ci est vraiment un voyage de découverte. Vous commencez avec une vision générale et quelques idées et hypothèses, sans jamais vraiment savoir où tout cela vous mènera. Je n’avais jamais mis les pieds à Okinawa, et j’y ai trouvé de nouvelles idées et de nouvelles expériences : une nouvelle perception des gens, et j’espère que le film le montrera.
Les îles Marshall ont également été une découverte pour moi. Ici, à partir de 1946, les États-Unis ont testé l’équivalent d’une bombe d’Hiroshima chaque jour pendant douze ans. Les habitants servent encore de cobayes. Des missiles balistiques inter-continentaux sont tirés depuis la Californie sur les lagunes dans et autour de l’atoll Kwajelein. L’eau est empoisonnée, les poissons non comestibles. Les gens survivent en bouffant des boîtes de conserves. J’ai rencontré un groupe de femmes qui étaient des survivantes des essais nucléaires autour des atolls de Bikini et Rongelap. Toutes avaient perdu leurs glandes thyroïdes. Elles avaient la soixantaine. Elles ont survécu, incroyablement. Elles étaient d’une générosité rare et avaient un sens aigu de l’humour noir. Elles ont chanté pour nous et nous ont offert des cadeaux, et nous ont dit qu’elles étaient heureuses que nous soyons venus pour filmer. Elles aussi font partie d’une résistance invisible.
John Pilger
Traduction “Toute ressemblance entre le sort fait à ces peuples et un autre au Moyen-orient n’est sûrement pas fortuite” par VD pour le Grand Soir avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles.
Maki Sunagawa est un chercheur post-universitaire à l’École supérieure de communication interculturelle à l’Université Chrétienne d’Okinawa. Elle rédige actuellement un livre basé sur ses recherches sur la propagande d’entreprise et d’Etat et son utilisation et ses effets à Okinawa depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Daniel Broudy est professeur de rhétorique et linguistique appliquée à l’Université Chrétienne d’Okinawa. Ses activités de recherche portent sur l’analyse critique des textes et représentations symboliques du pouvoir qui prévalent dans la culture post-industrielle. Il est co-éditeur de Synaesthesia : Communication Across Cultures, membre de Veterans For Peace, et écrit sur les pratiques discursives contemporaines qui façonnent l’esprit du public.
Source : Le Grand Soir, John Pilger, 08-08-2016