Cette année 2024 m’est particulièrement symbolique. En octobre, je fêterai les 20 ans de ce blog et ne serai plus très loin du million de mots publiés. Vingt ans qui ont fait de ce blog un élément central et constitutif de mon identité. Si je rêve d’être reconnu comme écrivain voire développeur ou scientifique, je resterai toujours avant tout un blogueur. Blogueur est d’ailleurs le premier qualificatif accolé à mon patronyme dans les médias ou sur Wikipédia.
Ironiquement, l’année de ces 20 ans de blog a commencé avec la plus longue indisponibilité que ce site ait jamais connue. Durant plusieurs jours, ploum.net a été complètement retiré du réseau. En cause, une attaque massive contre Sourcehut, mon hébergeur, forçant ce dernier à migrer en catastrophe vers une nouvelle infrastructure.
Si j’ai vécu la mise hors-ligne de mon blog comme une amputation, une perte d’une partie de mon identité, je sais fort bien que cela ne me porte aucun préjudice durable, que je ne perds aucune donnée. Ce genre d’incidents font partie de la vie et je tiens à remercier l’équipe de Sourcehut pour la transparence totale et le travail accompli ces derniers jours.
Cet événement m’a également fait prendre conscience à quel point l’œuvre de toute une vie pouvait disparaitre rapidement, dans l’indifférence la plus générale. Si j’espère que mes livres sur arbres morts continueront toujours à tomber aléatoirement d’une étagère ou être découverts chez des bouquinistes, mes écrits en ligne, eux, sont d’éphémères bouteilles à la mer susceptibles de couler dans les abysses de l’oubli au moindre incident.
Cette question m’obsède depuis que je suis papa : comment faire en sorte que mes écrits en ligne me survivent ?
Nom de domaine et indépendance
J’espère que mon blog sera encore consultable le jour inévitable où Facebook, Medium et Youtube auront été relégués avec Myspace et Skyblog dans l’armoire des souvenirs historiques du web. Et quand je vois Alias fêter les 15 ans de son blog, je pense ne pas être le seul. Les blogs sont les archives à long terme du web:
Concrètement, je fuis toutes les plateformes propriétaires et je lie tous mes écrits à mon propre nom de domaine : ploum.net. En fait, pour être sûr, je dispose même de trois noms, sur trois premiers niveaux différents: ploum.net, ploum.be, ploum.eu.
À court terme, cela peut être un mauvais calcul: les pages Facebook de mes amis décédés sont encore en ligne alors que les domaines expirent rapidement. Je dois donc préparer la transmission de ces domaines pour assurer qu’ils puissent me survivre.
Simplicité et minimalisme
Outre le nom de domaine, la première cause de mise hors ligne d’un site est généralement le manque de maintenance. Un Wordpress piraté, car une mise à jour n’a pas été faite. Une base de données incompatible avec une nouvelle version du CMS. Même les générateurs de sites statiques doivent être mis à jour, avec leur dépendance, et sont parfois abandonnés par les développeurs.
Pour résoudre ce problème, mon blog est depuis décembre 2022 autogénéré et ne produit que du HTML très simple, compatible avec la plupart des navigateurs passés, présents, futurs et sans ambiguïté. Chaque page est complètement indépendante et contient ses propres instructions CSS (42 lignes). Vous pouvez sauver un article de mon blog depuis votre navigateur et le réouvrir n’importe où, même sans connexion. Pas de JavaScript, pas de framework, pas de chargement dynamique, pas de fonte, pas d’appel extérieur. Ça parait extraordinaire de nos jours, mais c’est tellement simple à gérer que je me demande encore pourquoi on se casse la tête à apprendre et maintenir des couches de framework. Penser la pérennité peut avoir des bénéfices immédiats !
Autre point: je prends le plus grand soin à ce que les URLs de mes posts ne changent pas. Un lien vers un article devrait rester valide aussi longtemps que le nom de domaine existera.
Sources disponibles et distribuées
Les sources de mon blog sont écrites au format Gemtext, le format utilisé sur le réseau Gemini. La particularité de ce format est qu’il s’agit essentiellement de texte pur. Aussi longtemps que nous aurons des ordinateurs, ces fichiers pourront être lus.
Mes billets ainsi que le générateur Python pour créer les pages HTML sont disponibles via Git, un outil décentralisé bien connu de tous les développeurs et certainement appelé à exister pour les décennies qui viennent.
La commande
git clone https://git.sr.ht/~lioploum/ploum.net
vous donne accès à toutes les sources de mon blog, que vous pouvez générer avec un simple "python publish.py". Cela ne nécessite aucune dépendance particulière autre que Python3.
Mais que faire si sourcehut est indisponible ? Je me rends compte qu’il est nécessaire que je pousse mes sources sur plusieurs miroirs.
Miroirs ?
Parlons de miroirs justement. Une copie de mon site, version web et gemini, est disponible sur rawtext.club.
Mais ce miroir est « accidentel ». Rawtext.club est un petit serveur géré par un passionné que je remercie chaleureusement. C’est grâce à lui que j’ai pu explorer l’univers Gemini. Je ne peux lui imposer un hébergement sérieux ni compter sur sa pérennité.
Sebsauvage me fait également l’immense honneur de maintenir une copie de mes publications, pour le cas où je serais forcé de retirer du contenu:
Pour le futur, je réalise aujourd’hui qu’il serait pertinent que je trouve un hébergeur autre que Sourcehut, pouvant être synchronisé par Git et offrant également un hébergement Gemini. Je pourrais rediriger ploum.be ou ploum.eu vers ce serveur de secours.
Les mailing-lists
Si j’avoue préférer le RSS pour mon usage personnel, force est de constater que les mailing-listes offrent un avantage : vous gardez une copie de tous les anciens billets dans votre boîte mail. Chaque nouvel abonné est donc, sans le savoir, un nouvel archiviste de mes écrits.
J’envoie d’ailleurs une version "text-only" (pas de HTML) sur une seconde mailing-list dont les archives sont publiques. Défaut majeur : contrairement aux mailing-listes précitées, ces archives text-only sont hébergées par… Sourcehut, le même hébergeur que mon blog !
Le futur
Le protocole Internet (IP) a été conçu à une époque où on pensait que le stockage serait toujours très coûteux, mais que la bande passante serait essentiellement gratuite. Le principe d’IP est donc de transmettre aussi vite que possible les paquets de données et de tout oublier instantanément.
En conséquence, les protocoles s’appuyant sur IP, comme Gemini et HTTPS, sont particulièrement fragiles. La perte d’un seul serveur peut signifier la disparition définitive de sites entiers.
De nouveaux protocoles ou de nouveaux usages sont nécessaires pour transformer Internet depuis le simple "échange de données temps réels" en "archive planétaire". Cet usage d’archive planétaire va bien entendu à l’encontre des intérêts financiers actuels qui souhaitent que vous payiez, directement ou à travers la pub, à chaque fois que vous consultez le même contenu. Le « copyright », comme son nom l’indique, cherche à empêcher toute copie ! Mais, petit à petit, des solutions apparaissent, qu’elles soient nouvelles comme IPFS ou qu’il s’agissent de réflexion sur une utilisation de technologies préexistantes.
Tout cela est encore expérimental, mais je garde un œil et réfléchis à rendre ploum.net disponible sur IPFS.
Le présent
La pérennité des contenus en ligne est une quête complexe et longue haleine. Je vous invite à y penser pour vos propres créations. Que voulez-vous qu’il reste de vous en ligne dans quelques années ?
Paradoxalement, nous laissons trop de traces involontaires (des données personnelles, des commentaires écrits sous le coup de la colère, des critiques de produits sur Amazon) et nous perdons trop facilement ces œuvres auxquelles nous accordons de l’importance (combien de vidéos personnelles disparaitront avec la fin inéluctable de Youtube ?). J’ai moi-même le regret d’avoir perdu beaucoup de textes rédigés et publiés un peu partout avant l’existence de ce blog ou cédant aux sirènes de la mode, postés sur Google+, Facebook ou Medium.
J’en ai retenu une leçon majeure : on ne sait a priori pas quels contenus seront importants pour notre futur moi. Il est également primordial de dater les contenus. Avec l’année. Je ne compte plus les fiches de notes que j’ai retrouvées, mais que je peux ne raccrocher à rien, ne sachant même pas estimer à quelle année voire à quel lustre le texte se rapporte. Cette leçon est également ce qui motive ma tentative de pérennisation de mes écrits : je n’ai pas l’impression de n’avoir jamais écrit quelque chose qui mérite une préservation éternelle. Mais un historien du futur pourrait peut-être un jour trouver dans les écrits de ce blogueur obscur et oublié une information cruciale, glissée par hasard dans un billet et lui permettant de comprendre certains paradoxes de notre époque.
Pour cette mission, la technologie qui semble la plus robuste, la plus résistante pour traverser les siècles voire les millénaires reste le livre. Livres que ma famille collectionne et accumule dans tous les coins de notre logis. Des milliers d’auteurs, vivants ou morts, mondialement connus ou obscurs, qui continuent chaque jour à nous parler !
Si vous souhaitez m’aider dans ma quête de pérennité, je vous invite à acquérir, prêter, offrir ou abandonner sur un banc mes livres.
Car lorsque les ordinateurs seront éteints, seuls continueront à nous bercer, à nous parler les mots gravés sur le papier, ces éphémères imaginaires survivants à la prétention d’immortalité des corps décomposés.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Cette année 2024 m’est particulièrement symbolique. En octobre, je fêterai les 20 ans de ce blog et ne serai plus très loin du million de mots publiés. Vingt ans qui ont fait de ce blog un élément central et constitutif de mon identité. Si je rêve d’être reconnu comme écrivain voire développeur ou scientifique, je resterai toujours avant tout un blogueur. Blogueur est d’ailleurs le premier qualificatif accolé à mon patronyme dans les médias ou sur Wikipédia.
Ironiquement, l’année de ces 20 ans de blog a commencé avec la plus longue indisponibilité que ce site ait jamais connue. Durant plusieurs jours, ploum.net a été complètement retiré du réseau. En cause, une attaque massive contre Sourcehut, mon hébergeur, forçant ce dernier à migrer en catastrophe vers une nouvelle infrastructure.
Si j’ai vécu la mise hors-ligne de mon blog comme une amputation, une perte d’une partie de mon identité, je sais fort bien que cela ne me porte aucun préjudice durable, que je ne perds aucune donnée. Ce genre d’incidents font partie de la vie et je tiens à remercier l’équipe de Sourcehut pour la transparence totale et le travail accompli ces derniers jours.
Cet événement m’a également fait prendre conscience à quel point l’œuvre de toute une vie pouvait disparaitre rapidement, dans l’indifférence la plus générale. Si j’espère que mes livres sur arbres morts continueront toujours à tomber aléatoirement d’une étagère ou être découverts chez des bouquinistes, mes écrits en ligne, eux, sont d’éphémères bouteilles à la mer susceptibles de couler dans les abysses de l’oubli au moindre incident.
Cette question m’obsède depuis que je suis papa : comment faire en sorte que mes écrits en ligne me survivent ?
Nom de domaine et indépendance
J’espère que mon blog sera encore consultable le jour inévitable où Facebook, Medium et Youtube auront été relégués avec Myspace et Skyblog dans l’armoire des souvenirs historiques du web. Et quand je vois Alias fêter les 15 ans de son blog, je pense ne pas être le seul. Les blogs sont les archives à long terme du web:
Concrètement, je fuis toutes les plateformes propriétaires et je lie tous mes écrits à mon propre nom de domaine : ploum.net. En fait, pour être sûr, je dispose même de trois noms, sur trois premiers niveaux différents: ploum.net, ploum.be, ploum.eu.
À court terme, cela peut être un mauvais calcul: les pages Facebook de mes amis décédés sont encore en ligne alors que les domaines expirent rapidement. Je dois donc préparer la transmission de ces domaines pour assurer qu’ils puissent me survivre.
Simplicité et minimalisme
Outre le nom de domaine, la première cause de mise hors ligne d’un site est généralement le manque de maintenance. Un Wordpress piraté, car une mise à jour n’a pas été faite. Une base de données incompatible avec une nouvelle version du CMS. Même les générateurs de sites statiques doivent être mis à jour, avec leur dépendance, et sont parfois abandonnés par les développeurs.
Pour résoudre ce problème, mon blog est depuis décembre 2022 autogénéré et ne produit que du HTML très simple, compatible avec la plupart des navigateurs passés, présents, futurs et sans ambiguïté. Chaque page est complètement indépendante et contient ses propres instructions CSS (42 lignes). Vous pouvez sauver un article de mon blog depuis votre navigateur et le réouvrir n’importe où, même sans connexion. Pas de JavaScript, pas de framework, pas de chargement dynamique, pas de fonte, pas d’appel extérieur. Ça parait extraordinaire de nos jours, mais c’est tellement simple à gérer que je me demande encore pourquoi on se casse la tête à apprendre et maintenir des couches de framework. Penser la pérennité peut avoir des bénéfices immédiats !
Autre point: je prends le plus grand soin à ce que les URLs de mes posts ne changent pas. Un lien vers un article devrait rester valide aussi longtemps que le nom de domaine existera.
Sources disponibles et distribuées
Les sources de mon blog sont écrites au format Gemtext, le format utilisé sur le réseau Gemini. La particularité de ce format est qu’il s’agit essentiellement de texte pur. Aussi longtemps que nous aurons des ordinateurs, ces fichiers pourront être lus.
Mes billets ainsi que le générateur Python pour créer les pages HTML sont disponibles via Git, un outil décentralisé bien connu de tous les développeurs et certainement appelé à exister pour les décennies qui viennent.
La commande
git clone https://git.sr.ht/~lioploum/ploum.net
vous donne accès à toutes les sources de mon blog, que vous pouvez générer avec un simple "python publish.py". Cela ne nécessite aucune dépendance particulière autre que Python3.
Mais que faire si sourcehut est indisponible ? Je me rends compte qu’il est nécessaire que je pousse mes sources sur plusieurs miroirs.
Miroirs ?
Parlons de miroirs justement. Une copie de mon site, version web et gemini, est disponible sur rawtext.club.
Mais ce miroir est « accidentel ». Rawtext.club est un petit serveur géré par un passionné que je remercie chaleureusement. C’est grâce à lui que j’ai pu explorer l’univers Gemini. Je ne peux lui imposer un hébergement sérieux ni compter sur sa pérennité.
Sebsauvage me fait également l’immense honneur de maintenir une copie de mes publications, pour le cas où je serais forcé de retirer du contenu:
Pour le futur, je réalise aujourd’hui qu’il serait pertinent que je trouve un hébergeur autre que Sourcehut, pouvant être synchronisé par Git et offrant également un hébergement Gemini. Je pourrais rediriger ploum.be ou ploum.eu vers ce serveur de secours.
Les mailing-lists
Si j’avoue préférer le RSS pour mon usage personnel, force est de constater que les mailing-listes offrent un avantage : vous gardez une copie de tous les anciens billets dans votre boîte mail. Chaque nouvel abonné est donc, sans le savoir, un nouvel archiviste de mes écrits.
J’envoie d’ailleurs une version "text-only" (pas de HTML) sur une seconde mailing-list dont les archives sont publiques. Défaut majeur : contrairement aux mailing-listes précitées, ces archives text-only sont hébergées par… Sourcehut, le même hébergeur que mon blog !
Le futur
Le protocole Internet (IP) a été conçu à une époque où on pensait que le stockage serait toujours très coûteux, mais que la bande passante serait essentiellement gratuite. Le principe d’IP est donc de transmettre aussi vite que possible les paquets de données et de tout oublier instantanément.
En conséquence, les protocoles s’appuyant sur IP, comme Gemini et HTTPS, sont particulièrement fragiles. La perte d’un seul serveur peut signifier la disparition définitive de sites entiers.
De nouveaux protocoles ou de nouveaux usages sont nécessaires pour transformer Internet depuis le simple "échange de données temps réels" en "archive planétaire". Cet usage d’archive planétaire va bien entendu à l’encontre des intérêts financiers actuels qui souhaitent que vous payiez, directement ou à travers la pub, à chaque fois que vous consultez le même contenu. Le « copyright », comme son nom l’indique, cherche à empêcher toute copie ! Mais, petit à petit, des solutions apparaissent, qu’elles soient nouvelles comme IPFS ou qu’il s’agissent de réflexion sur une utilisation de technologies préexistantes.
Tout cela est encore expérimental, mais je garde un œil et réfléchis à rendre ploum.net disponible sur IPFS.
Le présent
La pérennité des contenus en ligne est une quête complexe et longue haleine. Je vous invite à y penser pour vos propres créations. Que voulez-vous qu’il reste de vous en ligne dans quelques années ?
Paradoxalement, nous laissons trop de traces involontaires (des données personnelles, des commentaires écrits sous le coup de la colère, des critiques de produits sur Amazon) et nous perdons trop facilement ces œuvres auxquelles nous accordons de l’importance (combien de vidéos personnelles disparaitront avec la fin inéluctable de Youtube ?). J’ai moi-même le regret d’avoir perdu beaucoup de textes rédigés et publiés un peu partout avant l’existence de ce blog ou cédant aux sirènes de la mode, postés sur Google+, Facebook ou Medium.
J’en ai retenu une leçon majeure : on ne sait a priori pas quels contenus seront importants pour notre futur moi. Il est également primordial de dater les contenus. Avec l’année. Je ne compte plus les fiches de notes que j’ai retrouvées, mais que je peux ne raccrocher à rien, ne sachant même pas estimer à quelle année voire à quel lustre le texte se rapporte. Cette leçon est également ce qui motive ma tentative de pérennisation de mes écrits : je n’ai pas l’impression de n’avoir jamais écrit quelque chose qui mérite une préservation éternelle. Mais un historien du futur pourrait peut-être un jour trouver dans les écrits de ce blogueur obscur et oublié une information cruciale, glissée par hasard dans un billet et lui permettant de comprendre certains paradoxes de notre époque.
Pour cette mission, la technologie qui semble la plus robuste, la plus résistante pour traverser les siècles voire les millénaires reste le livre. Livres que ma famille collectionne et accumule dans tous les coins de notre logis. Des milliers d’auteurs, vivants ou morts, mondialement connus ou obscurs, qui continuent chaque jour à nous parler !
Si vous souhaitez m’aider dans ma quête de pérennité, je vous invite à acquérir, prêter, offrir ou abandonner sur un banc mes livres.
Car lorsque les ordinateurs seront éteints, seuls continueront à nous bercer, à nous parler les mots gravés sur le papier, ces éphémères imaginaires survivants à la prétention d’immortalité des corps décomposés.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Il était une fois un groupe d’humains perdus au milieu d’un gigantesque océan. Aussi loin que remontait la mémoire, le gigantesque bateau de bois avait toujours navigué, aucune terre n’ayant jamais été trouvée ni même aperçue.
Le temps n’était jamais glacial, mais jamais trop chaud non plus. Souvent, un petit vent frisquet parcourait les cabines. Pour se réchauffer, les passagers de première classe avaient engagé ceux de troisième classe, les chargeant de découper le bois de la coque afin de le brûler dans leurs énormes poêles. Comme les cabines étaient bien plus confortables chauffées, l’idée vint aux premières classes de revendre aux passagers de seconde classe l’excédent du bois.
Le marché était juteux. Une partie de la tuyauterie du navire fut reconvertie en poêle à bois vendus à très bon prix afin d’équiper les cabines des secondes.
Naturellement, le bateau prenait désormais l’eau de partout. Un original aux cheveux en bataille émit l’idée d’arrêter de découper la coque si l’on ne voulait pas couler.
— Et mes profits ? dirent les premières.
— Et mon chauffage ? dirent les secondes.
— Et mon boulot ? dirent les troisièmes.
— Ben je ne sais pas trop. On pourrait mettre des pulls ?
– Ahaha, ricanèrent les premières. Un original qui ne connait rien au brûlage du bois et voudrait nous faire la leçon avec un pull !
Un instant désarçonné, l’original s’entêta.
— N’empêche que là, on coule. Les troisièmes classes seront bientôt sous eau.
— Tu as raison, déclara le capitaine. C’est une problématique importante. J’organise immédiatement une réunion dans le salon des premières classes. Nous envisagerons une solution.
Lorsqu’il redescendit quelques heures plus tard, le ventre bombé de petits-fours, le capitaine se fit interpeller par l’original qui s’était vu refuser l’accès au pont des premières.
— Alors capitaine ? Qu’allons-nous faire pour éviter que le bateau coule ?
— La réunion fut très productive. Nous allons construire désormais des poêles plus performants pour équiper les cabines qui n’en ont pas encore et pourront dès lors se chauffer avec moins de bois. D’ailleurs, nous envisageons de réduire graduellement la vitesse avec laquelle nous débitons le bois de la coque. Cela ne va pas plaire aux troisièmes, qui auront moins de travail, ni aux secondes, car le bois sera plus cher afin de compenser la perte de profit, mais il faut ce qu’il faut pour sauver le navire.
— Capitaine, vous êtes sûr que cela sera suffisant pour éviter de couler ?
— Ne t’inquiète pas, sourit malicieusement le capitaine. On a également demandé aux deuxièmes classes d’imaginer des pompes pour extraire l’eau du navire. Il y en a bien un qui va nous inventer ça, non ?
— Mais le temps presse…
— Et puis, qui sait… Si ça se trouve, on va bientôt découvrir un rivage, aborder une terre. Pourquoi s’en faire ?
— Pourquoi, en effet, murmura piteusement l’original en retirant ses chaussettes pour les essorer alors que l’eau commençait à monter dans les coursives.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Il était une fois un groupe d’humains perdus au milieu d’un gigantesque océan. Aussi loin que remontait la mémoire, le gigantesque bateau de bois avait toujours navigué, aucune terre n’ayant jamais été trouvée ni même aperçue.
Le temps n’était jamais glacial, mais jamais trop chaud non plus. Souvent, un petit vent frisquet parcourait les cabines. Pour se réchauffer, les passagers de première classe avaient engagé ceux de troisième classe, les chargeant de découper le bois de la coque afin de le brûler dans leurs énormes poêles. Comme les cabines étaient bien plus confortables chauffées, l’idée vint aux premières classes de revendre aux passagers de seconde classe l’excédent du bois.
Le marché était juteux. Une partie de la tuyauterie du navire fut reconvertie en poêle à bois vendus à très bon prix afin d’équiper les cabines des secondes.
Naturellement, le bateau prenait désormais l’eau de partout. Un original aux cheveux en bataille émit l’idée d’arrêter de découper la coque si l’on ne voulait pas couler.
— Et mes profits ? dirent les premières.
— Et mon chauffage ? dirent les secondes.
— Et mon boulot ? dirent les troisièmes.
— Ben je ne sais pas trop. On pourrait mettre des pulls ?
– Ahaha, ricanèrent les premières. Un original qui ne connait rien au brûlage du bois et voudrait nous faire la leçon avec un pull !
Un instant désarçonné, l’original s’entêta.
— N’empêche que là, on coule. Les troisièmes classes seront bientôt sous eau.
— Tu as raison, déclara le capitaine. C’est une problématique importante. J’organise immédiatement une réunion dans le salon des premières classes. Nous envisagerons une solution.
Lorsqu’il redescendit quelques heures plus tard, le ventre bombé de petits-fours, le capitaine se fit interpeller par l’original qui s’était vu refuser l’accès au pont des premières.
— Alors capitaine ? Qu’allons-nous faire pour éviter que le bateau coule ?
— La réunion fut très productive. Nous allons construire désormais des poêles plus performants pour équiper les cabines qui n’en ont pas encore et pourront dès lors se chauffer avec moins de bois. D’ailleurs, nous envisageons de réduire graduellement la vitesse avec laquelle nous débitons le bois de la coque. Cela ne va pas plaire aux troisièmes, qui auront moins de travail, ni aux secondes, car le bois sera plus cher afin de compenser la perte de profit, mais il faut ce qu’il faut pour sauver le navire.
— Capitaine, vous êtes sûr que cela sera suffisant pour éviter de couler ?
— Ne t’inquiète pas, sourit malicieusement le capitaine. On a également demandé aux deuxièmes classes d’imaginer des pompes pour extraire l’eau du navire. Il y en a bien un qui va nous inventer ça, non ?
— Mais le temps presse…
— Et puis, qui sait… Si ça se trouve, on va bientôt découvrir un rivage, aborder une terre. Pourquoi s’en faire ?
— Pourquoi, en effet, murmura piteusement l’original en retirant ses chaussettes pour les essorer alors que l’eau commençait à monter dans les coursives.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
« C’est l’histoire d’un écrivain belge, un écrivain suisse et un écrivain français qui vont en boîte. »
Bon, vu comme ça, ça ressemble à une blague. Mais attendez, ce n’est que le début ! Parce que les trois écrivains ont commis chacun un livre de science-fiction francophone et que si on assemble tous les titres de ces livres, on a, en tout et pour tout, un seul mot de français : le mot « projet ».
Excellente blague, non ?
L’histoire en question, c’est celle d’une boîte, ou plutôt un coffret intitulé « SF en VF » contenant trois romans de science-fiction francophone. Une idée parfaite de cadeau pour offrir ou se faire offrir si l’on souhaite découvrir ou faire découvrir la science-fiction européenne.
Trois livres, trois visions de la science-fiction.
Tout d’abord avec Ploum, le Belge qui pense qu’il faut un titre à consonance anglophone pour faire de la SF, mais ne peut s’empêcher de le franciser : « Printeurs ». Un roman dystopique et cyberpunk sur la face cachée du capitalisme de surveillance : publicités envahissantes, vie privée réduite à néant, attentats sponsorisés, chômeurs hypnotisés par les stars du petit écran tandis qu’en coulisses, les esclaves se tuent à la tâche pour produire les biens de consommation jetables.
On enchaîne ensuite avec le Suisse, Pascal Lovis et son « Projet Idaho ». Le seul titre en français. L’histoire d’un homme en vacances qui se réveille après une cuite magistrale et constate qu’il n’a plus de connexion au réseau. Plus de contacts. Plus d’amis. Et littéralement plus de chambre d’hôtel. Mais, très vite, l’histoire va prendre un tournant inattendu et vous entrainer dans un space opera endiablé. Le second tome, « Mémoires Spectrales », est disponible et clôt le cycle. Il explique également la raison du nom « Idaho » (car moi, je n’avais pas compris la référence à Dune).
Pour terminer en beauté, l’incontournable Thierry Crouzet et le premier tome de son projet démentiel : « One Minute ». Parce que ça pète plus en anglais. Pas de héros. Pas de trame narrative traditionnelle. Ici, le lecteur est invité à vivre et à revivre la même minute de l’histoire de la planète. Celle où l’humanité a soudainement compris, de Paris à Bangkok et de New York à Ouagadougou, qu’elle n’était plus seule. Qu’elle était en contact avec une intelligence extra-terrestre.
Trois livres. Trois pays. Trois accents. Trois histoires. Trois futurs.
Bref, un triple cadeau dans un superbe coffret argenté, à commander chez votre libraire ou, si ce n’est pas possible, directement sur le site de l’éditeur. Mais soutenez votre librairie favorite, elle en a bien besoin !

Notez que Pascal Lovis, le grand mage mauve, fait également partie du coffret régional « Fantasy Suisse » avec Aequilegia Nox et Stéphane Paccaud. De la magie et de la fantasy qui sent bon la raclette.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
« C’est l’histoire d’un écrivain belge, un écrivain suisse et un écrivain français qui vont en boîte. »
Bon, vu comme ça, ça ressemble à une blague. Mais attendez, ce n’est que le début ! Parce que les trois écrivains ont commis chacun un livre de science-fiction francophone et que si on assemble tous les titres de ces livres, on a, en tout et pour tout, un seul mot de français : le mot « projet ».
Excellente blague, non ?
L’histoire en question, c’est celle d’une boîte, ou plutôt un coffret intitulé « SF en VF » contenant trois romans de science-fiction francophone. Une idée parfaite de cadeau pour offrir ou se faire offrir si l’on souhaite découvrir ou faire découvrir la science-fiction européenne.
Trois livres, trois visions de la science-fiction.
Tout d’abord avec Ploum, le Belge qui pense qu’il faut un titre à consonance anglophone pour faire de la SF, mais ne peut s’empêcher de le franciser : « Printeurs ». Un roman dystopique et cyberpunk sur la face cachée du capitalisme de surveillance : publicités envahissantes, vie privée réduite à néant, attentats sponsorisés, chômeurs hypnotisés par les stars du petit écran tandis qu’en coulisses, les esclaves se tuent à la tâche pour produire les biens de consommation jetables.
On enchaîne ensuite avec le Suisse, Pascal Lovis et son « Projet Idaho ». Le seul titre en français. L’histoire d’un homme en vacances qui se réveille après une cuite magistrale et constate qu’il n’a plus de connexion au réseau. Plus de contacts. Plus d’amis. Et littéralement plus de chambre d’hôtel. Mais, très vite, l’histoire va prendre un tournant inattendu et vous entrainer dans un space opera endiablé. Le second tome, « Mémoires Spectrales », est disponible et clôt le cycle. Il explique également la raison du nom « Idaho » (car moi, je n’avais pas compris la référence à Dune).
Pour terminer en beauté, l’incontournable Thierry Crouzet et le premier tome de son projet démentiel : « One Minute ». Parce que ça pète plus en anglais. Pas de héros. Pas de trame narrative traditionnelle. Ici, le lecteur est invité à vivre et à revivre la même minute de l’histoire de la planète. Celle où l’humanité a soudainement compris, de Paris à Bangkok et de New York à Ouagadougou, qu’elle n’était plus seule. Qu’elle était en contact avec une intelligence extra-terrestre.
Trois livres. Trois pays. Trois accents. Trois histoires. Trois futurs.
Bref, un triple cadeau dans un superbe coffret argenté, à commander chez votre libraire ou, si ce n’est pas possible, directement sur le site de l’éditeur. Mais soutenez votre librairie favorite, elle en a bien besoin !

Notez que Pascal Lovis, le grand mage mauve, fait également partie du coffret régional « Fantasy Suisse » avec Aequilegia Nox et Stéphane Paccaud. De la magie et de la fantasy qui sent bon la raclette.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
I’m happy to announce the release, last week, of Offpunk 2.0.
Offpunk is an offline-first command-line browser/RSS reader. You control it by typing command and it maintains a cache of all the networked resources to allow you to access them offline indefinitely.
If a non-cached resource is tentatively accessed, the URL is marked as to be fetched later. Running periodically "offpunk --sync" will fetch those resources and add them to your "tour" to remind you that you wanted to access it.
Screenshot
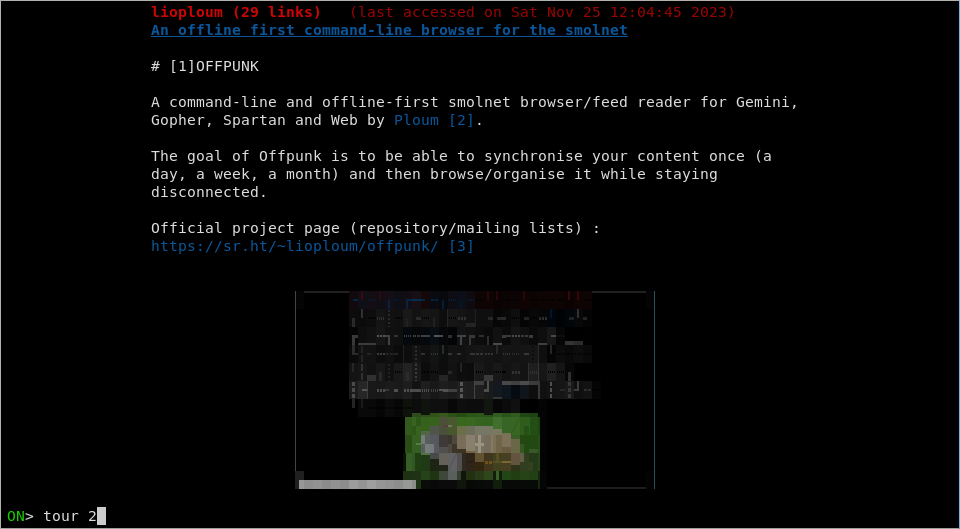
Switching the license to AGPLv3
Offpunk originally started as a branch then a friendly fork of AV-98. It was called AV-98-offline and, as such, shared the same BSD license.
During multiple discussions, Solderpunk and I came to the conclusion that AV-98-offline was becoming too different from the initial goal of AV-98. It was thus renamed Offpunk. At the same time, I grew increasingly convinced that we needed more copyleft software and that the AGPL license was better suited to protect the commons.
As a symbolic move, I’ve thus decided to switch Offpunk license from BSD to AGPLv3 but needed an opportunity to do so. The 2.0 release is such an opportunity.
Multiple independent tools
Like AV-98, Offpunk was one single big python file. I liked the simplicity of it. But it really became a mess and I wanted to offer Offpunk’s features as separate command-line tool. With Offpunk 2.0, you will thus have three new command-line tools:
- netcache : when given a URL, will download and cache this URL or only access the cache if the "--offline" option is provided.
- ansicat : will render an HTML, an RSS, a Gemtext or even a picture in your terminal, with various options.
- opnk : universal opener. Will try to render any file or any URL in your terminal. If it fails, it will fallback to xdg-open.
Those three commands should come with a man page and a "--help" but they are still quite new. To my own surprise, I found myself using "opnk" all the time. I don’t think anymore about how to handle a file, I simply give it to opnk.
Packaging those tools was a lot harder than expected and I want to thank all the contributors to this work, including Austreelis, David Zaslavsky and Jean Abou Samra.
Themes
The goal of Offpunk, through Ansicat, is to render web, RSS, gemini and gopher pages as coloured ANSI text in your terminal. Until now, those colours were hardcoded. With 2.0, they can be customised. See "help theme".
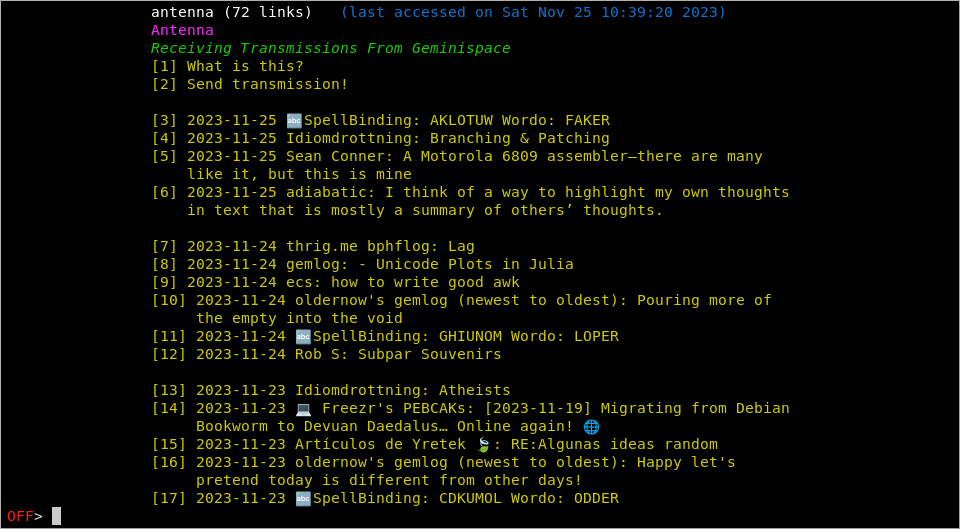
In offpunk, customisation can be made permanent by adding all the commands you want to run at startup in your .config/offpunk/offpunkrc file. Mine contains one single line: "offline", ensuring I use Offpunk only in offline mode.
Getting started
Using Offpunk daily as your main browsing/rss driver takes some learning. You need to get used to the Offpunk philosophy: adding elements to tour instead of clicking them, creating lists to read later, doing a daily synchronisation. It is not trivial.
The "help" command will probably be your best allies. The community also provide support on a user dedicated mailing-list.
If Offpunk becomes useful to you, the community is open. Contributions, documentation, blog post about how you use Offpunk, help to new users and packaging are warmly welcome. Sometimes, simple feedback is all it takes to make a developer happy. So don’t hesitate to contribute in one of our lists.
I’ve also started an experimental Matrix room on #offpunk:matrix.org. I have the belief that mailing-list is better suited for discussions but I’m giving this the benefit of doubt and willing to explore whether or not direct real-time discussion could help new users.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
I’m happy to announce the release, last week, of Offpunk 2.0.
Offpunk is an offline-first command-line browser/RSS reader. You control it by typing command and it maintains a cache of all the networked resources to allow you to access them offline indefinitely.
If a non-cached resource is tentatively accessed, the URL is marked as to be fetched later. Running periodically "offpunk --sync" will fetch those resources and add them to your "tour" to remind you that you wanted to access it.
Screenshot
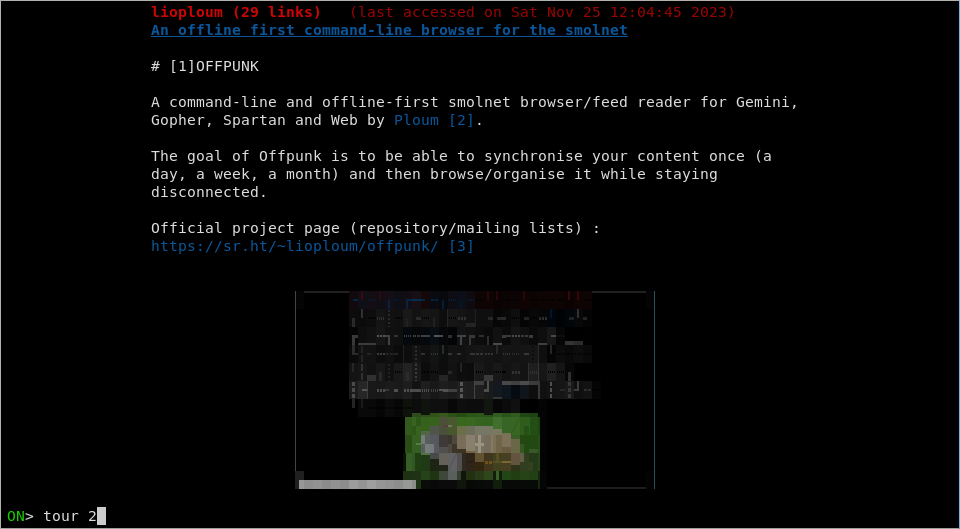
Switching the license to AGPLv3
Offpunk originally started as a branch then a friendly fork of AV-98. It was called AV-98-offline and, as such, shared the same BSD license.
During multiple discussions, Solderpunk and I came to the conclusion that AV-98-offline was becoming too different from the initial goal of AV-98. It was thus renamed Offpunk. At the same time, I grew increasingly convinced that we needed more copyleft software and that the AGPL license was better suited to protect the commons.
As a symbolic move, I’ve thus decided to switch Offpunk license from BSD to AGPLv3 but needed an opportunity to do so. The 2.0 release is such an opportunity.
Multiple independent tools
Like AV-98, Offpunk was one single big python file. I liked the simplicity of it. But it really became a mess and I wanted to offer Offpunk’s features as separate command-line tool. With Offpunk 2.0, you will thus have three new command-line tools:
- netcache : when given a URL, will download and cache this URL or only access the cache if the "--offline" option is provided.
- ansicat : will render an HTML, an RSS, a Gemtext or even a picture in your terminal, with various options.
- opnk : universal opener. Will try to render any file or any URL in your terminal. If it fails, it will fallback to xdg-open.
Those three commands should come with a man page and a "--help" but they are still quite new. To my own surprise, I found myself using "opnk" all the time. I don’t think anymore about how to handle a file, I simply give it to opnk.
Packaging those tools was a lot harder than expected and I want to thank all the contributors to this work, including Austreelis, David Zaslavsky and Jean Abou Samra.
Themes
The goal of Offpunk, through Ansicat, is to render web, RSS, gemini and gopher pages as coloured ANSI text in your terminal. Until now, those colours were hardcoded. With 2.0, they can be customised. See "help theme".
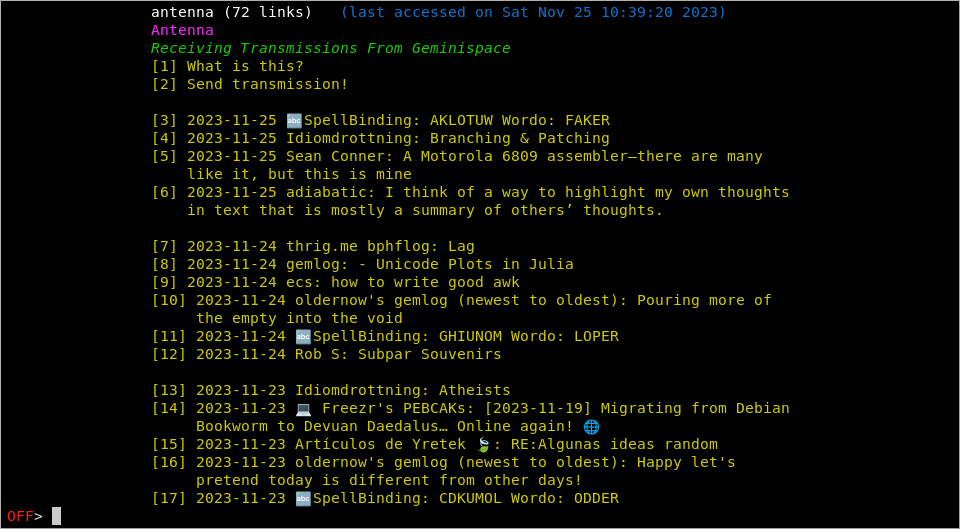
In offpunk, customisation can be made permanent by adding all the commands you want to run at startup in your .config/offpunk/offpunkrc file. Mine contains one single line: "offline", ensuring I use Offpunk only in offline mode.
Getting started
Using Offpunk daily as your main browsing/rss driver takes some learning. You need to get used to the Offpunk philosophy: adding elements to tour instead of clicking them, creating lists to read later, doing a daily synchronisation. It is not trivial.
The "help" command will probably be your best allies. The community also provide support on a user dedicated mailing-list.
If Offpunk becomes useful to you, the community is open. Contributions, documentation, blog post about how you use Offpunk, help to new users and packaging are warmly welcome. Sometimes, simple feedback is all it takes to make a developer happy. So don’t hesitate to contribute in one of our lists.
I’ve also started an experimental Matrix room on #offpunk:matrix.org. I have the belief that mailing-list is better suited for discussions but I’m giving this the benefit of doubt and willing to explore whether or not direct real-time discussion could help new users.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Maintaining a free software project is spending years of your life to solve a problem that would have taken several hours or even days without the software.
Which is, joke aside, an incredible contribution to the common good.
The time saved is multiplied by the number of users and quickly compound. They are saving time without the need to exchange their own time.
Free software offers free time, free life extension to many human living now and maybe in the future.
Instead of contributing to the economy, free software developers contribute to humanity. To the global progress.
Free software is about making our short lifetimes a common good instead of an economical product.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Maintaining a free software project is spending years of your life to solve a problem that would have taken several hours or even days without the software.
Which is, joke aside, an incredible contribution to the common good.
The time saved is multiplied by the number of users and quickly compound. They are saving time without the need to exchange their own time.
Free software offers free time, free life extension to many human living now and maybe in the future.
Instead of contributing to the economy, free software developers contribute to humanity. To the global progress.
Free software is about making our short lifetimes a common good instead of an economical product.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
S’il y’a bien un logiciel propriétaire difficile à lâcher, c’est Google Maps. Ou Waze, qui appartient également à Google. Pourquoi est-ce si compliqué de produire un logiciel de navigation libre ? Ayant passé quelques années dans cette industrie, je vais vous expliquer les différents composants d’un logiciel de navigation.
Les briques de base d’un logiciel de navigation sont la position, les données, le mapmatching, le routing, la recherche et les données temps réel. Pour chaque composant, je propose une explication et une analyse des solutions libres.
La position
Le premier composant est un système de positionnement qui va fournir une coordonnée géographique avec, parfois, un degré de précision. Une longitude et une latitude, tout simplement.
Il existe plusieurs manières d’estimer une position. Le plus connu est le GPS qui capte des ondes émises par les satellites du même nom. Contrairement à une idée tenace, votre téléphone n’émet rien lorsqu’il utilise le GPS, il se contente d’écouter les signaux GPS tout comme une radio FM écoute les ondes déjà présentes. Votre téléphone n’a de toute façon pas la puissance d’émettre jusqu’à un satellite. Les satellites GPS sont, au plus près, à 20.000 km de vous. Vous croyez que votre téléphone puisse envoyer un signal à 20.000 km ?
Pour simplifier à outrance, le principe d’un satellite GPS est d’émettre en permanence un signal avec l’heure qu’il est à son bord. Votre téléphone, en captant ce signal, compare cette heure avec sa propre horloge interne. Le décalage entre les deux permet de mesurer la distance entre le téléphone et le satellite, sachant que l’onde se déplace à la vitesse de la lumière, une onde radio n’étant que de la lumière dans un spectre invisible à l’œil humain. En refaisant cette opération pour trois satellites dont la position est connue, le téléphone peut, par triangulation, connaître sa position exacte.
Fait intéressant: ce calcul n’est possible qu’en connaissant la position des satellites GPS. Ces positions étant changeantes et difficilement prévisibles à long terme, elles sont envoyées par les satellites eux-mêmes, en plus de l’heure. On parle des « éphémérides ». Cependant, attendre l’envoi des éphémérides complètes peut prendre plusieurs minutes, le signal GPS ne pouvant envoyer que très peu de données.
C’est la raison pour laquelle un GPS éteint depuis longtemps mettra un long moment avant d’afficher sa position. Un GPS éteint depuis quelques heures seulement pourra réutiliser les éphémérides précédentes. Et pour votre smartphone, c’est encore plus facile : il profite de sa connexion 4G ou Wifi pour télécharger les éphémérides sur Internet et vous offrir un positionnement (un « fix ») quasi instantané.
Le système GPS appartient à l’armée américaine. Le concurrent russe s’appelle GLONASS et la version civile européenne Galileo. La plupart des appareils récents supportent les trois réseaux, mais ce n’est pas universel.
Même sans satellite, votre smartphone vous positionnera assez facilement en utilisant les bornes wifi et les appareils Bluetooth à proximité. De quelle manière ? C’est très simple : les appareils Google et Apple envoient, en permanence, à leur propriétaires respectifs (les deux entreprises susnommées) votre position GPS ainsi que la liste des wifi, appareils Bluetooth et NFC dans le voisinage. Le simple fait d’avoir cet engin nous transforme un espion au service de ces entreprises. En fait, de nombreux engins espionnent en permanence notre position pour revendre ces données.
Si on coupe le GPS d’un appareil Android Google, celui-ci se contentera d’envoyer une requête à Google sous la forme : « Dis, je ne connais pas ma position, mais je capte le wifi grandmaman64 et superpotes89 ainsi qu’une télé Samsung compatible Bluetooth, t’aurais pas une idée d’où je suis ? ». Réponse : « Ben justement, j’ai trois utilisateurs qui sont passés hier près de ces wifis et de cette télé, ils étaient dans la rue Machinchose. Donc tu es probablement dans la rue Machinchose. » Apple fait exactement pareil.
Quelle que soit la solution utilisée, GPS ou autre, la position d’un smartphone est fournie par le système d’exploitation et ne pose donc aucun problème au développeur d’application. C’est complètement transparent, mais l’obtention d’une position sera parfois légèrement plus longue sans les services Google ou Apple propriétaires décrits ci-dessus.
Les datas (données cartographiques)
Ce n’est pas tout d’avoir une position, encore faut-il savoir à quoi elle correspond. C’est le rôle des données cartographiques, souvent appelées "data" dans l’industrie.
Obtenir des données cartographiques est un boulot inimaginable qui, historiquement, impliquait de faire rouler des voitures sur toutes les routes d’un pays, croisant les données avec la cartographie officielle puis mêlant cela aux données satellites. Dans les années 2000, deux fournisseurs se partageaient un duopole (Navteq, acquis par Nokia en 2007 et TeleAtlas, acquis par Tomtom en 2008). Google Maps utilisait d’ailleurs souvent des données issues de ces fournisseurs (ainsi que tous les GPS de l’époque). Dans certaines régions, le logo Navteq était même visible sur la cartographie Google Maps. Mais plutôt que de payer une fortune à ces entreprises, Google a décidé de lancer sa propre base de données, envoyant ses propres voitures sur les routes (et profitant de l’occasion pour lancer Google Street View).
La toute grande difficulté des data, c’est qu’elles changent tout le temps. Les sentiers et les chemins se modifient. Des routes sont ouvertes. D’autres, fermées. Des constructions se font, des quartiers entiers apparaissent alors qu’une voie se retrouve à sens unique. Parcourir la campagne à vélo m’a appris que chaque jour peut être complètement différent. Des itinéraires deviennent soudainement impraticables pour cause de ronces, de fortes pluies ou de chutes d’arbres. D’autres apparaissent comme par magie. C’est un peu moins rapide pour les automobilistes, mais tentez de traverser l’Europe avec une carte d’une dizaine d’années et vous comprendrez votre douleur.
En parallèle de ces fournisseurs commerciaux est apparu le projet OpenStreetMap que personne ne voulait prendre au sérieux dans l’industrie. On m’a plusieurs fois ri au nez lorsque j’ai suggéré que cette solution était l’avenir. Tout comme Universalis ne prenait pas Wikipédia au sérieux.

Le résultat, nous le connaissons : OpenStreetMap est aujourd’hui la meilleure base de données cartographiques pour la plupart des cas d’usage courant. À tel point que les géants comme Waze n’hésitent pas à les repomper illégalement. Sebsauvage signale le cas d’un contributeur OSM qui a sciemment inventé un parc de toutes pièces. Ce parc s’est retrouvé sur Waze…
Mais les applications utilisant OpenStreetMap doivent faire face à un gros défi : soit demander à l’utilisateur de charger les cartes à l’avance et de les mettre à jour régulièrement, soit de les télécharger au fur et à mesure, ce qui rend l’utilisation peu pratique (comment calculer un itinéraire ou trouver une adresse dans une zone dont on n’a pas la carte ?). Le projet OpenStreetMaps est en effet financé essentiellement par les dons et ne peut offrir une infrastructure de serveurs répondant immédiatement à chaque requête, chose que Google peut confortablement se permettre.
Le mapmatching
Une fois qu’on a la carte et la position, il suffit d’afficher la position sur la carte, non ? Et bien ce n’est pas aussi simple. Tout d’abord parce que la planète est loin de correspondre à une surface plane. Il faut donc considérer la courbure de la terre et le relief. Mais, surtout, le GPS tout comme les données cartographiques peuvent avoir plusieurs mètres d’imprécision.
Le mapmatching consiste à tenter de faire coïncider les deux informations : si un GPS se déplace à 120km/h sur une ligne parallèle située à quelques mètres de l’autoroute, il est probablement sur l’autoroute ! Il faut donc corriger la position en fonction des données.
En ville, des hauts bâtiments peuvent parfois refléter le signal GPS et donc allonger le temps de parcours de celui-ci. Le téléphone croira alors être plus loin du satellite que ce n’est réellement le cas. Dans ce genre de situation, le mapmatching vous mettra dans une rue parallèle. Cela vous est peut-être déjà arrivé et c’est assez perturbant.
Une autre application du mapmatching, c’est de tenter de prédire la position future, par exemple dans un tunnel. La position GPS, de par son fonctionnement, introduit en effet une latence de quelques secondes. Dans une longue ligne droite, ce n’est pas dramatique. Mais quand il s’agit de savoir à quel embranchement d’un rond-point tourner, chaque seconde est importante.
Le logiciel peut alors tenter de prédire, en fonction de votre vitesse, votre position réelle. Parfois, ça foire. Comme lorsqu’il vous dit que vous avez déjà dépassé l’embranchement que vous devez prendre alors que ce n’est pas le cas. Ou qu’il vous dit de tourner dans trente mètres alors que vous êtes déjà passé.
La recherche
On a la position sur la carte qui est, le plus souvent, notre point de départ. Il manque un truc important: le point d’arrivée. Et pour trouver le point d’arrivée, il faut que l’utilisateur l’indique.
Les recherches géographiques sont très compliquées, car la manière dont nous écrivons les adresses n’a pas beaucoup de sens : on donne le nom de la rue avant de donner la ville avant de donner le pays ! Dans les voitures, la solution a été de forcer les utilisateurs à entrer leurs adresses à l’envers: pays, ville, rue, numéro. C’est plus logique, mais nous sommes tellement habitués à l’inverse que c’est contre-intuitif.
Le problème de la recherche dans une base de données est un problème très complexe. Avec les applications OpenStreetMap, la base de données est sur votre téléphone et votre recherche est calculée par le minuscule processeur de ce dernier.
Ici, Google possède un avantage concurrentiel incommensurable. Ce n’est pas votre téléphone qui fait la recherche, mais bien les gigantesques serveurs de Google. Tapez "rue Machinchose" et la requête est immédiatement envoyée à Google (qui en profite pour prendre note dans un coin, histoire de pouvoir utiliser ces informations pour mieux vous cibler avec des publicités). Les ordinateurs de Google étant tellement rapide, ils peuvent même tenter d’être intelligent: il y’a 12 rue Machinchose dans tout le pays, mais une MachinChause, avec une orthographe différente, dans un rayon de 10km, on va donc lui proposer celle-là. Surtout que, tient, nous avons en mémoire qu’il s’est rendu 7 fois dans cette rue au cours des trois dernières années, même sans utiliser le GPS.
Force est de constater que les applications libres qui font la recherche sur votre téléphone ne peuvent rivaliser en termes de rapidité et d’aisance. Pour les utiliser, il faut s’adapter, accepter de refaire la recherche avec des orthographes différentes et d’attendre les résultats.
Le routing
On a le départ, on a l’arrivée. Maintenant il s’agit de calculer la route, une opération appelée « routing ». Pour faire du routing, chaque tronçon de route va se voir attribuer différentes valeurs : longueur, temps estimé pour le parcourir, mais aussi potentiellement le prix (routes payantes), la beauté (si on veut proposer un trajet plus agréable), le type de revêtement, etc.
L’algorithme de routing va donc aligner tous les tronçons de route entre le départ et l’arrivée, traçant des centaines ou des milliers d’itinéraires possibles, calculant pour chaque itinéraire la valeur totale en additionnant les valeurs de chaque tronçon.
Il va ensuite sélectionner l’itinéraire avec la meilleure valeur totale. Si on veut le plus rapide, c’est le temps total estimé le plus court. Si on veut la distance, c’est la distance la plus courte, etc.
À mon époque, l’algorithme utilisé était le plus souvent de type « Bidirectionnal weighted A-star ». Cela signifie qu’on commence à la fois du départ et de l’arrivée, en explorant jusqu’au moment où les chemins se rencontrent et en abandonnant les chemins qui sont déjà de toute façon disqualifiés, car un plus court existe (oui, on peut aller de Bruxelles à Paris en passant par Amsterdam, mais ce n’est pas le plus efficace).
Une fois encore, le problème est particulièrement complexe et votre téléphone va prendre un temps énorme à calculer l’itinéraire. Alors que les serveurs de Google vont le faire pour vous. Google Maps ne fait donc aucun calcul sur votre téléphone : l’application se contente de demander aux serveurs Google de les faire à votre place. Ceux-ci centralisent les milliers d’itinéraires demandés par les utilisateurs et les réutilisent parfois sans tout recalculer. Quand on est un monopole, il n’y a pas de petits profits.
Les données temps réels
Mais si on veut le trajet le plus rapide en voiture, une évidence saute aux yeux: il faut éviter les embouteillages. Et les données concernant les embouteillages sont très difficiles à obtenir en temps réel.
Sauf si vous êtes un monopole qui se permet d’espionner une immense majorité de la population en temps réel. Il vous suffit alors, pour chaque tronçon de route, de prendre la vitesse moyenne des téléphones qui sont actuellement sur ce tronçon.
L’artiste Simon Weckert avait d’ailleurs illustré ce principe en promenant 99 smartphones connectés sur Google maps dans un chariot. Le résultat ? Une rue déserte est devenue un embouteillage sur Google Maps.

Là, force est de constater qu’il est difficile, voire impossible, de fournir ces données sans espionner massivement toute la population. À ce petit jeu, les alternatives libres ne pourront donc jamais égaler un monopole de surveillance comme celui de Google.
Mais tout n’est pas noir, car, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les infos trafic ne nous permettent pas d’aller plus vite. Elles donnent une illusion d’optimalité qui empire le trafic sur les itinéraires alternatifs et, au final, le temps perdu reste identique. Le seul avantage est que la prévision du temps de trajet est grandement améliorée.
- Une expérience du routing sur Organic Maps
- Une étude démontrant que les infotrafics ne font que modifier le problème sans le résoudre.
Ce résultat résulte de ce que j’appelle le paradoxe de l’embouteillage. C’est un fait bien connu des scientifiques et ignoré à dessein des politiciens que le trafic automobile est contre-intuitif. Au plus la route est large et permet à de nombreux véhicules de passer, au plus les embouteillages seront importants et la circulation chaotique. Si votre politicien propose de rajouter une bande sur le périphérique pour fluidifier la circulation, changez de politicien !
L’explication de ce phénomène tient au fait que lorsqu’il y’a un embouteillage sur le périphérique, ce n’est pas le périphérique qui bouche. C’est qu’il y’a plus de voitures qui rentrent sur le périphérique que de voitures qui en sortent. Or, les sorties restent et resteront toujours limitées par la taille des rues dans les villes.
En bref, un embouteillage est causé par le goulot d’étranglement, les parties les plus étroites qui sont, le plus souvent, les rues et ruelles des différentes destinations finales. Élargir le périphérique revient à élargir le large bout d’un entonnoir en espérant qu’il se vide plus vite. Et, de fait, cela rend les choses encore pires, car cela augmente le volume total de l’entonnoir, ce qui fait qu’il contient plus d’eau et mettra donc plus longtemps à se vider.

Les infotrafics et les itinéraires alternatifs proposés par Google Maps ne font pas autre chose que de rajouter une bande de trafic virtuelle (sous forme d’un itinéraire alternatif) et donc élargissent le haut de l’entonnoir. Les infos trafic restent utiles dans les cas particuliers où votre destination est complètement différente du reste de la circulation. Où si la congestion apparait brusquement, comme un accident : dans ce cas, vous pourriez avoir le bénéfice rare, mais enviable d’emprunter l’itinéraire de secours juste avant sa congestion.
La plupart du temps, les infotrafics sont globalement contre-productifs par le simple fait que tout le monde les utilise. Elles seraient parfaites si vous étiez la seule personne à en bénéficier. Mais comme tout le monde les utilise, vous êtes également obligé de les utiliser. Tout le monde y perd.
Leur impact premier est surtout psychologique: en jouant avec les itinéraires alternatifs, vous pouvez vous convaincre que vous n’avez pas d’autre choix que prendre votre mal en patience. Alors que, sans eux, vous serez persuadés qu’il y’a forcément une autre solution.
Les logiciels
Alors, se passer de Google Maps ? Comme nous l’avons vu, ce n’est pas évident. Le service Google Maps/Waze se base sur l’espionnage permanent et instantané de milliards d’utilisateurs, offrant une précision et une rapidité insurpassable. Quand on y pense, le coût de ce confort est particulièrement élevé. Et pourtant, Google Maps n’est pas la panacée.
J’ai personnellement un faible pour Organic Maps, que je trouve bien meilleur que Google Maps pour tout à l’exception du trafic routier : les itinéraires à pieds, en vélo et même en voiture hors des grands axes sont bien plus intéressants. Certes, il nécessite de télécharger les cartes. Inconvénient, selon moi, mineur, car permettant une utilisation même sans connexion. La recherche est, par contre, souvent frustrante et lente.
Mais le mieux est peut-être d’explorer les alternatives libres à Google Maps dans cet excellent article de Louis Derrac.
Et puis, pourquoi ne pas lutter contre la privatisation du bien commun qu’est la cartographie en apprenant à contribuer à OpenStreetMap ?
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
S’il y’a bien un logiciel propriétaire difficile à lâcher, c’est Google Maps. Ou Waze, qui appartient également à Google. Pourquoi est-ce si compliqué de produire un logiciel de navigation libre ? Ayant passé quelques années dans cette industrie, je vais vous expliquer les différents composants d’un logiciel de navigation.
Les briques de base d’un logiciel de navigation sont la position, les données, le mapmatching, le routing, la recherche et les données temps réel. Pour chaque composant, je propose une explication et une analyse des solutions libres.
La position
Le premier composant est un système de positionnement qui va fournir une coordonnée géographique avec, parfois, un degré de précision. Une longitude et une latitude, tout simplement.
Il existe plusieurs manières d’estimer une position. Le plus connu est le GPS qui capte des ondes émises par les satellites du même nom. Contrairement à une idée tenace, votre téléphone n’émet rien lorsqu’il utilise le GPS, il se contente d’écouter les signaux GPS tout comme une radio FM écoute les ondes déjà présentes. Votre téléphone n’a de toute façon pas la puissance d’émettre jusqu’à un satellite. Les satellites GPS sont, au plus près, à 20.000 km de vous. Vous croyez que votre téléphone puisse envoyer un signal à 20.000 km ?
Pour simplifier à outrance, le principe d’un satellite GPS est d’émettre en permanence un signal avec l’heure qu’il est à son bord. Votre téléphone, en captant ce signal, compare cette heure avec sa propre horloge interne. Le décalage entre les deux permet de mesurer la distance entre le téléphone et le satellite, sachant que l’onde se déplace à la vitesse de la lumière, une onde radio n’étant que de la lumière dans un spectre invisible à l’œil humain. En refaisant cette opération pour trois satellites dont la position est connue, le téléphone peut, par triangulation, connaître sa position exacte.
Fait intéressant: ce calcul n’est possible qu’en connaissant la position des satellites GPS. Ces positions étant changeantes et difficilement prévisibles à long terme, elles sont envoyées par les satellites eux-mêmes, en plus de l’heure. On parle des « éphémérides ». Cependant, attendre l’envoi des éphémérides complètes peut prendre plusieurs minutes, le signal GPS ne pouvant envoyer que très peu de données.
C’est la raison pour laquelle un GPS éteint depuis longtemps mettra un long moment avant d’afficher sa position. Un GPS éteint depuis quelques heures seulement pourra réutiliser les éphémérides précédentes. Et pour votre smartphone, c’est encore plus facile : il profite de sa connexion 4G ou Wifi pour télécharger les éphémérides sur Internet et vous offrir un positionnement (un « fix ») quasi instantané.
Le système GPS appartient à l’armée américaine. Le concurrent russe s’appelle GLONASS et la version civile européenne Galileo. La plupart des appareils récents supportent les trois réseaux, mais ce n’est pas universel.
Même sans satellite, votre smartphone vous positionnera assez facilement en utilisant les bornes wifi et les appareils Bluetooth à proximité. De quelle manière ? C’est très simple : les appareils Google et Apple envoient, en permanence, à leur propriétaires respectifs (les deux entreprises susnommées) votre position GPS ainsi que la liste des wifi, appareils Bluetooth et NFC dans le voisinage. Le simple fait d’avoir cet engin nous transforme un espion au service de ces entreprises. En fait, de nombreux engins espionnent en permanence notre position pour revendre ces données.
Si on coupe le GPS d’un appareil Android Google, celui-ci se contentera d’envoyer une requête à Google sous la forme : « Dis, je ne connais pas ma position, mais je capte le wifi grandmaman64 et superpotes89 ainsi qu’une télé Samsung compatible Bluetooth, t’aurais pas une idée d’où je suis ? ». Réponse : « Ben justement, j’ai trois utilisateurs qui sont passés hier près de ces wifis et de cette télé, ils étaient dans la rue Machinchose. Donc tu es probablement dans la rue Machinchose. » Apple fait exactement pareil.
Quelle que soit la solution utilisée, GPS ou autre, la position d’un smartphone est fournie par le système d’exploitation et ne pose donc aucun problème au développeur d’application. C’est complètement transparent, mais l’obtention d’une position sera parfois légèrement plus longue sans les services Google ou Apple propriétaires décrits ci-dessus.
Les datas (données cartographiques)
Ce n’est pas tout d’avoir une position, encore faut-il savoir à quoi elle correspond. C’est le rôle des données cartographiques, souvent appelées "data" dans l’industrie.
Obtenir des données cartographiques est un boulot inimaginable qui, historiquement, impliquait de faire rouler des voitures sur toutes les routes d’un pays, croisant les données avec la cartographie officielle puis mêlant cela aux données satellites. Dans les années 2000, deux fournisseurs se partageaient un duopole (Navteq, acquis par Nokia en 2007 et TeleAtlas, acquis par Tomtom en 2008). Google Maps utilisait d’ailleurs souvent des données issues de ces fournisseurs (ainsi que tous les GPS de l’époque). Dans certaines régions, le logo Navteq était même visible sur la cartographie Google Maps. Mais plutôt que de payer une fortune à ces entreprises, Google a décidé de lancer sa propre base de données, envoyant ses propres voitures sur les routes (et profitant de l’occasion pour lancer Google Street View).
La toute grande difficulté des data, c’est qu’elles changent tout le temps. Les sentiers et les chemins se modifient. Des routes sont ouvertes. D’autres, fermées. Des constructions se font, des quartiers entiers apparaissent alors qu’une voie se retrouve à sens unique. Parcourir la campagne à vélo m’a appris que chaque jour peut être complètement différent. Des itinéraires deviennent soudainement impraticables pour cause de ronces, de fortes pluies ou de chutes d’arbres. D’autres apparaissent comme par magie. C’est un peu moins rapide pour les automobilistes, mais tentez de traverser l’Europe avec une carte d’une dizaine d’années et vous comprendrez votre douleur.
En parallèle de ces fournisseurs commerciaux est apparu le projet OpenStreetMap que personne ne voulait prendre au sérieux dans l’industrie. On m’a plusieurs fois ri au nez lorsque j’ai suggéré que cette solution était l’avenir. Tout comme Universalis ne prenait pas Wikipédia au sérieux.

Le résultat, nous le connaissons : OpenStreetMap est aujourd’hui la meilleure base de données cartographiques pour la plupart des cas d’usage courant. À tel point que les géants comme Waze n’hésitent pas à les repomper illégalement. Sebsauvage signale le cas d’un contributeur OSM qui a sciemment inventé un parc de toutes pièces. Ce parc s’est retrouvé sur Waze…
Mais les applications utilisant OpenStreetMap doivent faire face à un gros défi : soit demander à l’utilisateur de charger les cartes à l’avance et de les mettre à jour régulièrement, soit de les télécharger au fur et à mesure, ce qui rend l’utilisation peu pratique (comment calculer un itinéraire ou trouver une adresse dans une zone dont on n’a pas la carte ?). Le projet OpenStreetMaps est en effet financé essentiellement par les dons et ne peut offrir une infrastructure de serveurs répondant immédiatement à chaque requête, chose que Google peut confortablement se permettre.
Le mapmatching
Une fois qu’on a la carte et la position, il suffit d’afficher la position sur la carte, non ? Et bien ce n’est pas aussi simple. Tout d’abord parce que la planète est loin de correspondre à une surface plane. Il faut donc considérer la courbure de la terre et le relief. Mais, surtout, le GPS tout comme les données cartographiques peuvent avoir plusieurs mètres d’imprécision.
Le mapmatching consiste à tenter de faire coïncider les deux informations : si un GPS se déplace à 120km/h sur une ligne parallèle située à quelques mètres de l’autoroute, il est probablement sur l’autoroute ! Il faut donc corriger la position en fonction des données.
En ville, des hauts bâtiments peuvent parfois refléter le signal GPS et donc allonger le temps de parcours de celui-ci. Le téléphone croira alors être plus loin du satellite que ce n’est réellement le cas. Dans ce genre de situation, le mapmatching vous mettra dans une rue parallèle. Cela vous est peut-être déjà arrivé et c’est assez perturbant.
Une autre application du mapmatching, c’est de tenter de prédire la position future, par exemple dans un tunnel. La position GPS, de par son fonctionnement, introduit en effet une latence de quelques secondes. Dans une longue ligne droite, ce n’est pas dramatique. Mais quand il s’agit de savoir à quel embranchement d’un rond-point tourner, chaque seconde est importante.
Le logiciel peut alors tenter de prédire, en fonction de votre vitesse, votre position réelle. Parfois, ça foire. Comme lorsqu’il vous dit que vous avez déjà dépassé l’embranchement que vous devez prendre alors que ce n’est pas le cas. Ou qu’il vous dit de tourner dans trente mètres alors que vous êtes déjà passé.
La recherche
On a la position sur la carte qui est, le plus souvent, notre point de départ. Il manque un truc important: le point d’arrivée. Et pour trouver le point d’arrivée, il faut que l’utilisateur l’indique.
Les recherches géographiques sont très compliquées, car la manière dont nous écrivons les adresses n’a pas beaucoup de sens : on donne le nom de la rue avant de donner la ville avant de donner le pays ! Dans les voitures, la solution a été de forcer les utilisateurs à entrer leurs adresses à l’envers: pays, ville, rue, numéro. C’est plus logique, mais nous sommes tellement habitués à l’inverse que c’est contre-intuitif.
Le problème de la recherche dans une base de données est un problème très complexe. Avec les applications OpenStreetMap, la base de données est sur votre téléphone et votre recherche est calculée par le minuscule processeur de ce dernier.
Ici, Google possède un avantage concurrentiel incommensurable. Ce n’est pas votre téléphone qui fait la recherche, mais bien les gigantesques serveurs de Google. Tapez "rue Machinchose" et la requête est immédiatement envoyée à Google (qui en profite pour prendre note dans un coin, histoire de pouvoir utiliser ces informations pour mieux vous cibler avec des publicités). Les ordinateurs de Google étant tellement rapide, ils peuvent même tenter d’être intelligent: il y’a 12 rue Machinchose dans tout le pays, mais une MachinChause, avec une orthographe différente, dans un rayon de 10km, on va donc lui proposer celle-là. Surtout que, tient, nous avons en mémoire qu’il s’est rendu 7 fois dans cette rue au cours des trois dernières années, même sans utiliser le GPS.
Force est de constater que les applications libres qui font la recherche sur votre téléphone ne peuvent rivaliser en termes de rapidité et d’aisance. Pour les utiliser, il faut s’adapter, accepter de refaire la recherche avec des orthographes différentes et d’attendre les résultats.
Le routing
On a le départ, on a l’arrivée. Maintenant il s’agit de calculer la route, une opération appelée « routing ». Pour faire du routing, chaque tronçon de route va se voir attribuer différentes valeurs : longueur, temps estimé pour le parcourir, mais aussi potentiellement le prix (routes payantes), la beauté (si on veut proposer un trajet plus agréable), le type de revêtement, etc.
L’algorithme de routing va donc aligner tous les tronçons de route entre le départ et l’arrivée, traçant des centaines ou des milliers d’itinéraires possibles, calculant pour chaque itinéraire la valeur totale en additionnant les valeurs de chaque tronçon.
Il va ensuite sélectionner l’itinéraire avec la meilleure valeur totale. Si on veut le plus rapide, c’est le temps total estimé le plus court. Si on veut la distance, c’est la distance la plus courte, etc.
À mon époque, l’algorithme utilisé était le plus souvent de type « Bidirectionnal weighted A-star ». Cela signifie qu’on commence à la fois du départ et de l’arrivée, en explorant jusqu’au moment où les chemins se rencontrent et en abandonnant les chemins qui sont déjà de toute façon disqualifiés, car un plus court existe (oui, on peut aller de Bruxelles à Paris en passant par Amsterdam, mais ce n’est pas le plus efficace).
Une fois encore, le problème est particulièrement complexe et votre téléphone va prendre un temps énorme à calculer l’itinéraire. Alors que les serveurs de Google vont le faire pour vous. Google Maps ne fait donc aucun calcul sur votre téléphone : l’application se contente de demander aux serveurs Google de les faire à votre place. Ceux-ci centralisent les milliers d’itinéraires demandés par les utilisateurs et les réutilisent parfois sans tout recalculer. Quand on est un monopole, il n’y a pas de petits profits.
Les données temps réels
Mais si on veut le trajet le plus rapide en voiture, une évidence saute aux yeux: il faut éviter les embouteillages. Et les données concernant les embouteillages sont très difficiles à obtenir en temps réel.
Sauf si vous êtes un monopole qui se permet d’espionner une immense majorité de la population en temps réel. Il vous suffit alors, pour chaque tronçon de route, de prendre la vitesse moyenne des téléphones qui sont actuellement sur ce tronçon.
L’artiste Simon Weckert avait d’ailleurs illustré ce principe en promenant 99 smartphones connectés sur Google maps dans un chariot. Le résultat ? Une rue déserte est devenue un embouteillage sur Google Maps.

Là, force est de constater qu’il est difficile, voire impossible, de fournir ces données sans espionner massivement toute la population. À ce petit jeu, les alternatives libres ne pourront donc jamais égaler un monopole de surveillance comme celui de Google.
Mais tout n’est pas noir, car, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les infos trafic ne nous permettent pas d’aller plus vite. Elles donnent une illusion d’optimalité qui empire le trafic sur les itinéraires alternatifs et, au final, le temps perdu reste identique. Le seul avantage est que la prévision du temps de trajet est grandement améliorée.
- Une expérience du routing sur Organic Maps
- Une étude démontrant que les infotrafics ne font que modifier le problème sans le résoudre.
Ce résultat résulte de ce que j’appelle le paradoxe de l’embouteillage. C’est un fait bien connu des scientifiques et ignoré à dessein des politiciens que le trafic automobile est contre-intuitif. Au plus la route est large et permet à de nombreux véhicules de passer, au plus les embouteillages seront importants et la circulation chaotique. Si votre politicien propose de rajouter une bande sur le périphérique pour fluidifier la circulation, changez de politicien !
L’explication de ce phénomène tient au fait que lorsqu’il y’a un embouteillage sur le périphérique, ce n’est pas le périphérique qui bouche. C’est qu’il y’a plus de voitures qui rentrent sur le périphérique que de voitures qui en sortent. Or, les sorties restent et resteront toujours limitées par la taille des rues dans les villes.
En bref, un embouteillage est causé par le goulot d’étranglement, les parties les plus étroites qui sont, le plus souvent, les rues et ruelles des différentes destinations finales. Élargir le périphérique revient à élargir le large bout d’un entonnoir en espérant qu’il se vide plus vite. Et, de fait, cela rend les choses encore pires, car cela augmente le volume total de l’entonnoir, ce qui fait qu’il contient plus d’eau et mettra donc plus longtemps à se vider.

Les infotrafics et les itinéraires alternatifs proposés par Google Maps ne font pas autre chose que de rajouter une bande de trafic virtuelle (sous forme d’un itinéraire alternatif) et donc élargissent le haut de l’entonnoir. Les infos trafic restent utiles dans les cas particuliers où votre destination est complètement différente du reste de la circulation. Où si la congestion apparait brusquement, comme un accident : dans ce cas, vous pourriez avoir le bénéfice rare, mais enviable d’emprunter l’itinéraire de secours juste avant sa congestion.
La plupart du temps, les infotrafics sont globalement contre-productifs par le simple fait que tout le monde les utilise. Elles seraient parfaites si vous étiez la seule personne à en bénéficier. Mais comme tout le monde les utilise, vous êtes également obligé de les utiliser. Tout le monde y perd.
Leur impact premier est surtout psychologique: en jouant avec les itinéraires alternatifs, vous pouvez vous convaincre que vous n’avez pas d’autre choix que prendre votre mal en patience. Alors que, sans eux, vous serez persuadés qu’il y’a forcément une autre solution.
Les logiciels
Alors, se passer de Google Maps ? Comme nous l’avons vu, ce n’est pas évident. Le service Google Maps/Waze se base sur l’espionnage permanent et instantané de milliards d’utilisateurs, offrant une précision et une rapidité insurpassable. Quand on y pense, le coût de ce confort est particulièrement élevé. Et pourtant, Google Maps n’est pas la panacée.
J’ai personnellement un faible pour Organic Maps, que je trouve bien meilleur que Google Maps pour tout à l’exception du trafic routier : les itinéraires à pieds, en vélo et même en voiture hors des grands axes sont bien plus intéressants. Certes, il nécessite de télécharger les cartes. Inconvénient, selon moi, mineur, car permettant une utilisation même sans connexion. La recherche est, par contre, souvent frustrante et lente.
Mais le mieux est peut-être d’explorer les alternatives libres à Google Maps dans cet excellent article de Louis Derrac.
Et puis, pourquoi ne pas lutter contre la privatisation du bien commun qu’est la cartographie en apprenant à contribuer à OpenStreetMap ?
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Extrait de mon journal du 21 octobre 2023.

Les photos étaient une manière de garder la trace d’un événement. C’en est désormais devenu l’objectif premier. Plutôt que de nous souvenir de ce que nous avons vécu, nous créons de toutes pièces des faux souvenirs, de fausses memorabilia afin de tromper notre futur moi.
Nous souffrons une journée entière à faire la file dans un Disneyland bondé afin de pouvoir, dans cinq ou dix ans, prétendre que nos sourires étaient sincères, que notre amusement était réel.
D’ailleurs, cela nous sera confirmé par tous ceux qui ont reçu nos photos dans les heures, parfois les secondes après la prise de vue. Nos followers sont les faux témoins que nous achetons, que nous corrompons afin de nous inventer des souvenirs.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Extrait de mon journal du 21 octobre 2023.

Les photos étaient une manière de garder la trace d’un événement. C’en est désormais devenu l’objectif premier. Plutôt que de nous souvenir de ce que nous avons vécu, nous créons de toutes pièces des faux souvenirs, de fausses memorabilia afin de tromper notre futur moi.
Nous souffrons une journée entière à faire la file dans un Disneyland bondé afin de pouvoir, dans cinq ou dix ans, prétendre que nos sourires étaient sincères, que notre amusement était réel.
D’ailleurs, cela nous sera confirmé par tous ceux qui ont reçu nos photos dans les heures, parfois les secondes après la prise de vue. Nos followers sont les faux témoins que nous achetons, que nous corrompons afin de nous inventer des souvenirs.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Je suis complètement addict aux réseaux sociaux. Je suis complètement obnubilé par mon image sur ceux-ci. Pendant des années, dès qu’une nouvelle plateforme apparaissait, j’y créais un compte "@ploum" histoire de « garder le contrôle » sur mon pseudonyme. Je tenais les comptes de mes followers sur chacune. Je me présentais comme « @ploum » dans le premier slide de mes conférences.
Il y a déjà un an, Elon Musk prenait les rênes de Twitter, le renommait en « X-anciennement-Twitter » et le transformait, d’après les témoignages que j’en ai, en une soupe nauséabonde. Je dis « d’après les témoignages » parce qu’à l’époque, cela faisait justement un an que j’avais supprimé mon compte.
Si j’ai supprimé mon compte, avant même l’arrivée d’Elon Musk, il y’a des chances que vous puissiez supprimer le vôtre également. Et peut-être pas seulement sur Twitter.
Je parle bien de le supprimer, pas de ne « plus l’utiliser » ou « le mettre en sommeil ». Je suis passé par là également et cela n’a rien à voir. C’est comme les personnes, dont la télé trône au milieu du salon, mais qui disent ne pas la regarder. Ou rarement. Enfin… pas trop souvent. Enfin, juste quand on s’ennuie. Ou quand il y’a un truc intéressant… Et puis aussi pour avoir une présence.
En supprimant mon compte, j’ai retiré un utilisateur de la plateforme et fait baisser sa valeur. J’ai supprimé toute possibilité de me contacter sur ces plateformes, possibilité qui faisait que, même si je n’utilisais plus un service, je m’y connectais une fois par mois pour répondre aux messages qui arrivaient forcément là-bas, car, si compte il y a, il y’aura toujours quelqu’un pour l’utiliser.
En supprimant mon compte, je suis devenu injoignable sur cette plateforme. Ce qui rend la plateforme un tout petit peu moins attractive pour mon entourage et ceux qui me suivent. Ce qui fait que la plateforme ne pourra pas montrer mon nom dans la liste de contacts lorsqu’une personne qui a mon numéro de téléphone s’inscrira pour la première fois. J’ai également supprimé un follower de tous ces créateurs que j’aime, mais qui sont, comme moi, un peu trop addicts aux likes.
Bref, en supprimant mon compte Twitter, j’ai rendu le monde un poil meilleur.
Oui, mais si on veut te contacter via cette plateforme
Si on veut me contacter, supprimer mon compte est la meilleure des choses. Parce que personne ne tentera de me contacter sur une plateforme où je ne suis pas. Personne ne pensera que j’ai reçu le message.
Comme je l’expliquais, les réseaux sociaux publicitaires ne nous mettent pas en relation, ils nous vendent l’illusion d’être en relation. En faisant parfois exactement le contraire.
Pour le cas d’un groupe particulier utilisant une plateforme, c’est souvent difficile d’être le premier à quitter. J’ai souvent eu l’impression de m’exclure des groupes qui n’étaient pas techniques (les différents sports que je pratique dans mon cas). J’ai signalé à plusieurs personnes que je ne recevais pas les infos. J’ai rappelé que je n’étais pas sur la plateforme utilisée, Facebook, Twitter ou Whatsapp. J’ai demandé à certains de me faire suivre les messages.
Cela a été difficile jusqu’au moment où une deuxième personne s’est révélée ne pas être non plus sur la plateforme. Soit qu’elle l’ait quittée, soit qu’elle ne l’ait jamais été. À partir de ce moment-là, les membres du groupe prennent conscience que la plateforme n’est plus représentative du groupe. Et l’intérêt pour la plateforme diminue pour disparaitre totalement avec la troisième personne qui n’y est pas non plus.
Être le premier est difficile et pas toujours possible dans un groupe. Mais si vous ne savez pas être le premier, soutenez toute autre tentative et soyez le second.
Oui, mais on peut usurper ton identité.
Sur Twitter, je disposais d’un compte vérifié (et ce depuis plusieurs années, à une époque où c’était encore rare et une source de frime), un compte créé en 2007 avec presque 7000 followers. J’y étais attaché. J’en étais fier même si avoir un nombre de followers à 4 chiffres est un peu la gêne chez les influenceurs de la nouvelle génération.
Avant de supprimer mon compte, je l’ai annoncé. À tous les messages qui arrivaient pendant une semaine ou quelques jours, j’ai répondu que ce compte allait être supprimé. Je l’ai également annoncé sur mon site et sur Mastodon.
Il est important de rappeler qu’à la suppression d’un compte Twitter, le pseudo est bloqué pendant un an. Pendant un an, personne ne peut l’utiliser.
Un an plus tard, quelqu’un pourrait en effet utiliser votre identifiant. C’est arrivé avec @ploum, un an jour pour jour après la suppression du compte. Le nouveau compte @ploum n’a rien à voir avec moi et ne peut en aucun cas être confondu avec moi.
Oui, ma petite notoriété m’a déjà fait subir des attaques voire du harcèlement. Oui, j’ai déjà vu des faux ploum se faire passer pour moi, ce qui a motivé d’ailleurs à l’époque ma vérification par Twitter. Pourtant, la probabilité que l’identifiant soit réutilisé par une personne qui me connait et est motivée pour me nuire était tout de même très faible. Parce que, honnêtement, tout le monde s’en fout de mon compte Twitter. Surtout quand il faut attendre un an après sa disparition.
Mais admettons que ce soit le cas. Un compte Twitter serait apparu qui aurait repris mon pseudo et un avatar crédible avant de commencer à raconter des atrocités en se faisant passer pour moi.
Et alors ?
Ce genre de compte a toujours été possible en jouant sur de subtiles variations orthographiques. On pourrait imaginer @pl0um, @ploom, @p1oum, … Cela fait un an que mon compte avait disparu, il n’est plus référencé sur mon site ni dans aucune bio, il a 0 follower. Quelle est la crédibilité d’un faux compte ?
Ne pas supprimer son compte Twitter par peur d’usurpation d’identité, c’est reconnaître à Twitter un pouvoir énorme, un pouvoir étatique : celui d’assigner l’identité des individus. Reconnaissez-vous Elon Musk comme garant de votre identité ? Si non, il est urgent de supprimer votre compte. Et si oui, rappelez-vous que Musk peut s’arroger de prendre votre identifiant à sa guise. Il l’a déjà fait.
Ce genre d’argument, que j’entends très souvent, me fait également souvent sourire parce que, en toute honnêteté, qui est suffisamment important pour qu’on veuille usurper son identité sur Twitter ? Et quels problèmes de cette situation très hypothétique ne pourraient pas être réglés par un simple « Ce compte Twitter se fait passer pour moi, mais ce n’est pas moi » sur vos autres plateformes et sur votre site ? Franchement, au rythme où ça va, vous pensez vraiment qu’il y’aura quoi que ce soit de crédible sur Twitter dans un an ? Si votre identité numérique est importante, investissez dans un nom de domaine avant toute chose !
L’inventeur, auteur et technologiste Jaron Lanier, par exemple, n’a jamais eu de compte sur aucun réseau social. Il a d’ailleurs écrit un livre très court pour vous convaincre d’effacer vos comptes. Pourtant, il y’a plusieurs comptes à son nom, certains portant même la mention « officiel ». Il se contente de dire sur son site que ces comptes ne sont pas de lui. Point à la ligne, problème réglé.
OK, toi tu l’as fait, mais moi je vais perdre ma communauté et mon audience
Comme le raconte Cory Doctorow, votre audience Twitter a déjà disparu. Ce n’est qu’un chiffre. Le média NPR a supprimé son compte Twitter et ses visites ont baissé de moins de 1%. Cory Doctorow a 10 fois plus de followers sur Twitter que sur Mastodon. Mais quand on parle des partages et des réponses, le ratio s’inverse. Mastodon est clairement beaucoup plus actif.
La même expérience vient d’être menée involontairement par l’application Signal. Le compte Twitter officiel de Signal, 600k followers, a en effet réagi à l’annonce d’une faille de sécurité.
Ce message a fait la première page du populaire site Hacker News et a donc été vu beaucoup de fois, y compris par des gens ne suivant pas le compte Signal sur Twitter.
5h plus tard, alors que le message Twitter faisait déjà le buzz, Signal a reposté le contenu sur son compte Mastodon, qui n’a « que » 40k followers (15 fois moins).
Pourtant, à l’heure où j’écris ces lignes, le nombre de partages est incroyablement identique (641 contre 615). Le nombre de réponses est également très similaire (30 contre 23). Et si on retire les "lol", les memes et autres réponses de moins de cinq mots, on peut même arriver à la conclusion que le fameux « engagement » sur Twitter est à peu près nul. (UPDATE: une semaine plus tard, le nombre de partages est passé à 1100 sur Mastodon pour 900 sur Twitter)
L’écrivain Henri Lœvenbruck a également supprimé complètement son compte Twitter et sa page Facebook en 2022. Il est pourtant connu et vit de sa notoriété. Son roman « Les disparus de Blackmore », publié quelques mois après cette suppression, s’est mieux vendu que le précédent. Nul ne saura jamais s’il aurait pu en vendre encore plus en étant sur Facebook ou Twitter. Mais la preuve est faite que cette présence n’est absolument pas indispensable.
Je le dis et le redis : le nombre de followers est faux. C’est une information qui est conçue dans l’optique de vous tromper.
Oui, vous avez le droit de supprimer vos comptes
Le sentiment de m’être fait avoir en créant des comptes sur Twitter, Facebook et autres Medium est fort. Mais ma seule erreur a été de croire les promesses de cette industrie. Ce n’est pas moi qui me suis trompé, ce sont les plateformes qui nous ont menti. Certains le prédisaient déjà à l’époque et me traitaient de naïf. Je ne les ai pas écoutés, je m’en excuse auprès d’eux. J’ai parfois argué « qu’il fallait aller où les gens étaient », devenant moi-même un allié de ces plateformes. Je vous ai encouragé, vous qui me lisez depuis des années, à m’y rejoindre, contribuant à leur emprise. Je m’en excuse profondément auprès de vous.
Ne pas déceler un mensonge est une erreur. À ma décharge, c’est une erreur qui peut arriver à tout le monde.
Mais aujourd’hui, le mensonge est éclatant. Il est indéniable. Recommanderais-je à mes amis de s’inscrire sur ces plateformes ? Serais-je d’accord que mes enfants s’y inscrivent ? Si la réponse est non à l’une de ces questions, garder un compte sur ces plateformes n’est plus excusable.
Nous sommes le composant essentiel des plateformes centralisées. Si nous n’aimons pas ce qu’elles sont ou ce qu’elles deviennent, si leurs valeurs sont en contradiction avec les nôtres, notre devoir est de les quitter, de les assécher, pas de lutter pour les améliorer.
Ne pas réagir et continuer à se laisser faire lorsque le mensonge est flagrant n’est pas une erreur, c’est à la limite de la complicité. C’est encore plus le cas pour les organisations et les militants qui prétendent soutenir des valeurs opposées à celles de la plateforme. On ne peut pas lutter contre le capitalo-consumérisme sur Facebook ni contre l’extrême droite sur Twitter. Le prétendre n’est qu’hypocrisie intellectuelle.
Et j’en ai été le premier coupable.
Aujourd’hui, je tente de réparer mes erreurs du passé en vous demandant, à vous mes amis qui lisez ceci, de supprimer vos comptes sur ces réseaux sociaux publicitaires. Je peux vous rassurer : non, vous n’allez que peu ou prou manquer des choses importantes. Oui, ça sera dur au début, mais ça ira de mieux en mieux. Et peut-être que vous allez y gagner beaucoup plus que ce que vous imaginez.
Oui mes amis, vous avez le droit, vous avez le devoir de supprimer vos comptes !
PS : Je dédie ce post à Henri Lœvenbruck, cité plus haut dans cet article. Cela fait un an jour pour jour que t’es arrivé sur Mastodon. J’en suis heureux pour toutes les expériences vécues ensemble cette année et dans les prochaines. Joyeux mastanniversaire mon ami !
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Je suis complètement addict aux réseaux sociaux. Je suis complètement obnubilé par mon image sur ceux-ci. Pendant des années, dès qu’une nouvelle plateforme apparaissait, j’y créais un compte "@ploum" histoire de « garder le contrôle » sur mon pseudonyme. Je tenais les comptes de mes followers sur chacune. Je me présentais comme « @ploum » dans le premier slide de mes conférences.
Il y a déjà un an, Elon Musk prenait les rênes de Twitter, le renommait en « X-anciennement-Twitter » et le transformait, d’après les témoignages que j’en ai, en une soupe nauséabonde. Je dis « d’après les témoignages » parce qu’à l’époque, cela faisait justement un an que j’avais supprimé mon compte.
Si j’ai supprimé mon compte, avant même l’arrivée d’Elon Musk, il y’a des chances que vous puissiez supprimer le vôtre également. Et peut-être pas seulement sur Twitter.
Je parle bien de le supprimer, pas de ne « plus l’utiliser » ou « le mettre en sommeil ». Je suis passé par là également et cela n’a rien à voir. C’est comme les personnes, dont la télé trône au milieu du salon, mais qui disent ne pas la regarder. Ou rarement. Enfin… pas trop souvent. Enfin, juste quand on s’ennuie. Ou quand il y’a un truc intéressant… Et puis aussi pour avoir une présence.
En supprimant mon compte, j’ai retiré un utilisateur de la plateforme et fait baisser sa valeur. J’ai supprimé toute possibilité de me contacter sur ces plateformes, possibilité qui faisait que, même si je n’utilisais plus un service, je m’y connectais une fois par mois pour répondre aux messages qui arrivaient forcément là-bas, car, si compte il y a, il y’aura toujours quelqu’un pour l’utiliser.
En supprimant mon compte, je suis devenu injoignable sur cette plateforme. Ce qui rend la plateforme un tout petit peu moins attractive pour mon entourage et ceux qui me suivent. Ce qui fait que la plateforme ne pourra pas montrer mon nom dans la liste de contacts lorsqu’une personne qui a mon numéro de téléphone s’inscrira pour la première fois. J’ai également supprimé un follower de tous ces créateurs que j’aime, mais qui sont, comme moi, un peu trop addicts aux likes.
Bref, en supprimant mon compte Twitter, j’ai rendu le monde un poil meilleur.
Oui, mais si on veut te contacter via cette plateforme
Si on veut me contacter, supprimer mon compte est la meilleure des choses. Parce que personne ne tentera de me contacter sur une plateforme où je ne suis pas. Personne ne pensera que j’ai reçu le message.
Comme je l’expliquais, les réseaux sociaux publicitaires ne nous mettent pas en relation, ils nous vendent l’illusion d’être en relation. En faisant parfois exactement le contraire.
Pour le cas d’un groupe particulier utilisant une plateforme, c’est souvent difficile d’être le premier à quitter. J’ai souvent eu l’impression de m’exclure des groupes qui n’étaient pas techniques (les différents sports que je pratique dans mon cas). J’ai signalé à plusieurs personnes que je ne recevais pas les infos. J’ai rappelé que je n’étais pas sur la plateforme utilisée, Facebook, Twitter ou Whatsapp. J’ai demandé à certains de me faire suivre les messages.
Cela a été difficile jusqu’au moment où une deuxième personne s’est révélée ne pas être non plus sur la plateforme. Soit qu’elle l’ait quittée, soit qu’elle ne l’ait jamais été. À partir de ce moment-là, les membres du groupe prennent conscience que la plateforme n’est plus représentative du groupe. Et l’intérêt pour la plateforme diminue pour disparaitre totalement avec la troisième personne qui n’y est pas non plus.
Être le premier est difficile et pas toujours possible dans un groupe. Mais si vous ne savez pas être le premier, soutenez toute autre tentative et soyez le second.
Oui, mais on peut usurper ton identité.
Sur Twitter, je disposais d’un compte vérifié (et ce depuis plusieurs années, à une époque où c’était encore rare et une source de frime), un compte créé en 2007 avec presque 7000 followers. J’y étais attaché. J’en étais fier même si avoir un nombre de followers à 4 chiffres est un peu la gêne chez les influenceurs de la nouvelle génération.
Avant de supprimer mon compte, je l’ai annoncé. À tous les messages qui arrivaient pendant une semaine ou quelques jours, j’ai répondu que ce compte allait être supprimé. Je l’ai également annoncé sur mon site et sur Mastodon.
Il est important de rappeler qu’à la suppression d’un compte Twitter, le pseudo est bloqué pendant un an. Pendant un an, personne ne peut l’utiliser.
Un an plus tard, quelqu’un pourrait en effet utiliser votre identifiant. C’est arrivé avec @ploum, un an jour pour jour après la suppression du compte. Le nouveau compte @ploum n’a rien à voir avec moi et ne peut en aucun cas être confondu avec moi.
Oui, ma petite notoriété m’a déjà fait subir des attaques voire du harcèlement. Oui, j’ai déjà vu des faux ploum se faire passer pour moi, ce qui a motivé d’ailleurs à l’époque ma vérification par Twitter. Pourtant, la probabilité que l’identifiant soit réutilisé par une personne qui me connait et est motivée pour me nuire était tout de même très faible. Parce que, honnêtement, tout le monde s’en fout de mon compte Twitter. Surtout quand il faut attendre un an après sa disparition.
Mais admettons que ce soit le cas. Un compte Twitter serait apparu qui aurait repris mon pseudo et un avatar crédible avant de commencer à raconter des atrocités en se faisant passer pour moi.
Et alors ?
Ce genre de compte a toujours été possible en jouant sur de subtiles variations orthographiques. On pourrait imaginer @pl0um, @ploom, @p1oum, … Cela fait un an que mon compte avait disparu, il n’est plus référencé sur mon site ni dans aucune bio, il a 0 follower. Quelle est la crédibilité d’un faux compte ?
Ne pas supprimer son compte Twitter par peur d’usurpation d’identité, c’est reconnaître à Twitter un pouvoir énorme, un pouvoir étatique : celui d’assigner l’identité des individus. Reconnaissez-vous Elon Musk comme garant de votre identité ? Si non, il est urgent de supprimer votre compte. Et si oui, rappelez-vous que Musk peut s’arroger de prendre votre identifiant à sa guise. Il l’a déjà fait.
Ce genre d’argument, que j’entends très souvent, me fait également souvent sourire parce que, en toute honnêteté, qui est suffisamment important pour qu’on veuille usurper son identité sur Twitter ? Et quels problèmes de cette situation très hypothétique ne pourraient pas être réglés par un simple « Ce compte Twitter se fait passer pour moi, mais ce n’est pas moi » sur vos autres plateformes et sur votre site ? Franchement, au rythme où ça va, vous pensez vraiment qu’il y’aura quoi que ce soit de crédible sur Twitter dans un an ? Si votre identité numérique est importante, investissez dans un nom de domaine avant toute chose !
L’inventeur, auteur et technologiste Jaron Lanier, par exemple, n’a jamais eu de compte sur aucun réseau social. Il a d’ailleurs écrit un livre très court pour vous convaincre d’effacer vos comptes. Pourtant, il y’a plusieurs comptes à son nom, certains portant même la mention « officiel ». Il se contente de dire sur son site que ces comptes ne sont pas de lui. Point à la ligne, problème réglé.
OK, toi tu l’as fait, mais moi je vais perdre ma communauté et mon audience
Comme le raconte Cory Doctorow, votre audience Twitter a déjà disparu. Ce n’est qu’un chiffre. Le média NPR a supprimé son compte Twitter et ses visites ont baissé de moins de 1%. Cory Doctorow a 10 fois plus de followers sur Twitter que sur Mastodon. Mais quand on parle des partages et des réponses, le ratio s’inverse. Mastodon est clairement beaucoup plus actif.
La même expérience vient d’être menée involontairement par l’application Signal. Le compte Twitter officiel de Signal, 600k followers, a en effet réagi à l’annonce d’une faille de sécurité.
Ce message a fait la première page du populaire site Hacker News et a donc été vu beaucoup de fois, y compris par des gens ne suivant pas le compte Signal sur Twitter.
5h plus tard, alors que le message Twitter faisait déjà le buzz, Signal a reposté le contenu sur son compte Mastodon, qui n’a « que » 40k followers (15 fois moins).
Pourtant, à l’heure où j’écris ces lignes, le nombre de partages est incroyablement identique (641 contre 615). Le nombre de réponses est également très similaire (30 contre 23). Et si on retire les "lol", les memes et autres réponses de moins de cinq mots, on peut même arriver à la conclusion que le fameux « engagement » sur Twitter est à peu près nul. (UPDATE: une semaine plus tard, le nombre de partages est passé à 1100 sur Mastodon pour 900 sur Twitter)
L’écrivain Henri Lœvenbruck a également supprimé complètement son compte Twitter et sa page Facebook en 2022. Il est pourtant connu et vit de sa notoriété. Son roman « Les disparus de Blackmore », publié quelques mois après cette suppression, s’est mieux vendu que le précédent. Nul ne saura jamais s’il aurait pu en vendre encore plus en étant sur Facebook ou Twitter. Mais la preuve est faite que cette présence n’est absolument pas indispensable.
Je le dis et le redis : le nombre de followers est faux. C’est une information qui est conçue dans l’optique de vous tromper.
Oui, vous avez le droit de supprimer vos comptes
Le sentiment de m’être fait avoir en créant des comptes sur Twitter, Facebook et autres Medium est fort. Mais ma seule erreur a été de croire les promesses de cette industrie. Ce n’est pas moi qui me suis trompé, ce sont les plateformes qui nous ont menti. Certains le prédisaient déjà à l’époque et me traitaient de naïf. Je ne les ai pas écoutés, je m’en excuse auprès d’eux. J’ai parfois argué « qu’il fallait aller où les gens étaient », devenant moi-même un allié de ces plateformes. Je vous ai encouragé, vous qui me lisez depuis des années, à m’y rejoindre, contribuant à leur emprise. Je m’en excuse profondément auprès de vous.
Ne pas déceler un mensonge est une erreur. À ma décharge, c’est une erreur qui peut arriver à tout le monde.
Mais aujourd’hui, le mensonge est éclatant. Il est indéniable. Recommanderais-je à mes amis de s’inscrire sur ces plateformes ? Serais-je d’accord que mes enfants s’y inscrivent ? Si la réponse est non à l’une de ces questions, garder un compte sur ces plateformes n’est plus excusable.
Nous sommes le composant essentiel des plateformes centralisées. Si nous n’aimons pas ce qu’elles sont ou ce qu’elles deviennent, si leurs valeurs sont en contradiction avec les nôtres, notre devoir est de les quitter, de les assécher, pas de lutter pour les améliorer.
Ne pas réagir et continuer à se laisser faire lorsque le mensonge est flagrant n’est pas une erreur, c’est à la limite de la complicité. C’est encore plus le cas pour les organisations et les militants qui prétendent soutenir des valeurs opposées à celles de la plateforme. On ne peut pas lutter contre le capitalo-consumérisme sur Facebook ni contre l’extrême droite sur Twitter. Le prétendre n’est qu’hypocrisie intellectuelle.
Et j’en ai été le premier coupable.
Aujourd’hui, je tente de réparer mes erreurs du passé en vous demandant, à vous mes amis qui lisez ceci, de supprimer vos comptes sur ces réseaux sociaux publicitaires. Je peux vous rassurer : non, vous n’allez que peu ou prou manquer des choses importantes. Oui, ça sera dur au début, mais ça ira de mieux en mieux. Et peut-être que vous allez y gagner beaucoup plus que ce que vous imaginez.
Oui mes amis, vous avez le droit, vous avez le devoir de supprimer vos comptes !
PS : Je dédie ce post à Henri Lœvenbruck, cité plus haut dans cet article. Cela fait un an jour pour jour que t’es arrivé sur Mastodon. J’en suis heureux pour toutes les expériences vécues ensemble cette année et dans les prochaines. Joyeux mastanniversaire mon ami !
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Les poumons remplis par la cigarette électronique,
Les oreilles bouchées par les écouteurs,
Les yeux obnubilés par l’écran,
Les doigts agrippés au smartphone,
Que l’on porte alternativement devant la bouche ou l’oreille,
Dans son absurde horizontalité.
Nous rêvions d’un transhumanisme pour étendre nos capacités,
Pour augmenter notre sensorialité,
Pour démultiplier notre perception et notre impact sur la réalité.
Nous avons construit à la place une technologie de l’anesthésie.
Nous bloquons, nous bouchons, nous tentons d’oublier.
Nous désactivons nos sens pour ne pas nous sentir crever.
Et lorsque nous nous retrouvons brièvement déconnectés,
Les sens soudain réveillés sur la conscience de la douleur d’exister,
Angoissés nous cherchons une connexion, un substitut, un objet à acheter,
Un cancer à consommer en cannette, barre sucrée ou cendres inhalées.
L’extension, l’amélioration de la réalité étaient un rêve.
Mais les rêves ne sont plus faits pour se réaliser,
Ils ne sont que l’inspiration de produits à consommer.
J’aurais bien sauvé le monde, mais je vais rater.
Le dernier épisode de la nouvelle série télé.
Après tout, ce petit écran ne me donne-t-il pas accès au monde entier ?
Au savoir humain dans son entièreté ?
Moi dont la voix pourrait porter à l’autre bout de la planète,
Moi qui pourrais sans effort créer de quoi…
Oh, tiens, une mise à jour à installer !
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Les poumons remplis par la cigarette électronique,
Les oreilles bouchées par les écouteurs,
Les yeux obnubilés par l’écran,
Les doigts agrippés au smartphone,
Que l’on porte alternativement devant la bouche ou l’oreille,
Dans son absurde horizontalité.
Nous rêvions d’un transhumanisme pour étendre nos capacités,
Pour augmenter notre sensorialité,
Pour démultiplier notre perception et notre impact sur la réalité.
Nous avons construit à la place une technologie de l’anesthésie.
Nous bloquons, nous bouchons, nous tentons d’oublier.
Nous désactivons nos sens pour ne pas nous sentir crever.
Et lorsque nous nous retrouvons brièvement déconnectés,
Les sens soudain réveillés sur la conscience de la douleur d’exister,
Angoissés nous cherchons une connexion, un substitut, un objet à acheter,
Un cancer à consommer en cannette, barre sucrée ou cendres inhalées.
L’extension, l’amélioration de la réalité étaient un rêve.
Mais les rêves ne sont plus faits pour se réaliser,
Ils ne sont que l’inspiration de produits à consommer.
J’aurais bien sauvé le monde, mais je vais rater.
Le dernier épisode de la nouvelle série télé.
Après tout, ce petit écran ne me donne-t-il pas accès au monde entier ?
Au savoir humain dans son entièreté ?
Moi dont la voix pourrait porter à l’autre bout de la planète,
Moi qui pourrais sans effort créer de quoi…
Oh, tiens, une mise à jour à installer !
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Les hommes avaient mis la nature en prison, la détruisant, la repoussant pour planter ces immensités de jachères macadamisées où poussent la tôle, le bruit, l’air vicié et les accidents.
Les arbres tentaient vainement de subsister, leur chlorophylle grise en quête de quelques brins de lumière ayant traversé le smog.
Les ligneux esprits avaient du mal à comprendre cette humanité délirante : « Mais pourquoi les humains construisent-ils des cages à parking ? »
Ce texte est une réponse instinctive et spontanée à la photo « Les territoires perdus » de Bruno Leyval, photo qui illustre cet article et reproduite ici avec sa bénédiction.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Les hommes avaient mis la nature en prison, la détruisant, la repoussant pour planter ces immensités de jachères macadamisées où poussent la tôle, le bruit, l’air vicié et les accidents.
Les arbres tentaient vainement de subsister, leur chlorophylle grise en quête de quelques brins de lumière ayant traversé le smog.
Les ligneux esprits avaient du mal à comprendre cette humanité délirante : « Mais pourquoi les humains construisent-ils des cages à parking ? »
Ce texte est une réponse instinctive et spontanée à la photo « Les territoires perdus » de Bruno Leyval, photo qui illustre cet article et reproduite ici avec sa bénédiction.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Extrait de mon journal du 8 octobre 2023.
L’écologie a beaucoup à apprendre de l’échec du mouvement pour le logiciel libre. Celui-ci, perçu avec raison comme étant un combat moral s’opposant à la privatisation et la marchandisation des communs, s’est mué en open source, un mouvement très similaire, mais mettant en avant l’aspect technique afin de ne plus remettre en question l’aspect mercantile et la philosophie capitaliste.
Le résultat est sans appel: l’open source a gagné ! Il est partout. Il compose l’essentiel des logiciels que vous utilisez tous les jours. Le plus grand adversaire historique du logiciel libre, Microsoft, est devenu le plus grand contributeur à l’open source, étant même propriétaire de la plus grande et incontournable plateforme de développement open source : Github.
Et pourtant, les utilisateurs n’ont jamais eu aussi peu de liberté (ce qui justifie que je parle d’échec). Nous sommes espionnés, nous devons payer des abonnements mensuels pour tout, nous sommes soumis à des myriades de publicités. Nous n’avons aucun contrôle sur nos données ni même sur les ordinateurs que nous achetons. Là où le logiciel libre s’opposait à la privatisation des communs, l’open source contribue à cet accaparement.
La victoire à la Pyhrrus de l’open source entraine une désertion du combat pour la préservation de nos libertés fondamentales. La disparition de ces libertés n’était, au départ, que perçue comme un délire de quelques geeks paranoïaques. Elle est désormais un fait avéré et totalement banalisé, normalisé dans la vie quotidienne de l’immense majorité des humains. Le simple droit à exister sans être espionné, sans être envahi par les monopoles publicitaires et sans être forcé à dépenser de l’argent pour une énième mise à jour a essentiellement disparu. Se connecter aux plateformes en ligne officielles de nombreuses institutions, y compris étatiques, nécessite désormais le plus souvent un compte Google, Apple ou Microsoft. La plus grande université francophone de Belgique, où je suis employé, force chaque étudiant et chaque membre du personnel à utiliser un compte Microsoft et à y sauver toutes ses données, toutes ses communications.
Le parallèle avec l’écologie est troublant à l’heure où la doxa politique consiste à concilier écologie et consumérisme. L’écologie de marché est promue comme une solution exactement de la même manière que l’open source était vu comme une manière pour le logiciel libre de s’imposer.
Nul besoin d’être prophète pour prédire que le résultat sera identique, car il l’est déjà : une situation aggravée, mais perçue comme acceptable, car le combat fait désormais partie du passé. Les militants restants forment une arrière-garde décatie.
Le marché des compensations carbone, qui produit plus de pollution que s’il n’existait pas tout en autorisant les plus gros pollueurs à s’acheter une conscience, n’est que le premier de nombreux exemples. L’absurde hypocrisie des entreprises de se prétendre « écologiques » ou « vertes » en est une autre. En vérité, il n’y a pas de compromis à faire avec l’économie consumériste, car elle est la racine du mal qui nous ronge.
Bon nombre de militants écologistes se regroupent désormais sur des plateformes publicitaires comme Facebook ou Google qui cherchent à privatiser l’information et les espaces de discussions en nous poussant à la consommation. Ce n’est qu’une des nombreuses illustrations de notre incapacité à imaginer les conséquences logiques de nos actions dès le moment où notre salaire et notre confort quotidien dépendent du fait que nous ne les imaginions pas.
Mon expérience universitaire démontre que les organisations qui sont censées nous servir d’élite intellectuelle sont tout autant corrompues et dénuées de l’imagination qui est pourtant le cœur de leur mission.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
Extrait de mon journal du 8 octobre 2023.
L’écologie a beaucoup à apprendre de l’échec du mouvement pour le logiciel libre. Celui-ci, perçu avec raison comme étant un combat moral s’opposant à la privatisation et la marchandisation des communs, s’est mué en open source, un mouvement très similaire, mais mettant en avant l’aspect technique afin de ne plus remettre en question l’aspect mercantile et la philosophie capitaliste.
Le résultat est sans appel: l’open source a gagné ! Il est partout. Il compose l’essentiel des logiciels que vous utilisez tous les jours. Le plus grand adversaire historique du logiciel libre, Microsoft, est devenu le plus grand contributeur à l’open source, étant même propriétaire de la plus grande et incontournable plateforme de développement open source : Github.
Et pourtant, les utilisateurs n’ont jamais eu aussi peu de liberté (ce qui justifie que je parle d’échec). Nous sommes espionnés, nous devons payer des abonnements mensuels pour tout, nous sommes soumis à des myriades de publicités. Nous n’avons aucun contrôle sur nos données ni même sur les ordinateurs que nous achetons. Là où le logiciel libre s’opposait à la privatisation des communs, l’open source contribue à cet accaparement.
La victoire à la Pyhrrus de l’open source entraine une désertion du combat pour la préservation de nos libertés fondamentales. La disparition de ces libertés n’était, au départ, que perçue comme un délire de quelques geeks paranoïaques. Elle est désormais un fait avéré et totalement banalisé, normalisé dans la vie quotidienne de l’immense majorité des humains. Le simple droit à exister sans être espionné, sans être envahi par les monopoles publicitaires et sans être forcé à dépenser de l’argent pour une énième mise à jour a essentiellement disparu. Se connecter aux plateformes en ligne officielles de nombreuses institutions, y compris étatiques, nécessite désormais le plus souvent un compte Google, Apple ou Microsoft. La plus grande université francophone de Belgique, où je suis employé, force chaque étudiant et chaque membre du personnel à utiliser un compte Microsoft et à y sauver toutes ses données, toutes ses communications.
Le parallèle avec l’écologie est troublant à l’heure où la doxa politique consiste à concilier écologie et consumérisme. L’écologie de marché est promue comme une solution exactement de la même manière que l’open source était vu comme une manière pour le logiciel libre de s’imposer.
Nul besoin d’être prophète pour prédire que le résultat sera identique, car il l’est déjà : une situation aggravée, mais perçue comme acceptable, car le combat fait désormais partie du passé. Les militants restants forment une arrière-garde décatie.
Le marché des compensations carbone, qui produit plus de pollution que s’il n’existait pas tout en autorisant les plus gros pollueurs à s’acheter une conscience, n’est que le premier de nombreux exemples. L’absurde hypocrisie des entreprises de se prétendre « écologiques » ou « vertes » en est une autre. En vérité, il n’y a pas de compromis à faire avec l’économie consumériste, car elle est la racine du mal qui nous ronge.
Bon nombre de militants écologistes se regroupent désormais sur des plateformes publicitaires comme Facebook ou Google qui cherchent à privatiser l’information et les espaces de discussions en nous poussant à la consommation. Ce n’est qu’une des nombreuses illustrations de notre incapacité à imaginer les conséquences logiques de nos actions dès le moment où notre salaire et notre confort quotidien dépendent du fait que nous ne les imaginions pas.
Mon expérience universitaire démontre que les organisations qui sont censées nous servir d’élite intellectuelle sont tout autant corrompues et dénuées de l’imagination qui est pourtant le cœur de leur mission.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir. Je fais également partie du coffret libre et éthique « SF en VF ».
A story about how the UNIX philosophy made me develop tools I’m actually proud of and why packaging is holding me back.
Two years ago, I decided that I wanted to be able to browse Gemini while offline. I started to add a permanent cache to Solderpunk’s AV-98, the simplest and first Gemini browser ever. It went surprisingly well. Then, as the excellent forlater.email service went down for a week, I thought that I would add a quick and hackish HTTP support to it. Just a temporary experiment.
The same week, I serendipitously stumbled upon chafa, an image rendering tool which was on my computer because of neofetch. I thought it would be funny to have pictures rendered in webpages in my terminal. Just an experiment to take some funny screenshots, nothing more.
But something really surprising happened: it was working. It was really useful. I was really using it and, after adding support for RSS, I realised that this experiment was actually working better for me than forlater.email and newsboat. Offpunk was born without really thinking about it and became a real project with its own philosophy.
Born on Gemini, I wanted Offpunk to keep its minimalistic roots: keeping dependencies under control (making them optional and implementing the underlying feature myself as soon as it makes sense), keeping it simple (one single runnable python script), caring as much as possible about older versions of python, listening to people using it on very minimal systems. I also consciously choose to use only solutions that have been time-trial-tested. I’ve spent too many years of my life falling for the "new-trendy-technology" and learned from those mistakes. The one-file aspect assured that it was really easy to use and to hack: open the file, modify something, run it.
I’m not a good developer. Anything more complex than that is too much for my taste. Unless forced, I’ve never used an IDE, never understood complex toolchains nor packaging. I modify files with (neo)vim (without any plugin), compile from the command line and run the resulting binary (not even needing that step with python). Life is too short for making it more complex. I like to play with the code, not to learn tools that would do it for me.
But offpunk.py was becoming fat. 4500 lines of organic python which have grown over an AV-98 structured to be a test bed for an experimental protocol. The number of people able to understand its code entanglement varied between 0 and 1, depending on the quality of my morning Earl Grey.
I wanted to make life easier for contributors. I also realised that some features I developed might be useful without offpunk. So I stepped into a huge refactoring and managed to split offpunk into several components. My goal was to separate the code into multiple individual components doing one thing and doing it well. And, to my own surprise, I succeeded.
Netcache.py
I called the first component "netcache". Think of netcache as a cached version of wget. If possible, netcache will give you a cached version of the URL you are asking. If no cache or too old and if allowed to go online, netcache will download it.
It means that if you like Offpunk’s core concept but don’t like the interface and want, for example, a GUI, you could write your own browser that would, using netcache, share the cache with Offpunk.
Netcache is currently working just well enough for my needs but could do a lot better. I should, for example, investigate replacing the network code by libcurl and implementing support for multithreaded concurrent downloads.
Ansicat.py
Coloured output in your terminal is done through a standard called ANSI. As I wrote the first HTML to ANSI renderer for offpunk, I started to understand how awful the HTML standard was. Armed with that experience, I started a second renderer and, to be honest, it is actually not that bad. I’m even proud of it.
Ansicat is really useful when in a terminal because it will render HTML and gemtext in a good, readable way. If the optional library python-readability is present, ansicat will try to extract the main content from a web page (and, yes, python-readability is one dependency I would like to reimplement someday).
With netcache and ansicat, you can already do something like:
netcache https://ploum.net | ansicat --format=html
Yes, it works. And yes, as a UNIX junkie, I was completely excited the first time it worked. Look mum, I’m Ken Thompson! Making ansicat a separate tool made me think about adding support for other formats. Like PDF or office documents. How cool would it be to have a single cat command for so many different formats?
Opnk.py
While netcache and ansicat were clear components I wanted to split from Offpunk’s core since the start of the refactoring, another tool appeared spontaneously: opnk.
Opnk (Open-like-a-punk) is basically a wrapper that will run ansicat on any file given. If given a URL, it will ask netcache for the file. Result will be displayed in less (after passing through ansicat, of course).
If ansicat cannot open the file, opnk fallbacks on xdg-open.
That looks like nothing but it proved to be massively useful in my workflow. I already use opnk every day. Each time I want to open a file, I don’t think about the command, I type "opnk". It even replaced cat for many use cases. I’m considering renaming it "opn" to save one character. Using opnk also explains why I want to work on supporting PDF/office documents with ansicat. That would be one less opportunity to leave the terminal.
Offpunk.py
Through this architecture, Offpunk became basically an interface above opnk. And this proved to work well. Many longstanding bugs were fixed, performance and usability were vastly improved.
Everything went so well that I dreamed releasing offpunk 2.0, netcache, ansicat and opnk while running naked with talking animals in field of flowers under a rainbow. Was it really Earl Grey in the cup that day?
Packaging Offpunk.py
Now for the bad news.
As expected, the refactoring forced me to break my "one-single-python-file" rule.
I felt guilty for those people who told me about using offpunk on very minimal systems, sometimes from a USB key. But I thought that this was not a real problem. Instead of one python script, I had four of them (and a fifth file containing some shared code). That should not be that much of a problem, isn’t it?
Well, python packaging systems would like to disagree. Flowers fade, the rainbow disappears behind black and heavy clouds while animals start to look at me with a devilish look and surprisingly sharp teeth.
I’ve spent many hours, asked several people on the best way to package multiple python files without making the whole thing a module. Without success. Hopefully, the community is really helpful. David Zaslavsky stepped on the mailing list to give lots of advice and, as I was discouraged, Austreelis started to work really hard to make offpunk both usable directly and packagable. I’m really grateful for their help and their work. But, so far, without clear success. I feel sad about the amount of energy required to address something as simple as "I’ve 5 python files which depend on each other and I want to be able to launch them separately".
The software is working really well. The refactoring allowed me to fix longstanding bugs and to improve a lot of areas while adding new features (colour themes anyone?) On my computer, I added four aliases in my zsh config: offpunk, opnk, ansicat and netcache. Each alias runs the corresponding python file. Nothing fancy and I want to keep it that way. I know for a fact that several users are doing something similar: git clone then run it from an arbitrary location.
Keeping things as simple as that is the main philosophical goal behind offpunk. It’s an essential part of the project. If people want to use pip or any other tool to mess up their computer configuration, that’s their choice. But it should never be required.
Which means that I’m now in a very frustrating position: Offpunk 2.0 is more than ready from a code point of view. But it cannot be shipped because there’s currently no easy way to package it. The pyproject.toml file had become an obstacle to the whole development process.
I’m contemplating putting everything back in one big file. Or removing the pyprojects.toml file from the repository and releasing offpunk "as it is".
Some will call me an old conservative fart for refusing to use one of those gazillion shiny packaging system. Others will judge me as a pretty poor programmer if I managed to do 20 years of Python without ever understanding pip nor using an IDE.
They are probably right. What would you seriously expect from someone doing a command-line tool to browse Gemini and Gopher?
But there’s maybe an easier solution than to change my mind and offpunk’s core philosophy. A simple solution that I missed. If that’s the case, don’t hesitate to drop a word on the devel mailing-list, Austreelis and I will be happy to hear about your opinion and your experience.
While you are at it, bug reports and feedback are also welcome. I’ve this odd custom of finding embarrassing bugs only hours after a release. I really hope to do better with offpunk 2.0.
And after we’ve solved that little packaging anecdote together, I will happily return to my bare neovim to code all the ideas I want to implement for 2.1, 2.2 and many more releases to come.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
A story about how the UNIX philosophy made me develop tools I’m actually proud of and why packaging is holding me back.
Two years ago, I decided that I wanted to be able to browse Gemini while offline. I started to add a permanent cache to Solderpunk’s AV-98, the simplest and first Gemini browser ever. It went surprisingly well. Then, as the excellent forlater.email service went down for a week, I thought that I would add a quick and hackish HTTP support to it. Just a temporary experiment.
The same week, I serendipitously stumbled upon chafa, an image rendering tool which was on my computer because of neofetch. I thought it would be funny to have pictures rendered in webpages in my terminal. Just an experiment to take some funny screenshots, nothing more.
But something really surprising happened: it was working. It was really useful. I was really using it and, after adding support for RSS, I realised that this experiment was actually working better for me than forlater.email and newsboat. Offpunk was born without really thinking about it and became a real project with its own philosophy.
Born on Gemini, I wanted Offpunk to keep its minimalistic roots: keeping dependencies under control (making them optional and implementing the underlying feature myself as soon as it makes sense), keeping it simple (one single runnable python script), caring as much as possible about older versions of python, listening to people using it on very minimal systems. I also consciously choose to use only solutions that have been time-trial-tested. I’ve spent too many years of my life falling for the "new-trendy-technology" and learned from those mistakes. The one-file aspect assured that it was really easy to use and to hack: open the file, modify something, run it.
I’m not a good developer. Anything more complex than that is too much for my taste. Unless forced, I’ve never used an IDE, never understood complex toolchains nor packaging. I modify files with (neo)vim (without any plugin), compile from the command line and run the resulting binary (not even needing that step with python). Life is too short for making it more complex. I like to play with the code, not to learn tools that would do it for me.
But offpunk.py was becoming fat. 4500 lines of organic python which have grown over an AV-98 structured to be a test bed for an experimental protocol. The number of people able to understand its code entanglement varied between 0 and 1, depending on the quality of my morning Earl Grey.
I wanted to make life easier for contributors. I also realised that some features I developed might be useful without offpunk. So I stepped into a huge refactoring and managed to split offpunk into several components. My goal was to separate the code into multiple individual components doing one thing and doing it well. And, to my own surprise, I succeeded.
Netcache.py
I called the first component "netcache". Think of netcache as a cached version of wget. If possible, netcache will give you a cached version of the URL you are asking. If no cache or too old and if allowed to go online, netcache will download it.
It means that if you like Offpunk’s core concept but don’t like the interface and want, for example, a GUI, you could write your own browser that would, using netcache, share the cache with Offpunk.
Netcache is currently working just well enough for my needs but could do a lot better. I should, for example, investigate replacing the network code by libcurl and implementing support for multithreaded concurrent downloads.
Ansicat.py
Coloured output in your terminal is done through a standard called ANSI. As I wrote the first HTML to ANSI renderer for offpunk, I started to understand how awful the HTML standard was. Armed with that experience, I started a second renderer and, to be honest, it is actually not that bad. I’m even proud of it.
Ansicat is really useful when in a terminal because it will render HTML and gemtext in a good, readable way. If the optional library python-readability is present, ansicat will try to extract the main content from a web page (and, yes, python-readability is one dependency I would like to reimplement someday).
With netcache and ansicat, you can already do something like:
netcache https://ploum.net | ansicat --format=html
Yes, it works. And yes, as a UNIX junkie, I was completely excited the first time it worked. Look mum, I’m Ken Thompson! Making ansicat a separate tool made me think about adding support for other formats. Like PDF or office documents. How cool would it be to have a single cat command for so many different formats?
Opnk.py
While netcache and ansicat were clear components I wanted to split from Offpunk’s core since the start of the refactoring, another tool appeared spontaneously: opnk.
Opnk (Open-like-a-punk) is basically a wrapper that will run ansicat on any file given. If given a URL, it will ask netcache for the file. Result will be displayed in less (after passing through ansicat, of course).
If ansicat cannot open the file, opnk fallbacks on xdg-open.
That looks like nothing but it proved to be massively useful in my workflow. I already use opnk every day. Each time I want to open a file, I don’t think about the command, I type "opnk". It even replaced cat for many use cases. I’m considering renaming it "opn" to save one character. Using opnk also explains why I want to work on supporting PDF/office documents with ansicat. That would be one less opportunity to leave the terminal.
Offpunk.py
Through this architecture, Offpunk became basically an interface above opnk. And this proved to work well. Many longstanding bugs were fixed, performance and usability were vastly improved.
Everything went so well that I dreamed releasing offpunk 2.0, netcache, ansicat and opnk while running naked with talking animals in field of flowers under a rainbow. Was it really Earl Grey in the cup that day?
Packaging Offpunk.py
Now for the bad news.
As expected, the refactoring forced me to break my "one-single-python-file" rule.
I felt guilty for those people who told me about using offpunk on very minimal systems, sometimes from a USB key. But I thought that this was not a real problem. Instead of one python script, I had four of them (and a fifth file containing some shared code). That should not be that much of a problem, isn’t it?
Well, python packaging systems would like to disagree. Flowers fade, the rainbow disappears behind black and heavy clouds while animals start to look at me with a devilish look and surprisingly sharp teeth.
I’ve spent many hours, asked several people on the best way to package multiple python files without making the whole thing a module. Without success. Hopefully, the community is really helpful. David Zaslavsky stepped on the mailing list to give lots of advice and, as I was discouraged, Austreelis started to work really hard to make offpunk both usable directly and packagable. I’m really grateful for their help and their work. But, so far, without clear success. I feel sad about the amount of energy required to address something as simple as "I’ve 5 python files which depend on each other and I want to be able to launch them separately".
The software is working really well. The refactoring allowed me to fix longstanding bugs and to improve a lot of areas while adding new features (colour themes anyone?) On my computer, I added four aliases in my zsh config: offpunk, opnk, ansicat and netcache. Each alias runs the corresponding python file. Nothing fancy and I want to keep it that way. I know for a fact that several users are doing something similar: git clone then run it from an arbitrary location.
Keeping things as simple as that is the main philosophical goal behind offpunk. It’s an essential part of the project. If people want to use pip or any other tool to mess up their computer configuration, that’s their choice. But it should never be required.
Which means that I’m now in a very frustrating position: Offpunk 2.0 is more than ready from a code point of view. But it cannot be shipped because there’s currently no easy way to package it. The pyproject.toml file had become an obstacle to the whole development process.
I’m contemplating putting everything back in one big file. Or removing the pyprojects.toml file from the repository and releasing offpunk "as it is".
Some will call me an old conservative fart for refusing to use one of those gazillion shiny packaging system. Others will judge me as a pretty poor programmer if I managed to do 20 years of Python without ever understanding pip nor using an IDE.
They are probably right. What would you seriously expect from someone doing a command-line tool to browse Gemini and Gopher?
But there’s maybe an easier solution than to change my mind and offpunk’s core philosophy. A simple solution that I missed. If that’s the case, don’t hesitate to drop a word on the devel mailing-list, Austreelis and I will be happy to hear about your opinion and your experience.
While you are at it, bug reports and feedback are also welcome. I’ve this odd custom of finding embarrassing bugs only hours after a release. I really hope to do better with offpunk 2.0.
And after we’ve solved that little packaging anecdote together, I will happily return to my bare neovim to code all the ideas I want to implement for 2.1, 2.2 and many more releases to come.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Richard Stallman ne voulait pas changer le monde. Il ne voulait pas se battre contre les moulins à vent. Il ne voulait pas réinventer la roue. Richard Stallman voulait simplement retrouver ses amis, sa communauté.
Pour ce jeune homme barbu et rondouillard, les relations sociales n’avaient jamais été simples. Toujours plongé dans les livres et adorant résoudre des casse-têtes logiques, le jeune homme avait toujours eu un peu de mal à trouver sa place. Il avait beau adorer la compagnie, les longues discussions et la danse, ses intérêts pour les mathématiques semblaient toujours un peu en décalage. Son humour, surtout, était souvent mal perçu au point de choquer ou d’effrayer. C’est au laboratoire d’Intelligence Artificielle du MIT qu’il avait enfin eu l’impression d’être entièrement à sa place. Les jours et les nuits devant un écran, les doigts sur un clavier, entourés de personnes qui, comme lui, ne cherchaient que des problèmes à résoudre. À résoudre de la manière la plus simple, la plus élégante, la plus rigolote ou la plus absurde. Pour l’amour de l’art, par besoin ou par simple envie de faire une blague potache.
RMS, ainsi qu’il se présentait chaque fois que l’ordinateur lui affichait le mot "login:", était heureux.
Mais le vent changeait. En 1976, le très jeune dirigeant d’une obscure société vendant un compilateur BASIC s’était fendu d’une longue lettre ouverte à la communauté des utilisateurs d’ordinateurs. Dans cette lettre, il suppliait les amateurs d’ordinateurs d’arrêter de partager des logiciels, de le modifier, de les copier. À la place, arguait-il, il faut acheter les logiciels. Il faut payer les développeurs. Bref, il faut faire la différence entre les développeurs payés et les utilisateurs qui paient et n’ont pas le droit de comprendre comment le programme fonctionne.
S’il l’a lue, la lettre est passée au-dessus de la tête de Richard. Ce que produit ce jeune William Gates, dit Bill, et sa société « Micro-Soft » ne l’intéressait pas à l’époque. Il sait bien que l’esprit « hacker » est celui du partage, de la curiosité. Ken Thompson, l’inventeur d’Unix, n’avait jamais caché son désir de partager toutes ses expérimentations. Lorsque les avocats d’AT&T, son employeur, avaient commencé à rechigner en déposant la marque UNIX puis en interdisant tout partage, lui, Dennis Ritchie, Brian Kernighan et leurs comparses s’étaient amusés à contourner toutes les règles. Le code source se transmettait via des bandes « oubliées » dans un bureau voire sur les bancs des parcs. Le code source entier d’UNIX, annoté et commenté par John Lions pour servir de support éducatif à ses étudiants, se targuait d’être le livre d’informatique le plus photocopié du monde malgré l’interdiction d’en faire des copies.
Les Bill Gates et leurs armées d’avocats ne pourraient jamais venir à bout de l’esprit hacker. Du moins, c’est ce que Richard Stallman pensait en travaillant à sa machine virtuel LISP et à son éditeur Emacs.
Jusqu’au jour où il réalisa qu’une société, Symbolics, avait graduellement engagé tous ses collègues. Ses amis. Chez Symbolics, ceux-ci continuaient à travailler à une machine virtuelle LISP. Mais ils ne pouvaient plus rien partager avec Richard. Ils étaient devenus concurrents, un concept inimaginable pour le hacker aux cheveux en bataille. Par bravade, celui-ci se mit alors à copier et implémenter dans la machine LISP du MIT chaque nouvelle fonctionnalité développée par Symbolics. À lui tout seul, il abattait le même travail que des dizaines d’ingénieurs. Il n’avait bien entendu pas accès au code source et devait se contenter de la documentation de Symbolics pour deviner les principes de fonctionnement.
Le changement d’ambiance avait été graduel. Richard avait perdu ses amis, sa communauté. Il avait été forcé, à son corps défendant, de devenir un compétiteur plutôt qu’un collaborateur. Il ne s’en rendait pas complètement compte. Le problème était encore flou dans sa tête jusqu’au jour où une nouvelle imprimante fit son apparition dans les locaux du MIT.
Il faut savoir que, à l’époque, les imprimantes faisaient la taille d’un lit et avaient pas mal de problèmes. Sur la précédente, Richard avait bricolé un petit système envoyant automatiquement une alerte en cas de bourrage. Il n’avait pas réfléchi, il avait pris le code source de l’imprimante et l’avait modifié sans se poser de questions. Mais, contre toute attente, le code source de la nouvelle imprimante n’était pas livré avec. Le monde de l’informatique était encore tout petit et Richard avait une idée de qui, chez Xerox, avait pu écrire le logiciel faisant fonctionner l’imprimante. Profitant d’un voyage, il se rendit dans le bureau de la personne pour lui demander une copie.
La discussion fut très courte. La personne n’avait pas le droit de partager le code source. Et si elle le partageait, Richard devait signer un accord de non-divulgation. Il n’aurait, à son tour, pas le droit de partager.
Pas le droit de partager ? PAS LE DROIT DE PARTAGER ?
Le partage n’est-il pas l’essence même de l’humanité ? La connaissance ne repose-t-elle pas entièrement sur le partage intellectuel ?
Le ver glissé dans le fruit par Bill Gates commençait à faire son œuvre. Le monde commençait à souscrire à la philosophie selon laquelle faire de Bill Gates l’homme le plus riche du monde était une chose plus importante que le partage de la connaissance. Que la compétition devait nécessairement venir à bout de la collaboration. Les hackers avaient fini par enfiler une cravate et se soumettre aux avocats.
S’il ne faisait rien, Richard ne retrouverait plus jamais ses amis, sa communauté. Bouillonnant de colère, il décida de reconstruire, à lui tout seul, la communauté hacker. De la fédérer autour d’un projet que n’importe qui pourrait partager, améliorer, modifier. Que personne ne pourrait s’approprier.
Il nomma son projet « GNU », les initiales de « GNU’s Not Unix » et l’annonça sur le réseau Usenet le 27 septembre 1983. Il y a 40 ans aujourd’hui.
Bon anniversaire GNU.
Après cette annonce, Richard Stallman allait se mettre à réécrire chacun des très nombreux logiciels qui composaient le système Unix. Tout seul au début, il créait le système GNU de toutes pièces. Son seul échec fut le développement d’un noyau permettant de faire tourner GNU sur des ordinateurs sans avoir besoin d’un système non-GNU. Richard percevait le problème, car, en plus de coder, il développait la philosophie du partage et du libre. Il inventait les fondements du copyleft.
En 1991, en s’aidant des outils GNU, dont le compilateur GCC, un jeune Finlandais, Linus Torvalds, allait justement créer un noyau à partir de rien. Un noyau qu’il allait mettre sous la licence copyleft inventée par Stallman.
Mais ceci est une autre histoire…
Lectures suggérées :
- Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, par Richard Stallman, Sam Williams et Christophe Masutti
- The Daemon, the Gnu and the Penguin, par Peter H. Salus
- UNIX, A history and a Memoir, par Brian Kernighan
- Lion’s Commentary on UNIX 6th Edition with Source Code, par John Lions
- Lettre ouverte aux utilisateurs d’ordinateurs, par Bill Gates
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
Richard Stallman ne voulait pas changer le monde. Il ne voulait pas se battre contre les moulins à vent. Il ne voulait pas réinventer la roue. Richard Stallman voulait simplement retrouver ses amis, sa communauté.
Pour ce jeune homme barbu et rondouillard, les relations sociales n’avaient jamais été simples. Toujours plongé dans les livres et adorant résoudre des casse-têtes logiques, le jeune homme avait toujours eu un peu de mal à trouver sa place. Il avait beau adorer la compagnie, les longues discussions et la danse, ses intérêts pour les mathématiques semblaient toujours un peu en décalage. Son humour, surtout, était souvent mal perçu au point de choquer ou d’effrayer. C’est au laboratoire d’Intelligence Artificielle du MIT qu’il avait enfin eu l’impression d’être entièrement à sa place. Les jours et les nuits devant un écran, les doigts sur un clavier, entourés de personnes qui, comme lui, ne cherchaient que des problèmes à résoudre. À résoudre de la manière la plus simple, la plus élégante, la plus rigolote ou la plus absurde. Pour l’amour de l’art, par besoin ou par simple envie de faire une blague potache.
RMS, ainsi qu’il se présentait chaque fois que l’ordinateur lui affichait le mot "login:", était heureux.
Mais le vent changeait. En 1976, le très jeune dirigeant d’une obscure société vendant un compilateur BASIC s’était fendu d’une longue lettre ouverte à la communauté des utilisateurs d’ordinateurs. Dans cette lettre, il suppliait les amateurs d’ordinateurs d’arrêter de partager des logiciels, de le modifier, de les copier. À la place, arguait-il, il faut acheter les logiciels. Il faut payer les développeurs. Bref, il faut faire la différence entre les développeurs payés et les utilisateurs qui paient et n’ont pas le droit de comprendre comment le programme fonctionne.
S’il l’a lue, la lettre est passée au-dessus de la tête de Richard. Ce que produit ce jeune William Gates, dit Bill, et sa société « Micro-Soft » ne l’intéressait pas à l’époque. Il sait bien que l’esprit « hacker » est celui du partage, de la curiosité. Ken Thompson, l’inventeur d’Unix, n’avait jamais caché son désir de partager toutes ses expérimentations. Lorsque les avocats d’AT&T, son employeur, avaient commencé à rechigner en déposant la marque UNIX puis en interdisant tout partage, lui, Dennis Ritchie, Brian Kernighan et leurs comparses s’étaient amusés à contourner toutes les règles. Le code source se transmettait via des bandes « oubliées » dans un bureau voire sur les bancs des parcs. Le code source entier d’UNIX, annoté et commenté par John Lions pour servir de support éducatif à ses étudiants, se targuait d’être le livre d’informatique le plus photocopié du monde malgré l’interdiction d’en faire des copies.
Les Bill Gates et leurs armées d’avocats ne pourraient jamais venir à bout de l’esprit hacker. Du moins, c’est ce que Richard Stallman pensait en travaillant à sa machine virtuel LISP et à son éditeur Emacs.
Jusqu’au jour où il réalisa qu’une société, Symbolics, avait graduellement engagé tous ses collègues. Ses amis. Chez Symbolics, ceux-ci continuaient à travailler à une machine virtuelle LISP. Mais ils ne pouvaient plus rien partager avec Richard. Ils étaient devenus concurrents, un concept inimaginable pour le hacker aux cheveux en bataille. Par bravade, celui-ci se mit alors à copier et implémenter dans la machine LISP du MIT chaque nouvelle fonctionnalité développée par Symbolics. À lui tout seul, il abattait le même travail que des dizaines d’ingénieurs. Il n’avait bien entendu pas accès au code source et devait se contenter de la documentation de Symbolics pour deviner les principes de fonctionnement.
Le changement d’ambiance avait été graduel. Richard avait perdu ses amis, sa communauté. Il avait été forcé, à son corps défendant, de devenir un compétiteur plutôt qu’un collaborateur. Il ne s’en rendait pas complètement compte. Le problème était encore flou dans sa tête jusqu’au jour où une nouvelle imprimante fit son apparition dans les locaux du MIT.
Il faut savoir que, à l’époque, les imprimantes faisaient la taille d’un lit et avaient pas mal de problèmes. Sur la précédente, Richard avait bricolé un petit système envoyant automatiquement une alerte en cas de bourrage. Il n’avait pas réfléchi, il avait pris le code source de l’imprimante et l’avait modifié sans se poser de questions. Mais, contre toute attente, le code source de la nouvelle imprimante n’était pas livré avec. Le monde de l’informatique était encore tout petit et Richard avait une idée de qui, chez Xerox, avait pu écrire le logiciel faisant fonctionner l’imprimante. Profitant d’un voyage, il se rendit dans le bureau de la personne pour lui demander une copie.
La discussion fut très courte. La personne n’avait pas le droit de partager le code source. Et si elle le partageait, Richard devait signer un accord de non-divulgation. Il n’aurait, à son tour, pas le droit de partager.
Pas le droit de partager ? PAS LE DROIT DE PARTAGER ?
Le partage n’est-il pas l’essence même de l’humanité ? La connaissance ne repose-t-elle pas entièrement sur le partage intellectuel ?
Le ver glissé dans le fruit par Bill Gates commençait à faire son œuvre. Le monde commençait à souscrire à la philosophie selon laquelle faire de Bill Gates l’homme le plus riche du monde était une chose plus importante que le partage de la connaissance. Que la compétition devait nécessairement venir à bout de la collaboration. Les hackers avaient fini par enfiler une cravate et se soumettre aux avocats.
S’il ne faisait rien, Richard ne retrouverait plus jamais ses amis, sa communauté. Bouillonnant de colère, il décida de reconstruire, à lui tout seul, la communauté hacker. De la fédérer autour d’un projet que n’importe qui pourrait partager, améliorer, modifier. Que personne ne pourrait s’approprier.
Il nomma son projet « GNU », les initiales de « GNU’s Not Unix » et l’annonça sur le réseau Usenet le 27 septembre 1983. Il y a 40 ans aujourd’hui.
Bon anniversaire GNU.
Après cette annonce, Richard Stallman allait se mettre à réécrire chacun des très nombreux logiciels qui composaient le système Unix. Tout seul au début, il créait le système GNU de toutes pièces. Son seul échec fut le développement d’un noyau permettant de faire tourner GNU sur des ordinateurs sans avoir besoin d’un système non-GNU. Richard percevait le problème, car, en plus de coder, il développait la philosophie du partage et du libre. Il inventait les fondements du copyleft.
En 1991, en s’aidant des outils GNU, dont le compilateur GCC, un jeune Finlandais, Linus Torvalds, allait justement créer un noyau à partir de rien. Un noyau qu’il allait mettre sous la licence copyleft inventée par Stallman.
Mais ceci est une autre histoire…
Lectures suggérées :
- Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, par Richard Stallman, Sam Williams et Christophe Masutti
- The Daemon, the Gnu and the Penguin, par Peter H. Salus
- UNIX, A history and a Memoir, par Brian Kernighan
- Lion’s Commentary on UNIX 6th Edition with Source Code, par John Lions
- Lettre ouverte aux utilisateurs d’ordinateurs, par Bill Gates
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
There’s an increasing chasm dividing the modern web. On one side, the commercial, monopolies-riddled, media-adored web. A web which has only one objective: making us click. It measures clicks, optimises clicks, generates clicks. It gathers as much information as it could about us and spams every second of our life with ads, beep, notifications, vibrations, blinking LEDs, background music and fluorescent titles.
A web which boils down to Idiocracy in a Blade Runner landscape, a complete cyberpunk dystopia.
Then there’s the tech-savvy web. People who install adblockers or alternative browsers. People who try alternative networks such as Mastodon or, God forbid, Gemini. People who poke fun at the modern web by building true HTML and JavaScript-less pages.
Between those two extremes, the gap is widening. You have to choose your camp. When browsing on the "normal web", it is increasingly required to disable at least part of your antifeatures-blockers to access content.
Most of the time, I don’t bother anymore. The link I clicked doesn’t open or is wrangled? Yep, I’m probably blocking some important third-party JavaScript. No, I don’t care. I’ve too much to read on a day anyway. More time for something else. I’m currently using kagi.com as my main search engine on the web. And kagi.com comes with a nice feature, a "non-commercial lens" (which is somewhat ironic given the fact that Kagi is, itself, a commercial search engine). It means it will try to deprioritize highly commercial contents. I can also deprioritize manually some domains. Like facebook.com or linkedin.com. If you post there, I’m less likely to read you. I’ve not even talked about the few times I use marginalia.nu.
Something strange is happening: it’s not only a part of the web which is disappearing for me. As I’m blocking completely google analytics, every Facebook domain and any analytics I can, I’m also disappearing for them. I don’t see them and they don’t see me!
Think about it! That whole "MBA, designers and marketers web" is now optimised thanks to analytics describing people who don’t block analytics (and bots pretending to be those people). Each day, I feel more disconnected from that part of the web.
When really needed, dealing with those websites is so nerve breaking that I often resort to… a phone call or a simple email. I signed my mobile phone contract by exchanging emails with a real person because the signup was not working. I phone to book hotels when it is not straightforward to do it in the web interface or if creating an account is required. I hate talking on the phone but it saves me a lot of time and stress. I also walk or cycle to stores instead of ordering online. Which allows me to get advice and to exchange defective items without dealing with the post office.
Despite breaking up with what seems to be "The Web", I’ve never received so many emails commenting my blog posts. I rarely had as many interesting online conversations as I have on Mastodon. I’ve tens of really insightful contents to read every day in my RSS feeds, on Gemini, on Hacker News, on Mastodon. And, incredibly, a lot of them are on very minimalists and usable blogs. The funny thing is that when non-tech users see my blog or those I’m reading, they spontaneously tell me how beautiful and usable they are. It’s a bit like all those layers of JavaScript and flashy css have been used against usability, against them. Against us. It’s a bit like real users never cared about "cool designs" and only wanted something simple.
It feels like everyone is now choosing its side. You can’t stay in the middle anymore. You are either dedicating all your CPU cycles to run JavaScript tracking you or walking away from the big monopolies. You are either being paid to build huge advertising billboards on top of yet another framework or you are handcrafting HTML.
Maybe the web is not dying. Maybe the web is only splitting itself in two.
You know that famous "dark web" that journalists crave to write about? (at my request, one journalist once told me what "dark web" meant to him and it was "websites not easily accessible through a Google search".) Well, sometimes I feel like I’m part of that "dark web". Not to buy drugs or hire hitmen. No! It’s only to have a place where I can have discussions without being spied and interrupted by ads.
But, increasingly, I feel less and less like an outsider.
It’s not me. It’s people living for and by advertising who are the outsiders. They are the one destroying everything they touch, including the planet. They are the sick psychos and I don’t want them in my life anymore. Are we splitting from those click-conversion-funnel-obsessed weirdos? Good riddance! Have fun with them.
But if you want to jump ship, now is the time to get back to the simple web. Welcome back aboard!
- Traduction en français par Nicolas Vivant
- Traducción Española de JavierSam
- تُرجم النص للعربية من قِبل: يونس بن عمارة
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
There’s an increasing chasm dividing the modern web. On one side, the commercial, monopolies-riddled, media-adored web. A web which has only one objective: making us click. It measures clicks, optimises clicks, generates clicks. It gathers as much information as it could about us and spams every second of our life with ads, beep, notifications, vibrations, blinking LEDs, background music and fluorescent titles.
A web which boils down to Idiocracy in a Blade Runner landscape, a complete cyberpunk dystopia.
Then there’s the tech-savvy web. People who install adblockers or alternative browsers. People who try alternative networks such as Mastodon or, God forbid, Gemini. People who poke fun at the modern web by building true HTML and JavaScript-less pages.
Between those two extremes, the gap is widening. You have to choose your camp. When browsing on the "normal web", it is increasingly required to disable at least part of your antifeatures-blockers to access content.
Most of the time, I don’t bother anymore. The link I clicked doesn’t open or is wrangled? Yep, I’m probably blocking some important third-party JavaScript. No, I don’t care. I’ve too much to read on a day anyway. More time for something else. I’m currently using kagi.com as my main search engine on the web. And kagi.com comes with a nice feature, a "non-commercial lens" (which is somewhat ironic given the fact that Kagi is, itself, a commercial search engine). It means it will try to deprioritize highly commercial contents. I can also deprioritize manually some domains. Like facebook.com or linkedin.com. If you post there, I’m less likely to read you. I’ve not even talked about the few times I use marginalia.nu.
Something strange is happening: it’s not only a part of the web which is disappearing for me. As I’m blocking completely google analytics, every Facebook domain and any analytics I can, I’m also disappearing for them. I don’t see them and they don’t see me!
Think about it! That whole "MBA, designers and marketers web" is now optimised thanks to analytics describing people who don’t block analytics (and bots pretending to be those people). Each day, I feel more disconnected from that part of the web.
When really needed, dealing with those websites is so nerve breaking that I often resort to… a phone call or a simple email. I signed my mobile phone contract by exchanging emails with a real person because the signup was not working. I phone to book hotels when it is not straightforward to do it in the web interface or if creating an account is required. I hate talking on the phone but it saves me a lot of time and stress. I also walk or cycle to stores instead of ordering online. Which allows me to get advice and to exchange defective items without dealing with the post office.
Despite breaking up with what seems to be "The Web", I’ve never received so many emails commenting my blog posts. I rarely had as many interesting online conversations as I have on Mastodon. I’ve tens of really insightful contents to read every day in my RSS feeds, on Gemini, on Hacker News, on Mastodon. And, incredibly, a lot of them are on very minimalists and usable blogs. The funny thing is that when non-tech users see my blog or those I’m reading, they spontaneously tell me how beautiful and usable they are. It’s a bit like all those layers of JavaScript and flashy css have been used against usability, against them. Against us. It’s a bit like real users never cared about "cool designs" and only wanted something simple.
It feels like everyone is now choosing its side. You can’t stay in the middle anymore. You are either dedicating all your CPU cycles to run JavaScript tracking you or walking away from the big monopolies. You are either being paid to build huge advertising billboards on top of yet another framework or you are handcrafting HTML.
Maybe the web is not dying. Maybe the web is only splitting itself in two.
You know that famous "dark web" that journalists crave to write about? (at my request, one journalist once told me what "dark web" meant to him and it was "websites not easily accessible through a Google search".) Well, sometimes I feel like I’m part of that "dark web". Not to buy drugs or hire hitmen. No! It’s only to have a place where I can have discussions without being spied and interrupted by ads.
But, increasingly, I feel less and less like an outsider.
It’s not me. It’s people living for and by advertising who are the outsiders. They are the one destroying everything they touch, including the planet. They are the sick psychos and I don’t want them in my life anymore. Are we splitting from those click-conversion-funnel-obsessed weirdos? Good riddance! Have fun with them.
But if you want to jump ship, now is the time to get back to the simple web. Welcome back aboard!
- Traduction en français par Nicolas Vivant
- Traducción Española de JavierSam
- تُرجم النص للعربية من قِبل: يونس بن عمارة
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Pour une raison que j’ignore, mon compteur d’abonnés sur Mastodon s’est emballé et vient de franchir le cap de 6700. Ce chiffre porte une petite symbolique pour moi, car je ne pense pas l’avoir jamais franchi sur Twitter.
Si mes souvenirs sont bons, j’ai quitté Twitter avec environ 6600 abonnés, Google+ avec 3000 abonnés, Facebook avec 2500, LinkedIn et Medium avec 1500. Mastodon serait donc le réseau où j’ai historiquement le plus de succès (si l’on excepte l’éphémère compte Twitter du « Blog d’un condamné » qui avait attiré plus de 9000 personnes en quelques jours).
Faut-il être heureux que mon compte Mastodon fasse mieux en six ans que mon compte Twitter entre 2007 et 2021, date de sa suppression définitive ?
Où peut-être est-ce l’occasion de rappeler que, tout comme le like, dont j’ai précédemment détaillé l’inanité, le nombre de followers est une métrique absurde. Fausse. Et qui devrait être cachée.
Où l’on sépare les comptes qui comptent de ceux qui ne comptent pas
Les réseaux sociaux commerciaux vous vendent littéralement l’impression d’être suivis. Il n’y a aucun incitant à offrir un compte correct. Au contraire, tout est fait pour exagérer, gonfler.
Vos followers sont donc composés de comptes de robots, de comptes de sociétés qui suivent, mais ne lisent de toute façon pas les contenus, de comptes générés automatiquement et de toute cette panoplie de comptes inactifs, car la personne est passée à autre chose, a oublié son mot de passe ou, tout simplement, est décédée.
Sur Mastodon, mon intuition me dit que c’est « moins pire » grâce à la jeunesse du réseau. J’y ai déjà néanmoins vu des comptes de robots, des comptes de personnes qui ont testé et n’utilisent plus Mastodon ainsi que des comptes doublons, la personne ayant plusieurs comptes et me suivant sur chacun.
Au final, il y’a beaucoup moins d’humains que le compteur ne veut bien nous le laisser croire.
Où l’on se pose la question de l’utilité de tout cela
Mais même lorsqu’un compte représente un humain réel, un humain intéressé par ce que vous postez, encore faut-il qu’il vous lise lorsque votre contenu est noyé dans les 100, 200 ou 1000 autres comptes qu’il suit. Ou, tout simplement, n’est-il pas sur les réseaux sociaux ce jour-là ? Peut-être vous a-t-il vu et lu, entre deux autres messages.
Et alors ?
Je répète en anglais parce que ça donne un style plus théâtral.
So what ?
So feukinne watte ?
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvaient bien servir les followers ?
Tous ces autocollants vous invitant à suivre sur Facebook et Instagram la page de votre fleuriste, de votre plombier ou de votre boulangerie ? Sérieusement, qui s’est un jour dit en voyant un de ces autocollants « Cool, je vais suivre mon fleuriste, mon plombier et ma boulangère sur Facebook et Instagram » ?
Et quand bien même certains le font, certainement tonton Albert et cousine Géraldine qui n’habitent pas la ville, mais soutiennent la boulangère de la famille, pensez-vous que ça ait le moindre impact sur le business ?
À l’opposé, je suis avec assiduité une centaine de blogs par RSS. Je lis tout ce que ces personnes écrivent. Je réagis par mail. Je les partage en privé. J’achète également tous les livres de certains de mes auteurs favoris. Pourtant, je ne suis compté nulle part comme un follower.
Où l’on a la réponse à la question précédente
Militant pour le logiciel libre, le respect de la vie privée et le web non commercial, on pourrait arguer que mon public se trouve, par essence, sur Mastodon. (et me demander pourquoi je suis resté si longtemps sur les réseaux propriétaires. Je n’ai en effet aucune excuse).
Prenons un cas différent.
L’écrivain Henri Lœvenbruck a fermé ses comptes Facebook (29.000 followers), Twitter (10.000 followers) et Instagram (8.000 followers). Son dernier livre, « Les disparus de Blackmore », promu uniquement auprès des 5000 comptes qui le suivent sur Mastodon (et un peu LinkedIn, mais qu’est-ce qu’il fout encore là-bas ?) s’est pourtant beaucoup mieux vendu que le précédent.
Faut-il en déduire que les followers ne sont pas la recette miracle tant louée par… les sociétés publicitaires dont le business model repose à vouloir nous faire avoir à tout prix des followers ? D’ailleurs, entre nous, préférez-vous passer quelques heures à vous engueuler sur Twitter ou à flâner dans un univers typiquement Lœvenbruckien ? (Mystères lovercraftiens, grosses motos qui pétaradent, vieux whiskies qui se dégustent et quelques francs-maçons pour la figuration, on sent que l’auteur de « Nous rêvions juste de liberté » s’est fait plaisir, plaisir partagé avec les lecteurs et après on s’étonne que le bouquin se vende)
Si Lœvenbruck a pris un risque dans sa carrière pour des raisons éthiques et morales, force est de constater que le risque n’en était finalement pas un. Ses comptes Facebook/Instagram/Twitter ne vendaient pas de livres. Ce serait plutôt même le contraire.
Dans son livre "Digital Minimalism" et sur son blog, l’auteur Cal Newport s’est fait une spécialité d’illustrer le fait que beaucoup de succès modernes, qu’ils soient artistiques, entrepreneuriaux ou sportifs, se construisent non pas avec les réseaux sociaux, mais en arrivant à les mettre de côté. Une réflexion que j’ai moi-même esquissée alors que je tentais de me déconnecter.
La conclusion de tout cela est effrayante : nous nous sommes fait complètement avoir. Vraiment. La quête de followers est une arnaque totale qui, loin de nous apporter des bénéfices, nous coûte du temps, de l’énergie mentale, parfois de l’argent voire, dans certains cas, détruit notre business ou notre œuvre en nous forçant à modifier nos produits, nos créations pour attirer des followers.
Où l’on se rend compte des méfaits d’un simple chiffre
Car, pour certains créateurs, le nombre de followers est devenu une telle obsession qu’elle emprisonne. J’ai eu des discussions avec plusieurs personnes très influentes sur Twitter en leur demandant si elles comptaient ouvrir un compte sur Mastodon. Dans la plupart des cas, la réponse a été qu’elles restaient sur Twitter pour garder « leur communauté ». Leur "communauté" ? Quel bel euphémisme pour nommer un chiffre artificiellement gonflé qui les rend littéralement prisonnières. Et peut-être est-ce même une opportunité manquée.
Car un réseau n’est pas l’autre. Le bien connu blogueur-à-la-retraite-fourgueur-de-liens Sebsauvage a 4000 abonnés sur Twitter. Mais plus de 13000 sur Mastodon.
Est-ce que cela veut dire quelque chose ? Je ne le sais pas moi-même. Je rêve d’un Mastodon où le nombre de followers serait caché. Même de moi-même. Surtout de moi-même.
Avant de transformer nos lecteurs en numéros, peut-être est-il bon de se rappeler que nous sommes nous-mêmes des numéros. Que le simple fait d’avoir un compte Twitter ou Facebook, même non utilisé, permet d’augmenter de quelques dollars chaque année la fortune d’un Elon Musk ou d’un Mark Zuckerberg.
En ayant un compte sur une plateforme, nous la validons implicitement. Avoir un compte sur toutes les plateformes, comme Cory Doctorrow, revient à un vote nul. À dire « Moi je ne préfère rien, je m’adapte ».
Si nous voulons défendre certaines valeurs, la moindre des choses n’est-elle pas de ne pas soutenir les promoteurs des valeurs adverses ? De supprimer les comptes des plateformes avec lesquelles nous ne sommes pas moralement alignés ? Si nous ne sommes même pas capables de ce petit geste, avons-nous le moindre espoir de mettre en œuvre des causes plus importantes comme sauver la planète ?
Où l’on relativise et relativise la relativisation
Encore faut-il avoir le choix. Je discutais récemment avec un indépendant qui me disait que, dans son business, les clients envoient un message Whatsapp pour lui proposer une mission. S’il met plus de quelques dizaines de minutes à répondre, il reçoit généralement un « c’est bon, on a trouvé quelqu’un d’autre ». Il est donc obligé d’être sur Whatsapp en permanence. C’est peut-être vrai pour certaines professions et certains réseaux sociaux.
Mais combien se persuadent que LinkedIn, Facebook ou Instagram sont indispensables à leur business ? Qu’ils ne peuvent quitter Twitter sous peine de mettre à mal leur procrastin… leur veille technologique ?
Combien d’entre nous ne font que se donner des excuses, des justifications par simple angoisse d’avoir un jour à renoncer à ce chiffre qui scintille, qui augmente lentement, trop lentement, mais assez pour que l’on ait envie de le consulter tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
Que sommes-nous prêts à sacrifier de notre temps, de nos valeurs, de notre créativité simplement pour l’admirer ?
Notre nombre de followers.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
Pour une raison que j’ignore, mon compteur d’abonnés sur Mastodon s’est emballé et vient de franchir le cap de 6700. Ce chiffre porte une petite symbolique pour moi, car je ne pense pas l’avoir jamais franchi sur Twitter.
Si mes souvenirs sont bons, j’ai quitté Twitter avec environ 6600 abonnés, Google+ avec 3000 abonnés, Facebook avec 2500, LinkedIn et Medium avec 1500. Mastodon serait donc le réseau où j’ai historiquement le plus de succès (si l’on excepte l’éphémère compte Twitter du « Blog d’un condamné » qui avait attiré plus de 9000 personnes en quelques jours).
Faut-il être heureux que mon compte Mastodon fasse mieux en six ans que mon compte Twitter entre 2007 et 2021, date de sa suppression définitive ?
Où peut-être est-ce l’occasion de rappeler que, tout comme le like, dont j’ai précédemment détaillé l’inanité, le nombre de followers est une métrique absurde. Fausse. Et qui devrait être cachée.
Où l’on sépare les comptes qui comptent de ceux qui ne comptent pas
Les réseaux sociaux commerciaux vous vendent littéralement l’impression d’être suivis. Il n’y a aucun incitant à offrir un compte correct. Au contraire, tout est fait pour exagérer, gonfler.
Vos followers sont donc composés de comptes de robots, de comptes de sociétés qui suivent, mais ne lisent de toute façon pas les contenus, de comptes générés automatiquement et de toute cette panoplie de comptes inactifs, car la personne est passée à autre chose, a oublié son mot de passe ou, tout simplement, est décédée.
Sur Mastodon, mon intuition me dit que c’est « moins pire » grâce à la jeunesse du réseau. J’y ai déjà néanmoins vu des comptes de robots, des comptes de personnes qui ont testé et n’utilisent plus Mastodon ainsi que des comptes doublons, la personne ayant plusieurs comptes et me suivant sur chacun.
Au final, il y’a beaucoup moins d’humains que le compteur ne veut bien nous le laisser croire.
Où l’on se pose la question de l’utilité de tout cela
Mais même lorsqu’un compte représente un humain réel, un humain intéressé par ce que vous postez, encore faut-il qu’il vous lise lorsque votre contenu est noyé dans les 100, 200 ou 1000 autres comptes qu’il suit. Ou, tout simplement, n’est-il pas sur les réseaux sociaux ce jour-là ? Peut-être vous a-t-il vu et lu, entre deux autres messages.
Et alors ?
Je répète en anglais parce que ça donne un style plus théâtral.
So what ?
So feukinne watte ?
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvaient bien servir les followers ?
Tous ces autocollants vous invitant à suivre sur Facebook et Instagram la page de votre fleuriste, de votre plombier ou de votre boulangerie ? Sérieusement, qui s’est un jour dit en voyant un de ces autocollants « Cool, je vais suivre mon fleuriste, mon plombier et ma boulangère sur Facebook et Instagram » ?
Et quand bien même certains le font, certainement tonton Albert et cousine Géraldine qui n’habitent pas la ville, mais soutiennent la boulangère de la famille, pensez-vous que ça ait le moindre impact sur le business ?
À l’opposé, je suis avec assiduité une centaine de blogs par RSS. Je lis tout ce que ces personnes écrivent. Je réagis par mail. Je les partage en privé. J’achète également tous les livres de certains de mes auteurs favoris. Pourtant, je ne suis compté nulle part comme un follower.
Où l’on a la réponse à la question précédente
Militant pour le logiciel libre, le respect de la vie privée et le web non commercial, on pourrait arguer que mon public se trouve, par essence, sur Mastodon. (et me demander pourquoi je suis resté si longtemps sur les réseaux propriétaires. Je n’ai en effet aucune excuse).
Prenons un cas différent.
L’écrivain Henri Lœvenbruck a fermé ses comptes Facebook (29.000 followers), Twitter (10.000 followers) et Instagram (8.000 followers). Son dernier livre, « Les disparus de Blackmore », promu uniquement auprès des 5000 comptes qui le suivent sur Mastodon (et un peu LinkedIn, mais qu’est-ce qu’il fout encore là-bas ?) s’est pourtant beaucoup mieux vendu que le précédent.
Faut-il en déduire que les followers ne sont pas la recette miracle tant louée par… les sociétés publicitaires dont le business model repose à vouloir nous faire avoir à tout prix des followers ? D’ailleurs, entre nous, préférez-vous passer quelques heures à vous engueuler sur Twitter ou à flâner dans un univers typiquement Lœvenbruckien ? (Mystères lovercraftiens, grosses motos qui pétaradent, vieux whiskies qui se dégustent et quelques francs-maçons pour la figuration, on sent que l’auteur de « Nous rêvions juste de liberté » s’est fait plaisir, plaisir partagé avec les lecteurs et après on s’étonne que le bouquin se vende)
Si Lœvenbruck a pris un risque dans sa carrière pour des raisons éthiques et morales, force est de constater que le risque n’en était finalement pas un. Ses comptes Facebook/Instagram/Twitter ne vendaient pas de livres. Ce serait plutôt même le contraire.
Dans son livre "Digital Minimalism" et sur son blog, l’auteur Cal Newport s’est fait une spécialité d’illustrer le fait que beaucoup de succès modernes, qu’ils soient artistiques, entrepreneuriaux ou sportifs, se construisent non pas avec les réseaux sociaux, mais en arrivant à les mettre de côté. Une réflexion que j’ai moi-même esquissée alors que je tentais de me déconnecter.
La conclusion de tout cela est effrayante : nous nous sommes fait complètement avoir. Vraiment. La quête de followers est une arnaque totale qui, loin de nous apporter des bénéfices, nous coûte du temps, de l’énergie mentale, parfois de l’argent voire, dans certains cas, détruit notre business ou notre œuvre en nous forçant à modifier nos produits, nos créations pour attirer des followers.
Où l’on se rend compte des méfaits d’un simple chiffre
Car, pour certains créateurs, le nombre de followers est devenu une telle obsession qu’elle emprisonne. J’ai eu des discussions avec plusieurs personnes très influentes sur Twitter en leur demandant si elles comptaient ouvrir un compte sur Mastodon. Dans la plupart des cas, la réponse a été qu’elles restaient sur Twitter pour garder « leur communauté ». Leur "communauté" ? Quel bel euphémisme pour nommer un chiffre artificiellement gonflé qui les rend littéralement prisonnières. Et peut-être est-ce même une opportunité manquée.
Car un réseau n’est pas l’autre. Le bien connu blogueur-à-la-retraite-fourgueur-de-liens Sebsauvage a 4000 abonnés sur Twitter. Mais plus de 13000 sur Mastodon.
Est-ce que cela veut dire quelque chose ? Je ne le sais pas moi-même. Je rêve d’un Mastodon où le nombre de followers serait caché. Même de moi-même. Surtout de moi-même.
Avant de transformer nos lecteurs en numéros, peut-être est-il bon de se rappeler que nous sommes nous-mêmes des numéros. Que le simple fait d’avoir un compte Twitter ou Facebook, même non utilisé, permet d’augmenter de quelques dollars chaque année la fortune d’un Elon Musk ou d’un Mark Zuckerberg.
En ayant un compte sur une plateforme, nous la validons implicitement. Avoir un compte sur toutes les plateformes, comme Cory Doctorrow, revient à un vote nul. À dire « Moi je ne préfère rien, je m’adapte ».
Si nous voulons défendre certaines valeurs, la moindre des choses n’est-elle pas de ne pas soutenir les promoteurs des valeurs adverses ? De supprimer les comptes des plateformes avec lesquelles nous ne sommes pas moralement alignés ? Si nous ne sommes même pas capables de ce petit geste, avons-nous le moindre espoir de mettre en œuvre des causes plus importantes comme sauver la planète ?
Où l’on relativise et relativise la relativisation
Encore faut-il avoir le choix. Je discutais récemment avec un indépendant qui me disait que, dans son business, les clients envoient un message Whatsapp pour lui proposer une mission. S’il met plus de quelques dizaines de minutes à répondre, il reçoit généralement un « c’est bon, on a trouvé quelqu’un d’autre ». Il est donc obligé d’être sur Whatsapp en permanence. C’est peut-être vrai pour certaines professions et certains réseaux sociaux.
Mais combien se persuadent que LinkedIn, Facebook ou Instagram sont indispensables à leur business ? Qu’ils ne peuvent quitter Twitter sous peine de mettre à mal leur procrastin… leur veille technologique ?
Combien d’entre nous ne font que se donner des excuses, des justifications par simple angoisse d’avoir un jour à renoncer à ce chiffre qui scintille, qui augmente lentement, trop lentement, mais assez pour que l’on ait envie de le consulter tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
Que sommes-nous prêts à sacrifier de notre temps, de nos valeurs, de notre créativité simplement pour l’admirer ?
Notre nombre de followers.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain, tant par écrit que dans mes conférences.
Recevez directement par mail mes écrits en français et en anglais. Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous pouvez également utiliser mon flux RSS francophone ou le flux RSS complet.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
Lot is happening in the social network landscape with the demises of Twitter and Reddit, the apparition of Bluesky and Threads, the growing popularity of Mastodon. Many pundits are trying to guess which one will be successful and trying to explain why others will fail. Which completely misses the point.
Particular social networks will never "succeed". Nobody even agree on the definition of "success".
The problem is that we all see our little bubble and generalise what we observe as universal. We have a hard time understanding Mastodon ? Mastodon will never succeed, it will be for a niche. A few of our favourite web stars goes to Bluesky ? Bluesky is the future, everybody will be there.
That’s not how it works. That’s not how it ever worked.
Like every human endeavour, every social network is there for a limited duration and will be useful to a limited niche of people. That niche may grow to the point of being huge, like Facebook and WhatsApp. But, to this day, there are more people in the world without an account on Facebook than people with one. Every single social network is only representative of a minority. And the opposite would be terrifying when you think about it (which is exactly what Meta is trying to build).
Social networks are fluid. They come, they go. For commercial social networks, the success is defined by: "do they earn enough money to make investors happy ?" There’s no metric of success for non-commercial ones. They simply exist as long as at least two users are using them to communicate. Which is why criticisms like "Mastodon could never raise enough money" or "the Fediverse will never succeed" totally miss the point.
If you live in the same occidental bubble as me, you might have never heard of WeChat, QQ or VK. Those are immensely popular social networks. In China and Russia. WeChat alone is more or less the size of Instagram in terms of active users. The war in Ukraine also demonstrated that the most popular social network in that part of the world is Telegram. Which is twice as big as Twitter but, for whatever reason, is barely mentioned in my own circles. The lesson here is simple: you are living in a small niche. We all do. Your experience is not representative of anything but your own. And it’s fine.
There will never be one social network to rule them all. There should never be one social network to rule them all. In fact, tech-savvy people should fight to ensure that no social network ever "succeed".
Human lives in communities. We join them, we sometimes leave them. Social networks should only be an underlying infrastructure to support our communities. Social networks are not our communities. Social network dies. Communities migrate and flock to different destinations. Nothing ever replaced Google+, which was really popular in my own tech circle. Nothing will replace Twitter or Reddit. Some communities will find a new home on Mastodon or on Lemmy. Some will go elsewhere. That’s not a problem as long as you can have multiple accounts in different places. Something I’m sure you do. Communities can be split. Communities can be merged. People can be part of several communities and several platforms.
Silicon Valley venture capitalists are trying to convince us that, one day, a social network will succeed, will become universal. That it should grow. That social networks are our communities. That your community should grow to succeed.
This is a lie, a delusion. Our communities are worth a lot more than the underlying tool used at some point in time. By accepting the confusion, we are destroying our communities. We are selling them, we are transforming them into a simple commercial asset for the makers of the tool we are using, the tool which exploits us.
Stop trying to make social networks succeed, stop dreaming of a universal network. Instead, invest in your own communities. Help them make long-term, custom and sustainable solutions. Try to achieve small and local successes instead of pursuing an imaginary universal one. It will make you happier.
It will make all of us happier.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Lot is happening in the social network landscape with the demises of Twitter and Reddit, the apparition of Bluesky and Threads, the growing popularity of Mastodon. Many pundits are trying to guess which one will be successful and trying to explain why others will fail. Which completely misses the point.
Particular social networks will never "succeed". Nobody even agree on the definition of "success".
The problem is that we all see our little bubble and generalise what we observe as universal. We have a hard time understanding Mastodon ? Mastodon will never succeed, it will be for a niche. A few of our favourite web stars goes to Bluesky ? Bluesky is the future, everybody will be there.
That’s not how it works. That’s not how it ever worked.
Like every human endeavour, every social network is there for a limited duration and will be useful to a limited niche of people. That niche may grow to the point of being huge, like Facebook and WhatsApp. But, to this day, there are more people in the world without an account on Facebook than people with one. Every single social network is only representative of a minority. And the opposite would be terrifying when you think about it (which is exactly what Meta is trying to build).
Social networks are fluid. They come, they go. For commercial social networks, the success is defined by: "do they earn enough money to make investors happy ?" There’s no metric of success for non-commercial ones. They simply exist as long as at least two users are using them to communicate. Which is why criticisms like "Mastodon could never raise enough money" or "the Fediverse will never succeed" totally miss the point.
If you live in the same occidental bubble as me, you might have never heard of WeChat, QQ or VK. Those are immensely popular social networks. In China and Russia. WeChat alone is more or less the size of Instagram in terms of active users. The war in Ukraine also demonstrated that the most popular social network in that part of the world is Telegram. Which is twice as big as Twitter but, for whatever reason, is barely mentioned in my own circles. The lesson here is simple: you are living in a small niche. We all do. Your experience is not representative of anything but your own. And it’s fine.
There will never be one social network to rule them all. There should never be one social network to rule them all. In fact, tech-savvy people should fight to ensure that no social network ever "succeed".
Human lives in communities. We join them, we sometimes leave them. Social networks should only be an underlying infrastructure to support our communities. Social networks are not our communities. Social network dies. Communities migrate and flock to different destinations. Nothing ever replaced Google+, which was really popular in my own tech circle. Nothing will replace Twitter or Reddit. Some communities will find a new home on Mastodon or on Lemmy. Some will go elsewhere. That’s not a problem as long as you can have multiple accounts in different places. Something I’m sure you do. Communities can be split. Communities can be merged. People can be part of several communities and several platforms.
Silicon Valley venture capitalists are trying to convince us that, one day, a social network will succeed, will become universal. That it should grow. That social networks are our communities. That your community should grow to succeed.
This is a lie, a delusion. Our communities are worth a lot more than the underlying tool used at some point in time. By accepting the confusion, we are destroying our communities. We are selling them, we are transforming them into a simple commercial asset for the makers of the tool we are using, the tool which exploits us.
Stop trying to make social networks succeed, stop dreaming of a universal network. Instead, invest in your own communities. Help them make long-term, custom and sustainable solutions. Try to achieve small and local successes instead of pursuing an imaginary universal one. It will make you happier.
It will make all of us happier.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Et pourquoi c’est une bonne chose.
Google, pardon Alphabet, Facebook, pardon Meta, Twitter, Netflix, Amazon, Microsoft. Tous ces géants font partie intégrante de notre quotidien. Tous ont la particularité d’être 100% américains.
La Chine n’est pas complètement en reste avec Alibaba, Tiktok et d’autres moins populaire chez nous, mais brassant des milliards d’utilisateurs.
Et en Europe ? Beaucoup moins, au grand dam des politiciens qui ont l’impression que le bonheur d’une population, et donc ses votes, se mesure au nombre de milliardaires qu’elle produit.
Pourtant, dans le domaine Internet, l’Europe est loin d’être ridicule. Elle est même primordiale.
Car si Internet, interconnexion entre les ordinateurs du monde entier, existait depuis la fin des années 60, aucun protocole ne permettait de trouver de l’information. Il fallait savoir exactement ce que l’on cherchait. Pour combler cette lacune, Gopher fut développé aux États-Unis tandis que le Web, combinaison du protocole HTTP et du langage HTML, était inventé par un citoyen britannique et un citoyen belge qui travaillaient dans un centre de recherche européen situé en Suisse. Mais, anecdote croustillante, leur bureau débordait la frontière et on peut dire aujourd’hui que le Web a été inventé en France. Difficile de faire plus européen comme invention ! On dirait la blague européenne officielle ! (Note: tout comme Pluton restera toujours une planète, les Britanniques resteront toujours européens. Le Brexit n’est qu’une anecdote historique que la jeune génération s’empressera, j’espère, de corriger).
Bien que populaire et toujours existant aujourd’hui, Gopher ne se développera jamais réellement comme le Web pour une sombre histoire de droits et de licence, tué dans l’œuf par la quête de succès économique immédiat.
Alors même que Robert Cailliau et Tim Berners-Lee inventaient le Web dans leur bureau du CERN, un étudiant finlandais issu de la minorité suédoise du pays concevait Linux et le rendait public. Pour le simple fait de s’amuser. Linux est aujourd’hui le système d’exploitation le plus populaire du monde. Il fait tourner les téléphones Android, les plus gros serveurs Web, les satellites dans l’espace, les ordinateurs des programmeurs, les montres connectées, les mini-ordinateurs. Il est partout. Linus Torvalds, son inventeur, n’est pas milliardaire et trouve ça très bien. Cela n’a jamais été son objectif.
Mastodon, l’alternative décentralisée à Twitter créée par un étudiant allemand ayant grandi en Russie, a le simple objectif de permettre aux utilisateurs des réseaux sociaux de se passer des monopoles industriels et de pouvoir échanger de manière saine, intime, sans se faire agresser ni se faire bombarder de pub. La pub et l’invasion de la vie privée, deux fléaux du Web moderne ! C’est d’ailleurs en réaction qu’a été créé le réseau Gemini, une alternative au Web conçue explicitement pour empêcher toute dérive commerciale et remettre l’humain au centre. Le réseau Gemini a été conçu et initié par un programmeur vivant en Finlande et souhaitant garder l’anonymat. Contrairement à beaucoup de projets logiciels, Gemini n’évolue plus à dessein. Le protocole est considéré comme terminé et n’importe qui peut désormais publier sur Gemini ou développer des logiciels l’utilisant en ayant la certitude qu’ils resteront compatibles tant qu’il y’aura des utilisateurs.
On entend souvent que les Européens n’ont pas la culture du succès. Ces quelques exemples, et il y’en a bien d’autres, prouvent le contraire. Les Européens aiment le succès, mais pas au détriment du reste de la société. Un succès est perçu comme une œuvre pérenne, s’inscrivant dans la durée, bénéficiant à tous les citoyens, à toute la société voire à tout le genre humain.
Google, Microsoft, Facebook peuvent disparaître demain. Il est même presque certain que ces entreprises n’existent plus d’ici quarante ou cinquante ans. Ce serait même potentiellement une excellente chose. Mais pouvez-vous imaginer un monde sans le Web ? Un monde sans HTML ? Un monde sans Linux ? Ces inventions, initialement européennes, sont devenues des piliers de l’humanité, sont des technologies désormais indissociables de notre histoire.
La vision américaine du succès est souvent restreinte à la taille d’une entreprise ou la fortune de son fondateur. Mais pouvons-nous arrêter de croire que le succès est équivalent à la croissance ? Et si le succès se mesurait à l’utilité, à la pérennité ? Si nous commencions à valoriser les découvertes, les fondations technologiques léguées à l’humanité ? Si l’on prend le monde à la lueur de ces nouvelles métriques, si le succès n’est plus la mesure du nombre de portefeuilles vidés pour mettre le contenu dans le plus petit nombre de poches possible, alors l’Europe est incroyablement riche en succès.
Et peut-être est-ce une bonne chose de promouvoir ces succès, d’en être fier ?
Certains sont fiers de s’être enrichis en coupant le plus d’arbres possible. D’autres sont fiers d’avoir planté des arbres qui bénéficieront aux générations futures. Et si le véritable succès était de bonifier, d’entretenir et d’augmenter les communs au lieu d’en privatiser une partie ?
À nous de choisir les succès que nous voulons admirer. C’est en choisissant de qui nous chantons les louanges que nous décidons de la direction dès progrès futurs.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain. Abonnez-vous à mes écrits en français par mail ou par rss. Pour mes écrits en anglais, abonnez-vous à la newsletter anglophone ou au flux RSS complet. Votre adresse n’est jamais partagée et effacée au désabonnement.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
Et pourquoi c’est une bonne chose.
Google, pardon Alphabet, Facebook, pardon Meta, Twitter, Netflix, Amazon, Microsoft. Tous ces géants font partie intégrante de notre quotidien. Tous ont la particularité d’être 100% américains.
La Chine n’est pas complètement en reste avec Alibaba, Tiktok et d’autres moins populaire chez nous, mais brassant des milliards d’utilisateurs.
Et en Europe ? Beaucoup moins, au grand dam des politiciens qui ont l’impression que le bonheur d’une population, et donc ses votes, se mesure au nombre de milliardaires qu’elle produit.
Pourtant, dans le domaine Internet, l’Europe est loin d’être ridicule. Elle est même primordiale.
Car si Internet, interconnexion entre les ordinateurs du monde entier, existait depuis la fin des années 60, aucun protocole ne permettait de trouver de l’information. Il fallait savoir exactement ce que l’on cherchait. Pour combler cette lacune, Gopher fut développé aux États-Unis tandis que le Web, combinaison du protocole HTTP et du langage HTML, était inventé par un citoyen britannique et un citoyen belge qui travaillaient dans un centre de recherche européen situé en Suisse. Mais, anecdote croustillante, leur bureau débordait la frontière et on peut dire aujourd’hui que le Web a été inventé en France. Difficile de faire plus européen comme invention ! On dirait la blague européenne officielle ! (Note: tout comme Pluton restera toujours une planète, les Britanniques resteront toujours européens. Le Brexit n’est qu’une anecdote historique que la jeune génération s’empressera, j’espère, de corriger).
Bien que populaire et toujours existant aujourd’hui, Gopher ne se développera jamais réellement comme le Web pour une sombre histoire de droits et de licence, tué dans l’œuf par la quête de succès économique immédiat.
Alors même que Robert Cailliau et Tim Berners-Lee inventaient le Web dans leur bureau du CERN, un étudiant finlandais issu de la minorité suédoise du pays concevait Linux et le rendait public. Pour le simple fait de s’amuser. Linux est aujourd’hui le système d’exploitation le plus populaire du monde. Il fait tourner les téléphones Android, les plus gros serveurs Web, les satellites dans l’espace, les ordinateurs des programmeurs, les montres connectées, les mini-ordinateurs. Il est partout. Linus Torvalds, son inventeur, n’est pas milliardaire et trouve ça très bien. Cela n’a jamais été son objectif.
Mastodon, l’alternative décentralisée à Twitter créée par un étudiant allemand ayant grandi en Russie, a le simple objectif de permettre aux utilisateurs des réseaux sociaux de se passer des monopoles industriels et de pouvoir échanger de manière saine, intime, sans se faire agresser ni se faire bombarder de pub. La pub et l’invasion de la vie privée, deux fléaux du Web moderne ! C’est d’ailleurs en réaction qu’a été créé le réseau Gemini, une alternative au Web conçue explicitement pour empêcher toute dérive commerciale et remettre l’humain au centre. Le réseau Gemini a été conçu et initié par un programmeur vivant en Finlande et souhaitant garder l’anonymat. Contrairement à beaucoup de projets logiciels, Gemini n’évolue plus à dessein. Le protocole est considéré comme terminé et n’importe qui peut désormais publier sur Gemini ou développer des logiciels l’utilisant en ayant la certitude qu’ils resteront compatibles tant qu’il y’aura des utilisateurs.
On entend souvent que les Européens n’ont pas la culture du succès. Ces quelques exemples, et il y’en a bien d’autres, prouvent le contraire. Les Européens aiment le succès, mais pas au détriment du reste de la société. Un succès est perçu comme une œuvre pérenne, s’inscrivant dans la durée, bénéficiant à tous les citoyens, à toute la société voire à tout le genre humain.
Google, Microsoft, Facebook peuvent disparaître demain. Il est même presque certain que ces entreprises n’existent plus d’ici quarante ou cinquante ans. Ce serait même potentiellement une excellente chose. Mais pouvez-vous imaginer un monde sans le Web ? Un monde sans HTML ? Un monde sans Linux ? Ces inventions, initialement européennes, sont devenues des piliers de l’humanité, sont des technologies désormais indissociables de notre histoire.
La vision américaine du succès est souvent restreinte à la taille d’une entreprise ou la fortune de son fondateur. Mais pouvons-nous arrêter de croire que le succès est équivalent à la croissance ? Et si le succès se mesurait à l’utilité, à la pérennité ? Si nous commencions à valoriser les découvertes, les fondations technologiques léguées à l’humanité ? Si l’on prend le monde à la lueur de ces nouvelles métriques, si le succès n’est plus la mesure du nombre de portefeuilles vidés pour mettre le contenu dans le plus petit nombre de poches possible, alors l’Europe est incroyablement riche en succès.
Et peut-être est-ce une bonne chose de promouvoir ces succès, d’en être fier ?
Certains sont fiers de s’être enrichis en coupant le plus d’arbres possible. D’autres sont fiers d’avoir planté des arbres qui bénéficieront aux générations futures. Et si le véritable succès était de bonifier, d’entretenir et d’augmenter les communs au lieu d’en privatiser une partie ?
À nous de choisir les succès que nous voulons admirer. C’est en choisissant de qui nous chantons les louanges que nous décidons de la direction dès progrès futurs.
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain. Abonnez-vous à mes écrits en français par mail ou par rss. Pour mes écrits en anglais, abonnez-vous à la newsletter anglophone ou au flux RSS complet. Votre adresse n’est jamais partagée et effacée au désabonnement.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
The year is 2023. The whole Internet is under the control of the GAFAM empire. All of it? Well, not entirely. Because a few small villages are resisting the oppression. And some of those villages started to agregate, forming the "Fediverse".
With debates around Twitter and Reddit, the Fediverse started to gain fame and attention. People started to use it for real. The empire started to notice.
Capitalists Against Competition
As Peter Thiel, one of Facebook’s prominent investor, put it: "Competition is for losers." Yep, those pseudo "market is always right" people don’t want a market when they are in it. They want a monopoly. Since its inception, Facebook have been very careful to kill every competition. The easiest way of doing it being by buying companies that could, one day, become competitors. Instagram, WhatsApp to name a few, were bought only because their product attracted users and could cast a shadow on Facebook.
But the Fediverse cannot be bought. The Fediverse is an informal group of servers discussing through a protocol (ActivityPub). Those servers may even run different software (Mastodon is the most famous but you could also have Pleroma, Pixelfed, Peertube, WriteFreely, Lemmy and many others).
You cannot buy a decentralised network!
But there’s another way: make it irrelevant. That’s exactly what Google did with XMPP.
How Google joined the XMPP federation
At the end of the 20th century, instant messengers (IM) were all the rage. One of the first very successful ones was ICQ, quickly followed by MSN messenger. MSN Messenger was the Tiktok of the time: a world where teenagers could spend hours and days without adults.
As MSN was part of Microsoft, Google wanted to compete and offered Google Talk in 2005, including it in the Gmail interface. Remember that, at the time, there was no smartphone and very little web app. Applications had to be installed on the computer and Gmail web interface was groundbreaking. MSN was even at some point bundled with Microsoft Windows and it was really hard to remove it. Building Google chat with the Gmail web interface was a way to be even closer to the customers than a built-in software in the operating system.
While Google and Microsoft were fighting to achieve hegemony, free software geeks were trying to build decentralised instant messaging. Like email, XMPP was a federated protocol: multiple servers could talk together through a protocol and each user would connect to one particular server through a client. That user could then communicate with any user on any server using any client. Which is still how ActivityPub and thus the Fediverse work.
In 2006, Google talk became XMPP compatible. Google was seriously considering XMPP. In 2008, while I was at work, my phone rang. On the line, someone told me: "Hi, it’s Google and we want to hire you." I made several calls and it turned out that they found me through the XMPP-dev list and were looking for XMPP servers sysadmins.
So Google was really embracing the federation. How cool was that? It meant that, suddenly, every single Gmail user became an XMPP user. This could only be good for XMPP, right? I was ecstatic.
How Google killed XMPP
Of course, reality was a bit less shiny. First of all, despites collaborating to develop the XMPP standard, Google was doing its own closed implementation that nobody could review. It turns out they were not always respecting the protocol they were developing. They were not implementing everything. This forced XMPP development to be slowed down, to adapt. Nice new features were not implemented or not used in XMPP clients because they were not compatible with Google Talk (avatars took an awful long time to come to XMPP). Federation was sometimes broken: for hours or days, there would not be communications possible between Google and regular XMPP servers. The XMPP community became watchers and debuggers of Google’s servers, posting irregularities and downtime (I did it several times, which is probably what prompted the job offer).
And because there were far more Google talk users than "true XMPP" users, there was little room for "not caring about Google talk users". Newcomers discovering XMPP and not being Google talk users themselves had very frustrating experience because most of their contact were Google Talk users. They thought they could communicate easily with them but it was basically a degraded version of what they had while using Google talk itself. A typical XMPP roster was mainly composed of Google Talk users with a few geeks.
In 2013, Google realised that most XMPP interactions were between Google Talk users anyway. They didn’t care about respecting a protocol they were not 100% in control. So they pulled the plug and announced they would not be federated anymore. And started a long quest to create a messenger, starting with Hangout (which was followed by Allo, Duo. I lost count after that).
As expected, no Google user bated an eye. In fact, none of them realised. At worst, some of their contacts became offline. That was all. But for the XMPP federation, it was like the majority of users suddenly disappeared. Even XMPP die hard fanatics, like your servitor, had to create Google accounts to keep contact with friends. Remember: for them, we were simply offline. It was our fault.
While XMPP still exist and is a very active community, it never recovered from this blow. Too high expectation with Google adoption led to a huge disappointment and a silent fall into oblivion. XMPP became niche. So niche that when group chats became all the rage (Slack, Discord), the free software community reinvented it (Matrix) to compete while group chats were already possible with XMPP. (Disclaimer: I’ve never studied the Matrix protocol so I have no idea how it technically compares with XMPP. I simply believe that it solves the same problem and compete in the same space as XMPP).
Would XMPP be different today if Google never joined it or was never considered as part of it? Nobody could say. But I’m convinced that it would have grown slower and, maybe, healthier. That it would be bigger and more important than it is today. That it would be the default decentralised communication platform. One thing is sure: if Google had not joined, XMPP would not be worse than it is today.
It was not the first: the Microsoft Playbook
What Google did to XMPP was not new. In fact, in 1998, Microsoft engineer Vinod Vallopllil explicitly wrote a text titled "Blunting OSS attacks" where he suggested to "de-commoditize protocols & applications […]. By extending these protocols and developing new protocols, we can deny OSS project’s entry into the market."
Microsoft put that theory in practice with the release of Windows 2000 which offered support for the Kerberos security protocol. But that protocol was extended. The specifications of those extensions could be freely downloaded but required to accept a license which forbid you to implement those extensions. As soon as you clicked "OK", you could not work on any open source version of Kerberos. The goal was explicitly to kill any competing networking project such as Samba.
This anecdote was told Glyn Moody in his book "Rebel Code" and demonstrates that killing open source and decentralised projects are really conscious objectives. It never happens randomly and is never caused by bad luck.
Microsoft used a similar tactic to ensure dominance in the office market with Microsoft Office using proprietary formats (a file format could be seen as a protocol to exchange data). When alternatives (OpenOffice then LibreOffice) became good enough at opening doc/xls/ppt formats, Microsoft released a new format that they called "open and standardised". The format was, on purpose, very complicated (20.000 pages of specifications!) and, most importantly, wrong. Yes, some bugs were introduced in the specification meaning that a software implementing the full OOXML format would behave differently than Microsoft Office.
Those bugs, together with political lobbying, were one of the reasons that pushed the city of Munich to revert its Linux migration. So yes, the strategy works well. Today, docx, xlsx and pptx are still the norms because of that. Source: I was there, indirectly paid by the city of Munich to make LibreOffice OOXML’s rendering closer to Microsoft’s instead of following the specifications.
UPDATE:
Meta and the Fediverse
People who don’t know history are doomed to repeat it. Which is exactly what is happening with Meta and the Fediverse.
There are rumours that Meta would become "Fediverse compatible". You could follow people on Instagram from your Mastodon account.
I don’t know if those rumours have a grain of truth, if it is even possible for Meta to consider it. But there’s one thing my own experience with XMPP and OOXML taught me: if Meta joins the Fediverse, Meta will be the only one winning. In fact, reactions show that they are already winning: the Fediverse is split between blocking Meta or not. If that happens, this would mean a fragmented, frustrating two-tier fediverse with little appeal for newcomers.
UPDATE: Those rumours have been confirmed as at least one Mastodon admin, kev, from fosstodon.org, has been contacted to take part in an off-the-record meeting with Meta. He had the best possible reaction: he refused politely and, most importantly, published the email to be transparent with its users. Thanks kev!
I know we all dream of having all our friends and family on the Fediverse so we can avoid proprietary networks completely. But the Fediverse is not looking for market dominance or profit. The Fediverse is not looking for growth. It is offering a place for freedom. People joining the Fediverse are those looking for freedom. If people are not ready or are not looking for freedom, that’s fine. They have the right to stay on proprietary platforms. We should not force them into the Fediverse. We should not try to include as many people as we can at all cost. We should be honest and ensure people join the Fediverse because they share some of the values behind it.
By competing against Meta in the brainless growth-at-all-cost ideology, we are certain to lose. They are the master of that game. They are trying to bring everyone in their field, to make people compete against them using the weapons they are selling.
Fediverse can only win by keeping its ground, by speaking about freedom, morals, ethics, values. By starting open, non-commercial and non-spied discussions. By acknowledging that the goal is not to win. Not to embrace. The goal is to stay a tool. A tool dedicated to offer a place of freedom for connected human beings. Something that no commercial entity will ever offer.
- Picture by David Revoy
- Traduction en Français par Nicolas Vivant
- Traducción Española de Matii
- Deutsche Übersetzung von Janet und anderen
- Traduzione italiana di Nilocram
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
The year is 2023. The whole Internet is under the control of the GAFAM empire. All of it? Well, not entirely. Because a few small villages are resisting the oppression. And some of those villages started to agregate, forming the "Fediverse".
With debates around Twitter and Reddit, the Fediverse started to gain fame and attention. People started to use it for real. The empire started to notice.
Capitalists Against Competition
As Peter Thiel, one of Facebook’s prominent investor, put it: "Competition is for losers." Yep, those pseudo "market is always right" people don’t want a market when they are in it. They want a monopoly. Since its inception, Facebook have been very careful to kill every competition. The easiest way of doing it being by buying companies that could, one day, become competitors. Instagram, WhatsApp to name a few, were bought only because their product attracted users and could cast a shadow on Facebook.
But the Fediverse cannot be bought. The Fediverse is an informal group of servers discussing through a protocol (ActivityPub). Those servers may even run different software (Mastodon is the most famous but you could also have Pleroma, Pixelfed, Peertube, WriteFreely, Lemmy and many others).
You cannot buy a decentralised network!
But there’s another way: make it irrelevant. That’s exactly what Google did with XMPP.
How Google joined the XMPP federation
At the end of the 20th century, instant messengers (IM) were all the rage. One of the first very successful ones was ICQ, quickly followed by MSN messenger. MSN Messenger was the Tiktok of the time: a world where teenagers could spend hours and days without adults.
As MSN was part of Microsoft, Google wanted to compete and offered Google Talk in 2005, including it in the Gmail interface. Remember that, at the time, there was no smartphone and very little web app. Applications had to be installed on the computer and Gmail web interface was groundbreaking. MSN was even at some point bundled with Microsoft Windows and it was really hard to remove it. Building Google chat with the Gmail web interface was a way to be even closer to the customers than a built-in software in the operating system.
While Google and Microsoft were fighting to achieve hegemony, free software geeks were trying to build decentralised instant messaging. Like email, XMPP was a federated protocol: multiple servers could talk together through a protocol and each user would connect to one particular server through a client. That user could then communicate with any user on any server using any client. Which is still how ActivityPub and thus the Fediverse work.
In 2006, Google talk became XMPP compatible. Google was seriously considering XMPP. In 2008, while I was at work, my phone rang. On the line, someone told me: "Hi, it’s Google and we want to hire you." I made several calls and it turned out that they found me through the XMPP-dev list and were looking for XMPP servers sysadmins.
So Google was really embracing the federation. How cool was that? It meant that, suddenly, every single Gmail user became an XMPP user. This could only be good for XMPP, right? I was ecstatic.
How Google killed XMPP
Of course, reality was a bit less shiny. First of all, despites collaborating to develop the XMPP standard, Google was doing its own closed implementation that nobody could review. It turns out they were not always respecting the protocol they were developing. They were not implementing everything. This forced XMPP development to be slowed down, to adapt. Nice new features were not implemented or not used in XMPP clients because they were not compatible with Google Talk (avatars took an awful long time to come to XMPP). Federation was sometimes broken: for hours or days, there would not be communications possible between Google and regular XMPP servers. The XMPP community became watchers and debuggers of Google’s servers, posting irregularities and downtime (I did it several times, which is probably what prompted the job offer).
And because there were far more Google talk users than "true XMPP" users, there was little room for "not caring about Google talk users". Newcomers discovering XMPP and not being Google talk users themselves had very frustrating experience because most of their contact were Google Talk users. They thought they could communicate easily with them but it was basically a degraded version of what they had while using Google talk itself. A typical XMPP roster was mainly composed of Google Talk users with a few geeks.
In 2013, Google realised that most XMPP interactions were between Google Talk users anyway. They didn’t care about respecting a protocol they were not 100% in control. So they pulled the plug and announced they would not be federated anymore. And started a long quest to create a messenger, starting with Hangout (which was followed by Allo, Duo. I lost count after that).
As expected, no Google user bated an eye. In fact, none of them realised. At worst, some of their contacts became offline. That was all. But for the XMPP federation, it was like the majority of users suddenly disappeared. Even XMPP die hard fanatics, like your servitor, had to create Google accounts to keep contact with friends. Remember: for them, we were simply offline. It was our fault.
While XMPP still exist and is a very active community, it never recovered from this blow. Too high expectation with Google adoption led to a huge disappointment and a silent fall into oblivion. XMPP became niche. So niche that when group chats became all the rage (Slack, Discord), the free software community reinvented it (Matrix) to compete while group chats were already possible with XMPP. (Disclaimer: I’ve never studied the Matrix protocol so I have no idea how it technically compares with XMPP. I simply believe that it solves the same problem and compete in the same space as XMPP).
Would XMPP be different today if Google never joined it or was never considered as part of it? Nobody could say. But I’m convinced that it would have grown slower and, maybe, healthier. That it would be bigger and more important than it is today. That it would be the default decentralised communication platform. One thing is sure: if Google had not joined, XMPP would not be worse than it is today.
It was not the first: the Microsoft Playbook
What Google did to XMPP was not new. In fact, in 1998, Microsoft engineer Vinod Vallopllil explicitly wrote a text titled "Blunting OSS attacks" where he suggested to "de-commoditize protocols & applications […]. By extending these protocols and developing new protocols, we can deny OSS project’s entry into the market."
Microsoft put that theory in practice with the release of Windows 2000 which offered support for the Kerberos security protocol. But that protocol was extended. The specifications of those extensions could be freely downloaded but required to accept a license which forbid you to implement those extensions. As soon as you clicked "OK", you could not work on any open source version of Kerberos. The goal was explicitly to kill any competing networking project such as Samba.
This anecdote was told Glyn Moody in his book "Rebel Code" and demonstrates that killing open source and decentralised projects are really conscious objectives. It never happens randomly and is never caused by bad luck.
Microsoft used a similar tactic to ensure dominance in the office market with Microsoft Office using proprietary formats (a file format could be seen as a protocol to exchange data). When alternatives (OpenOffice then LibreOffice) became good enough at opening doc/xls/ppt formats, Microsoft released a new format that they called "open and standardised". The format was, on purpose, very complicated (20.000 pages of specifications!) and, most importantly, wrong. Yes, some bugs were introduced in the specification meaning that a software implementing the full OOXML format would behave differently than Microsoft Office.
Those bugs, together with political lobbying, were one of the reasons that pushed the city of Munich to revert its Linux migration. So yes, the strategy works well. Today, docx, xlsx and pptx are still the norms because of that. Source: I was there, indirectly paid by the city of Munich to make LibreOffice OOXML’s rendering closer to Microsoft’s instead of following the specifications.
UPDATE:
Meta and the Fediverse
People who don’t know history are doomed to repeat it. Which is exactly what is happening with Meta and the Fediverse.
There are rumours that Meta would become "Fediverse compatible". You could follow people on Instagram from your Mastodon account.
I don’t know if those rumours have a grain of truth, if it is even possible for Meta to consider it. But there’s one thing my own experience with XMPP and OOXML taught me: if Meta joins the Fediverse, Meta will be the only one winning. In fact, reactions show that they are already winning: the Fediverse is split between blocking Meta or not. If that happens, this would mean a fragmented, frustrating two-tier fediverse with little appeal for newcomers.
UPDATE: Those rumours have been confirmed as at least one Mastodon admin, kev, from fosstodon.org, has been contacted to take part in an off-the-record meeting with Meta. He had the best possible reaction: he refused politely and, most importantly, published the email to be transparent with its users. Thanks kev!
I know we all dream of having all our friends and family on the Fediverse so we can avoid proprietary networks completely. But the Fediverse is not looking for market dominance or profit. The Fediverse is not looking for growth. It is offering a place for freedom. People joining the Fediverse are those looking for freedom. If people are not ready or are not looking for freedom, that’s fine. They have the right to stay on proprietary platforms. We should not force them into the Fediverse. We should not try to include as many people as we can at all cost. We should be honest and ensure people join the Fediverse because they share some of the values behind it.
By competing against Meta in the brainless growth-at-all-cost ideology, we are certain to lose. They are the master of that game. They are trying to bring everyone in their field, to make people compete against them using the weapons they are selling.
Fediverse can only win by keeping its ground, by speaking about freedom, morals, ethics, values. By starting open, non-commercial and non-spied discussions. By acknowledging that the goal is not to win. Not to embrace. The goal is to stay a tool. A tool dedicated to offer a place of freedom for connected human beings. Something that no commercial entity will ever offer.
- Picture by David Revoy
- Traduction en Français par Nicolas Vivant
- Traducción Española de Matii
- Deutsche Übersetzung von Janet und anderen
- Traduzione italiana di Nilocram
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
L’actualité nous semble parfois effroyable, innommable, inhumaine. L’horreur est-elle absolue ou n’est-elle qu’une question de point de vue ?
Dans le bunker étanche, les deux scientifiques contemplaient les écrans de contrôle, les yeux hagards. De longues trainées de sueurs dégoulinaient sur leur visage.
— C’est raté, dit la première.
— Ça ne peut pas ! Ce n’est pas possible ! Ce voyage dans le temps est la dernière chance de sauver l’humanité !
— Je te dis que c’est raté. Regarde les caméras de surveillance. Les robots tueurs se rapprochent. La planète continue à brûler. Rien n’a changé. Nous sommes les dernières survivantes.
La seconde secouait machinalement la tête, tapotait sur des voyants.
— Ce n’est pas possible. Ça ne pouvait pas manquer. La mission était pourtant simple. Le professeur tout bébé dans un landau dans une plaine de jeux. Nous avions même la localisation exacte et la date.
— Il y’avait plusieurs landaus.
— Les ordres étaient clairs. Les tuer tous. Le sort de la planète dépendait du fait que le Professeur ne puisse pas grandir et créer son armée de destruction. C’était immanquable.
Derrière les humaines, la porte s’ouvrit et les robots firent leur apparition, leur silhouette se détachant sur le paysage apocalyptique de la planète en train de se consumer.
— « Se rendre le 8 juin 2023 au Pâquier d’Annecy et détruire les organismes dans les landaus de la pleine de jeu. » C’était pourtant pas compliqué. Comment cela a-t-il pu foirer ?
— Malgré le conditionnement mental, il n’a pas pu, répliqua la première. Il a hésité une fraction de seconde.
— Tout ça à cause d’un type avec un sac à dos.
— À quoi tient le destin d’une planè…
Elles n’achevèrent pas et s’écroulèrent, mortes, au pied des terrifiants automates floqués du célèbre logo de l’entreprise d’intelligence artificielle fondée en 2052 par celui qui s’était fait appeler « le Professeur ».
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain. Abonnez-vous à mes écrits en français par mail ou par rss. Pour mes écrits en anglais, abonnez-vous à la newsletter anglophone ou au flux RSS complet. Votre adresse n’est jamais partagée et effacée au désabonnement.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
L’actualité nous semble parfois effroyable, innommable, inhumaine. L’horreur est-elle absolue ou n’est-elle qu’une question de point de vue ?
Dans le bunker étanche, les deux scientifiques contemplaient les écrans de contrôle, les yeux hagards. De longues trainées de sueurs dégoulinaient sur leur visage.
— C’est raté, dit la première.
— Ça ne peut pas ! Ce n’est pas possible ! Ce voyage dans le temps est la dernière chance de sauver l’humanité !
— Je te dis que c’est raté. Regarde les caméras de surveillance. Les robots tueurs se rapprochent. La planète continue à brûler. Rien n’a changé. Nous sommes les dernières survivantes.
La seconde secouait machinalement la tête, tapotait sur des voyants.
— Ce n’est pas possible. Ça ne pouvait pas manquer. La mission était pourtant simple. Le professeur tout bébé dans un landau dans une plaine de jeux. Nous avions même la localisation exacte et la date.
— Il y’avait plusieurs landaus.
— Les ordres étaient clairs. Les tuer tous. Le sort de la planète dépendait du fait que le Professeur ne puisse pas grandir et créer son armée de destruction. C’était immanquable.
Derrière les humaines, la porte s’ouvrit et les robots firent leur apparition, leur silhouette se détachant sur le paysage apocalyptique de la planète en train de se consumer.
— « Se rendre le 8 juin 2023 au Pâquier d’Annecy et détruire les organismes dans les landaus de la pleine de jeu. » C’était pourtant pas compliqué. Comment cela a-t-il pu foirer ?
— Malgré le conditionnement mental, il n’a pas pu, répliqua la première. Il a hésité une fraction de seconde.
— Tout ça à cause d’un type avec un sac à dos.
— À quoi tient le destin d’une planè…
Elles n’achevèrent pas et s’écroulèrent, mortes, au pied des terrifiants automates floqués du célèbre logo de l’entreprise d’intelligence artificielle fondée en 2052 par celui qui s’était fait appeler « le Professeur ».
Ingénieur et écrivain, j’explore l’impact des technologies sur l’humain. Abonnez-vous à mes écrits en français par mail ou par rss. Pour mes écrits en anglais, abonnez-vous à la newsletter anglophone ou au flux RSS complet. Votre adresse n’est jamais partagée et effacée au désabonnement.
Pour me soutenir, achetez mes livres (si possible chez votre libraire) ! Je viens justement de publier un recueil de nouvelles qui devrait vous faire rire et réfléchir.
Disclaimer: I’m aware that Richard Stallman had some questionable or inadequate behaviours. I’m not defending those nor the man himself. I’m not defending blindly following that particular human (nor any particular human). I’m defending a philosophy, not the philosopher. I claim that his historical vision and his original ideas are still adequate today. Maybe more than ever.
The Free Software movement has been mostly killed by the corporate Open Source. The Free Software Foundation (FSF) and its founder, Richard Stallman (RMS), have been decried for the last twenty years, including by my 25-year-old self, as being outdated and inadequate.
- Drew DeVault’s FSF is dying
- Free Software is not enough by j3s
- Viznut asking if permacomputing should be the successor of Free Software
- Myself arguing for RMS replacement in 2006
I’ve spent the last 6 years teaching Free Software and Open Source at École Polytechnique de Louvain, being forced to investigate the subject and the history more than I anticipated in order to answer students’ questions. I’ve read many historical books on the subject, including RMS’s biography and many older writings.
And something struck me.
RMS was right since the very beginning. Every warning, every prophecy realised. And, worst of all, he had the solution since the start. The problem is not RMS or FSF. The problem is us. The problem is that we didn’t listen.
The solution has always been there: copyleft
In the early eighties, RMS realised that software was transformed from "a way to use a machine" to a product or a commodity. He foresaw that this would put an end to collective intelligence and to knowledge sharing. He also foresaw that if we were not the master of our software, we would quickly become the slave of the machines controlled by soulless corporations. He told us that story again and again.
Forty years later, we must admit he was prescient. Every word he said still rings true. Very few celebrated forward thinkers were as right as RMS. Yet, we don’t like his message. We don’t like how he tells it. We don’t like him. As politicians understood quickly, we care more about appearance and feel-good communication than about the truth or addressing the root cause.
RMS theorised the need for the "four freedoms of software".
- The right to use the software at your discretion
- The right to study the software
- The right to modify the software
- The right to share the software, including the modified version
How to guarantee those freedoms ? RMS invented copyleft. A solution he implemented in the GPL license. The idea of copyleft is that you cannot restrain the rights of the users. Copyleft is the equivalent of the famous « Il est interdit d’interdire » (it is forbidden to forbid).
In hindsight, the solution was and still is right.
Copyleft is a very deep concept. It is about creating and maintaining commons. Commons resources that everybody could access freely, resources that would be maintained by the community at large. Commons are frightening to capitalist businesses as, by essence, capitalist businesses try to privatise everything, to transform everything into a commodity. Commons are a non-commodity, a non-product.
Capitalist businesses were, obviously, against copyleft. And still are. Steve Ballmer famously called the GPL a "cancer". RMS was and still is pictured as a dangerous maniac, a fanatic propagating the cancer.
Bruce Perens and Eric Raymond tried to find a middle ground and launched the "Open Source" movement. Retrospectively, Open Source was a hack. It was originally seen as a simple rebranding of "Free Software", arguing that "free" could be understood as "without price or value" in English.
RMS quickly pointed, rightly, that the lack of "freedom" means that people will forget about the concept. Again, he was right. But everybody considered that "Free Software" and "Open Source" were the same because they both focused on the four freedoms. That RMS was nitpicking.
RMS biggest mistake
There was one weakness in RMS theory: copyleft was not part of the four freedoms he theorised. Business-compatible licenses like BSD/MIT or even public domain are "Free Software" because they respect the four freedoms.
But they can be privatised.
And that’s the whole point. For the last 30 years, businesses and proponents of Open Source, including Linus Torvalds, have been decrying the GPL because of the essential right of "doing business" aka "privatising the common".
They succeeded so much that the essential mission of the FSF to guarantee the common was seen as "useless" or, worse, "reactionary". What was the work of the FSF? The most important thing is that they proof-bombed the GPL against weaknesses found later. They literally patched vulnerabilities. First the GPLv3, to fight "Tivoisation" and then AGPL, to counteract proprietary online services running on free software but taking away freedom of users.
But all this work was ridiculed. Microsoft, through Github, Google and Apple pushed for MIT/BSD licensed software as the open source standard. This allowed them to use open source components within their proprietary closed products. They managed to make thousands of free software developers work freely for them. And they even received praise because, sometimes, they would hire one of those developers (like it was a "favour" to the community while it is simply business-wise to hire smart people working on critical components of your infrastructure instead of letting them work for free). The whole Google Summer of Code, for which I was a mentor multiple years, is just a cheap way to get unpaid volunteers mentor their future free or cheap workforce.
Our freedoms were taken away by proprietary software which is mostly coded by ourselves. For free. We spent our free time developing, debugging, testing software before handing them to corporations that we rever, hoping to maybe get a job offer or a small sponsorship from them. Without Non-copyleft Open Source, there would be no proprietary MacOS, OSX nor Android. There would be no Facebook, no Amazon. We created all the components of Frankenstein’s creature and handed them to the evil professor.
More commons
The sad state of computing today makes computer people angry. We see that young student are taught "computer" with Word and PowerPoint, that young hackers are mostly happy with rooting Android phones or blindly using the API of a trendy JS framework. That Linux distributions are only used by computer science students in virtualised containers. We live in the dystopia future RMS warned us about.
Which, paradoxically, means that RMS failed. He was a Cassandra. Intuitively, we think we should change him, we should replace the FSF, we should have new paradigms which are taking into account ecology and other ethical stances.
We don’t realise that the solution is there, in front of us for 40 years: copyleft.
Copyleft as in "Forbidding privatising the commons".
We need to rebuild the commons. When industries are polluting the atmosphere or the oceans, they are, in fact, privatising the commons ("considering a common good as their private trash"). When an industry receives millions in public subsidies then make a patent, that industry is privatising the common. When Google is putting the Linux kernel in a phone that cannot be modified easily, Google is privatising the common. Why do we need expensive electric cars? Because the automotive industry has been on a century-long mission to kill public transport or the sole idea of going on foot, to destroy the commons.
We need to defend our commons. Like RMS did 40 years ago. We don’t want to get rid of RMS, we need more of his core philosophy. We were brainwashed into thinking that he was an extremist just like we are brainwashed to think that taking care of the poor is socialist extremism. In lots of occidental countries, political positions seen as "centre" twenty years ago are now seen as "extreme left" because the left of twenty years ago was called extremist. RMS suffered the same fate and we should not fall for it.
Fighting back
What could I do? Well, the first little step I can do myself is to release every future software I develop under the AGPL license. To put my blog under a CC By-SA license. I encourage you to copyleft all the things!
We need a fifth rule. An obligation to maintain the common to prevent the software of being privatised. This is the fifth line that RMS grasped intuitively but, unfortunately for us, he forgot to put in his four freedoms theory. The world would probably be a very different place if he had written the five rules of software forty years ago.
But if the best time to do it was forty years ago, the second-best moment is right now. So here are
The four freedoms and one obligation of free software
- The right to use the software at your own discretion
- The right to study the software
- The right to modify the software
- The right to redistribute the software, including with modifications
- The obligation to keep those four rights, effectively keeping the software in the commons.
We need to realise that any software without that last obligation will, sooner or later, become an oppression tool against ourselves. And that maintaining the commons is not only about software. It’s about everything we are as a society and everything we are losing against individual greed. Ultimately, our planet is our only common resource. We should defend it from becoming a commodity.
Copyleft was considered a cancer. But a cancer to what? To the capitalist consumerism killing the planet? Then I will proudly side with the cancer.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.
Disclaimer: I’m aware that Richard Stallman had some questionable or inadequate behaviours. I’m not defending those nor the man himself. I’m not defending blindly following that particular human (nor any particular human). I’m defending a philosophy, not the philosopher. I claim that his historical vision and his original ideas are still adequate today. Maybe more than ever.
The Free Software movement has been mostly killed by the corporate Open Source. The Free Software Foundation (FSF) and its founder, Richard Stallman (RMS), have been decried for the last twenty years, including by my 25-year-old self, as being outdated and inadequate.
- Drew DeVault’s FSF is dying
- Free Software is not enough by j3s
- Viznut asking if permacomputing should be the successor of Free Software
- Myself arguing for RMS replacement in 2006
I’ve spent the last 6 years teaching Free Software and Open Source at École Polytechnique de Louvain, being forced to investigate the subject and the history more than I anticipated in order to answer students’ questions. I’ve read many historical books on the subject, including RMS’s biography and many older writings.
And something struck me.
RMS was right since the very beginning. Every warning, every prophecy realised. And, worst of all, he had the solution since the start. The problem is not RMS or FSF. The problem is us. The problem is that we didn’t listen.
The solution has always been there: copyleft
In the early eighties, RMS realised that software was transformed from "a way to use a machine" to a product or a commodity. He foresaw that this would put an end to collective intelligence and to knowledge sharing. He also foresaw that if we were not the master of our software, we would quickly become the slave of the machines controlled by soulless corporations. He told us that story again and again.
Forty years later, we must admit he was prescient. Every word he said still rings true. Very few celebrated forward thinkers were as right as RMS. Yet, we don’t like his message. We don’t like how he tells it. We don’t like him. As politicians understood quickly, we care more about appearance and feel-good communication than about the truth or addressing the root cause.
RMS theorised the need for the "four freedoms of software".
- The right to use the software at your discretion
- The right to study the software
- The right to modify the software
- The right to share the software, including the modified version
How to guarantee those freedoms ? RMS invented copyleft. A solution he implemented in the GPL license. The idea of copyleft is that you cannot restrain the rights of the users. Copyleft is the equivalent of the famous « Il est interdit d’interdire » (it is forbidden to forbid).
In hindsight, the solution was and still is right.
Copyleft is a very deep concept. It is about creating and maintaining commons. Commons resources that everybody could access freely, resources that would be maintained by the community at large. Commons are frightening to capitalist businesses as, by essence, capitalist businesses try to privatise everything, to transform everything into a commodity. Commons are a non-commodity, a non-product.
Capitalist businesses were, obviously, against copyleft. And still are. Steve Ballmer famously called the GPL a "cancer". RMS was and still is pictured as a dangerous maniac, a fanatic propagating the cancer.
Bruce Perens and Eric Raymond tried to find a middle ground and launched the "Open Source" movement. Retrospectively, Open Source was a hack. It was originally seen as a simple rebranding of "Free Software", arguing that "free" could be understood as "without price or value" in English.
RMS quickly pointed, rightly, that the lack of "freedom" means that people will forget about the concept. Again, he was right. But everybody considered that "Free Software" and "Open Source" were the same because they both focused on the four freedoms. That RMS was nitpicking.
RMS biggest mistake
There was one weakness in RMS theory: copyleft was not part of the four freedoms he theorised. Business-compatible licenses like BSD/MIT or even public domain are "Free Software" because they respect the four freedoms.
But they can be privatised.
And that’s the whole point. For the last 30 years, businesses and proponents of Open Source, including Linus Torvalds, have been decrying the GPL because of the essential right of "doing business" aka "privatising the common".
They succeeded so much that the essential mission of the FSF to guarantee the common was seen as "useless" or, worse, "reactionary". What was the work of the FSF? The most important thing is that they proof-bombed the GPL against weaknesses found later. They literally patched vulnerabilities. First the GPLv3, to fight "Tivoisation" and then AGPL, to counteract proprietary online services running on free software but taking away freedom of users.
But all this work was ridiculed. Microsoft, through Github, Google and Apple pushed for MIT/BSD licensed software as the open source standard. This allowed them to use open source components within their proprietary closed products. They managed to make thousands of free software developers work freely for them. And they even received praise because, sometimes, they would hire one of those developers (like it was a "favour" to the community while it is simply business-wise to hire smart people working on critical components of your infrastructure instead of letting them work for free). The whole Google Summer of Code, for which I was a mentor multiple years, is just a cheap way to get unpaid volunteers mentor their future free or cheap workforce.
Our freedoms were taken away by proprietary software which is mostly coded by ourselves. For free. We spent our free time developing, debugging, testing software before handing them to corporations that we rever, hoping to maybe get a job offer or a small sponsorship from them. Without Non-copyleft Open Source, there would be no proprietary MacOS, OSX nor Android. There would be no Facebook, no Amazon. We created all the components of Frankenstein’s creature and handed them to the evil professor.
More commons
The sad state of computing today makes computer people angry. We see that young student are taught "computer" with Word and PowerPoint, that young hackers are mostly happy with rooting Android phones or blindly using the API of a trendy JS framework. That Linux distributions are only used by computer science students in virtualised containers. We live in the dystopia future RMS warned us about.
Which, paradoxically, means that RMS failed. He was a Cassandra. Intuitively, we think we should change him, we should replace the FSF, we should have new paradigms which are taking into account ecology and other ethical stances.
We don’t realise that the solution is there, in front of us for 40 years: copyleft.
Copyleft as in "Forbidding privatising the commons".
We need to rebuild the commons. When industries are polluting the atmosphere or the oceans, they are, in fact, privatising the commons ("considering a common good as their private trash"). When an industry receives millions in public subsidies then make a patent, that industry is privatising the common. When Google is putting the Linux kernel in a phone that cannot be modified easily, Google is privatising the common. Why do we need expensive electric cars? Because the automotive industry has been on a century-long mission to kill public transport or the sole idea of going on foot, to destroy the commons.
We need to defend our commons. Like RMS did 40 years ago. We don’t want to get rid of RMS, we need more of his core philosophy. We were brainwashed into thinking that he was an extremist just like we are brainwashed to think that taking care of the poor is socialist extremism. In lots of occidental countries, political positions seen as "centre" twenty years ago are now seen as "extreme left" because the left of twenty years ago was called extremist. RMS suffered the same fate and we should not fall for it.
Fighting back
What could I do? Well, the first little step I can do myself is to release every future software I develop under the AGPL license. To put my blog under a CC By-SA license. I encourage you to copyleft all the things!
We need a fifth rule. An obligation to maintain the common to prevent the software of being privatised. This is the fifth line that RMS grasped intuitively but, unfortunately for us, he forgot to put in his four freedoms theory. The world would probably be a very different place if he had written the five rules of software forty years ago.
But if the best time to do it was forty years ago, the second-best moment is right now. So here are
The four freedoms and one obligation of free software
- The right to use the software at your own discretion
- The right to study the software
- The right to modify the software
- The right to redistribute the software, including with modifications
- The obligation to keep those four rights, effectively keeping the software in the commons.
We need to realise that any software without that last obligation will, sooner or later, become an oppression tool against ourselves. And that maintaining the commons is not only about software. It’s about everything we are as a society and everything we are losing against individual greed. Ultimately, our planet is our only common resource. We should defend it from becoming a commodity.
Copyleft was considered a cancer. But a cancer to what? To the capitalist consumerism killing the planet? Then I will proudly side with the cancer.
As a writer and an engineer, I like to explore how technology impacts society. You can subscribe by email or by rss. I value privacy and never share your adress.
If you read French, you can support me by buying/sharing/reading my books and subscribing to my newsletter in French or RSS. I also develop Free Software.