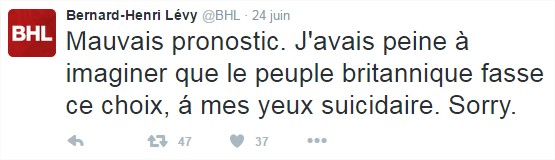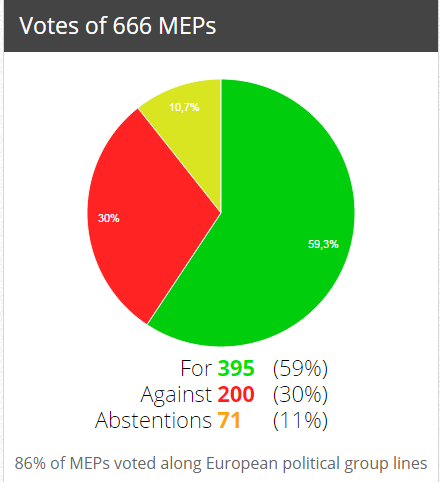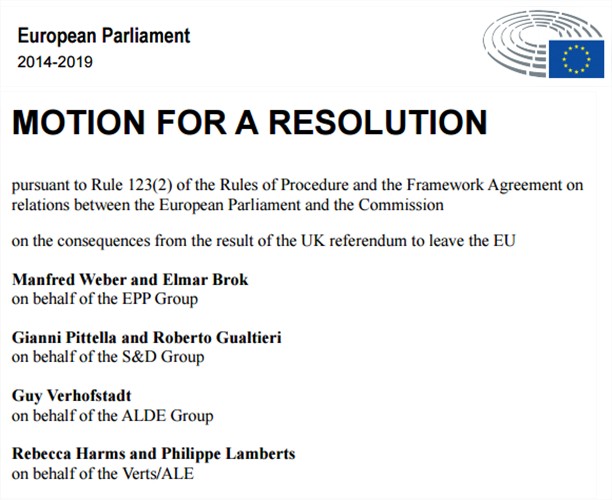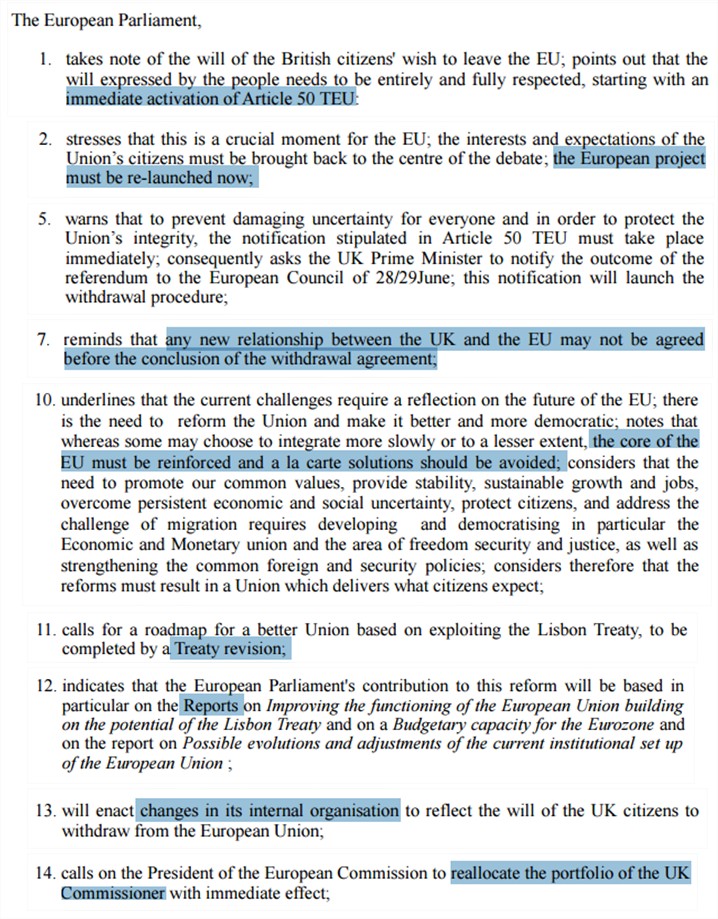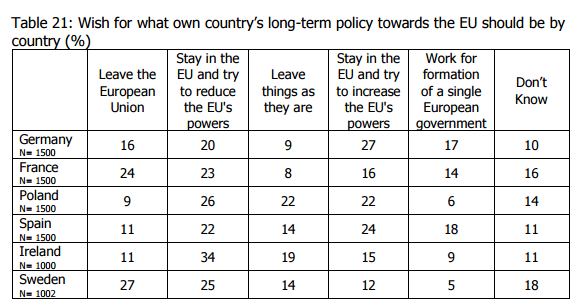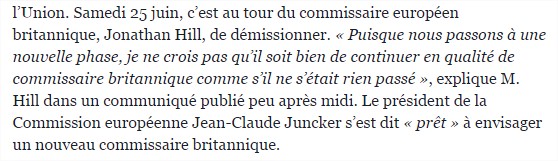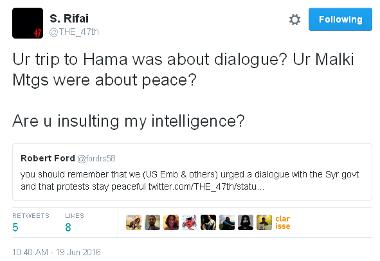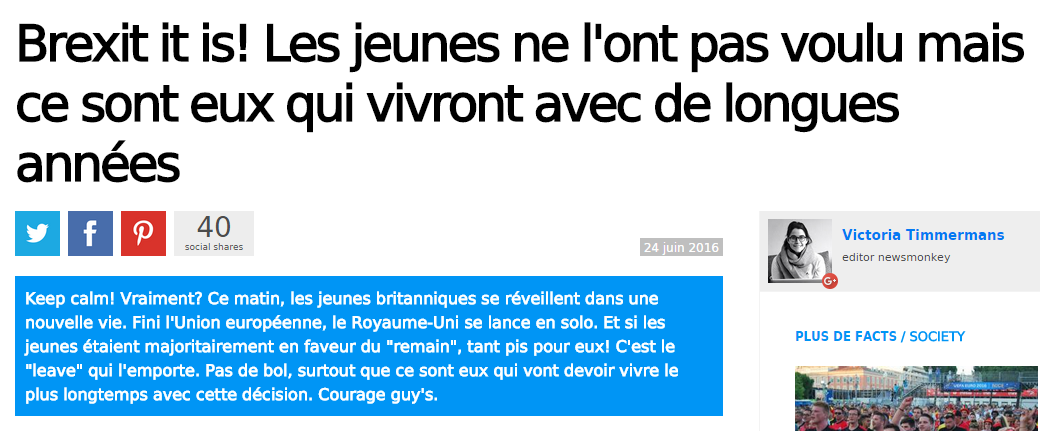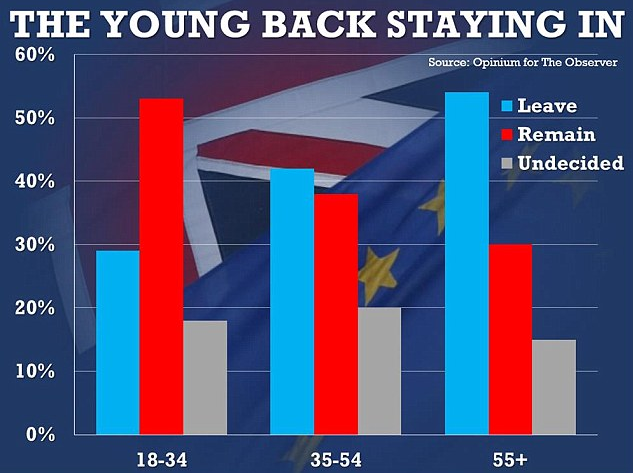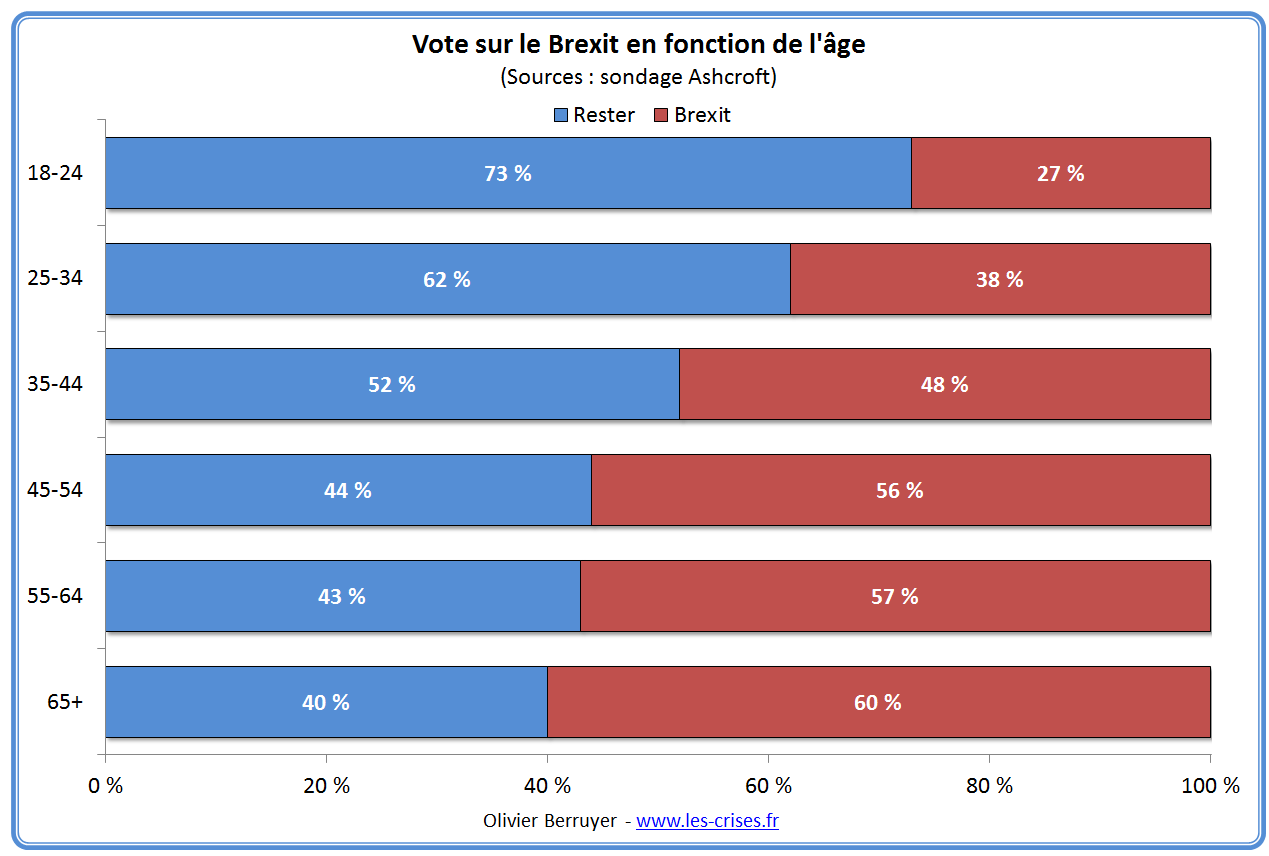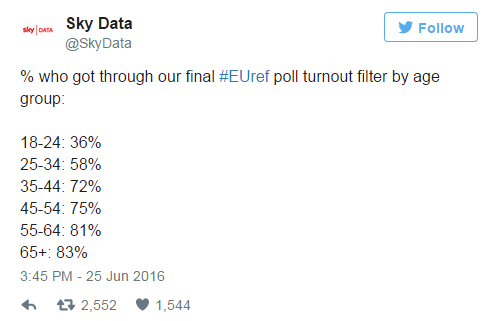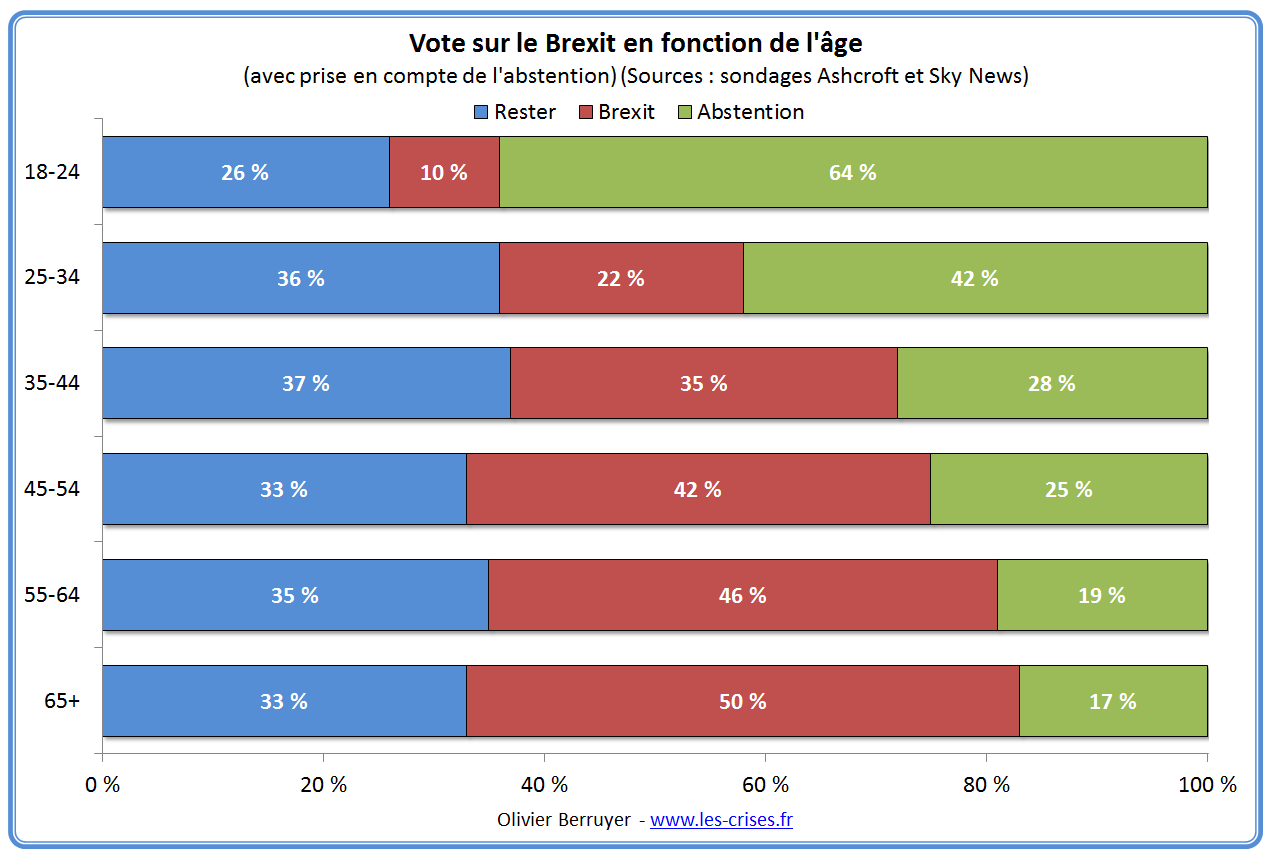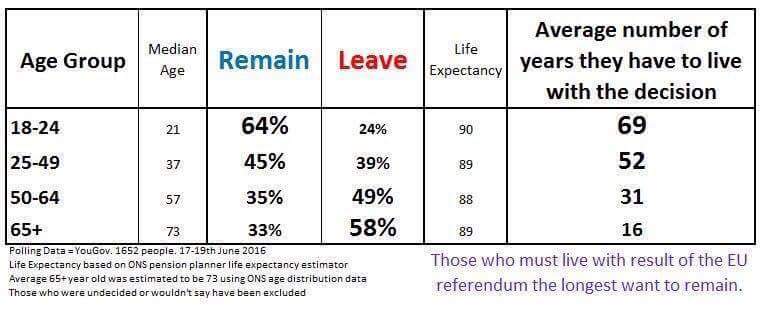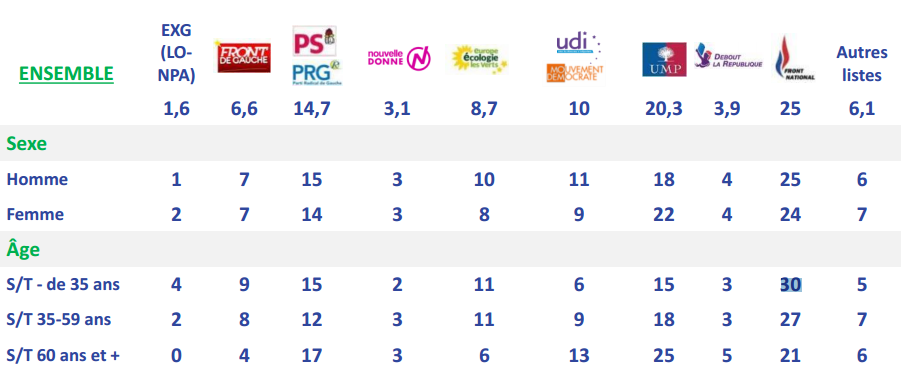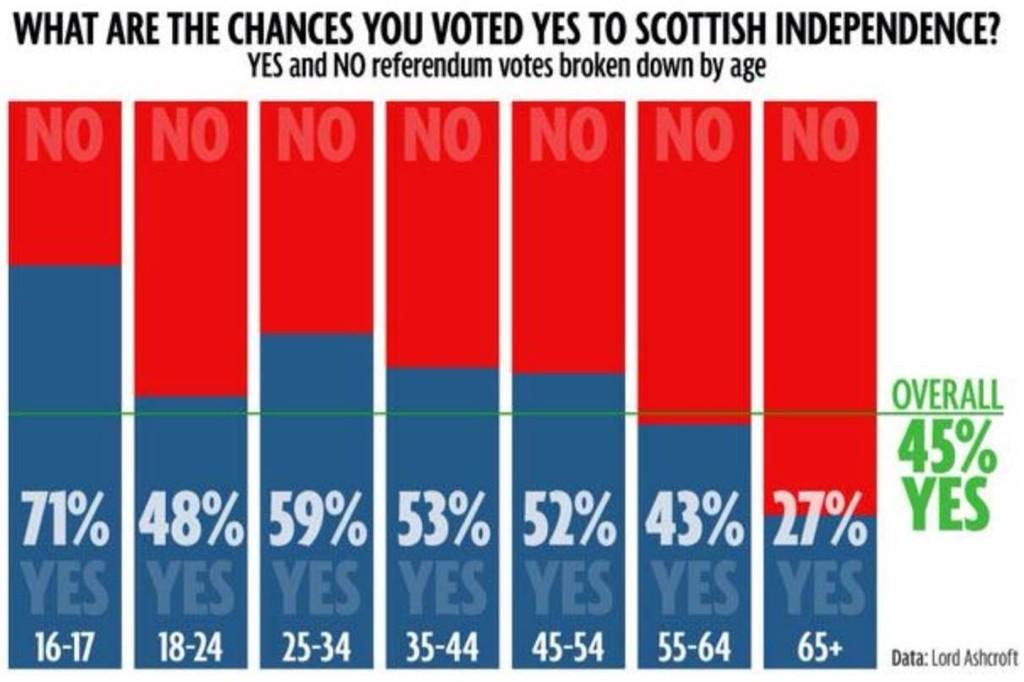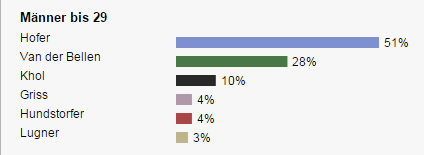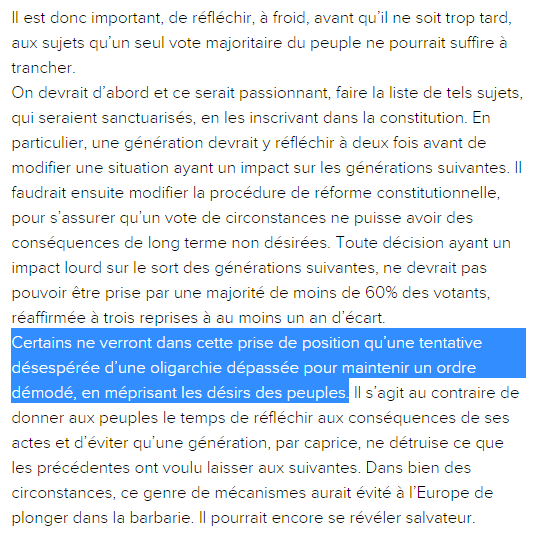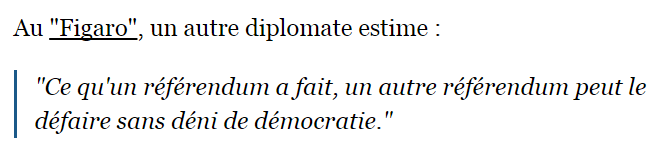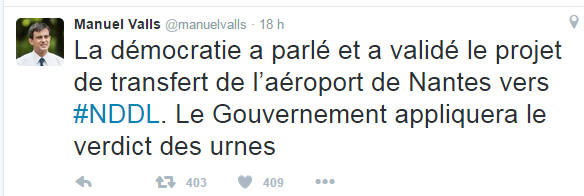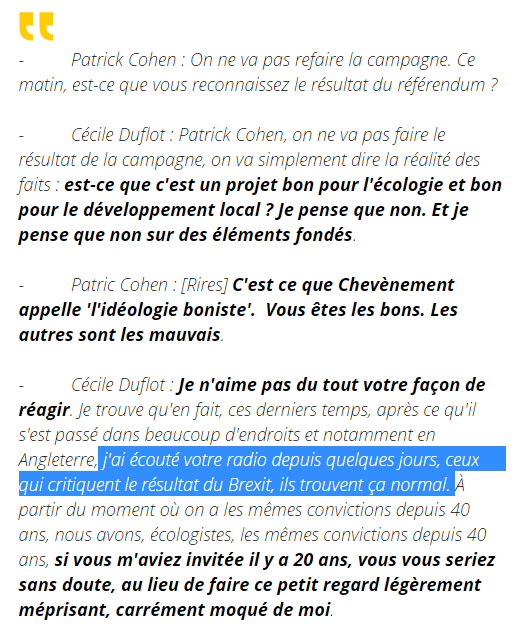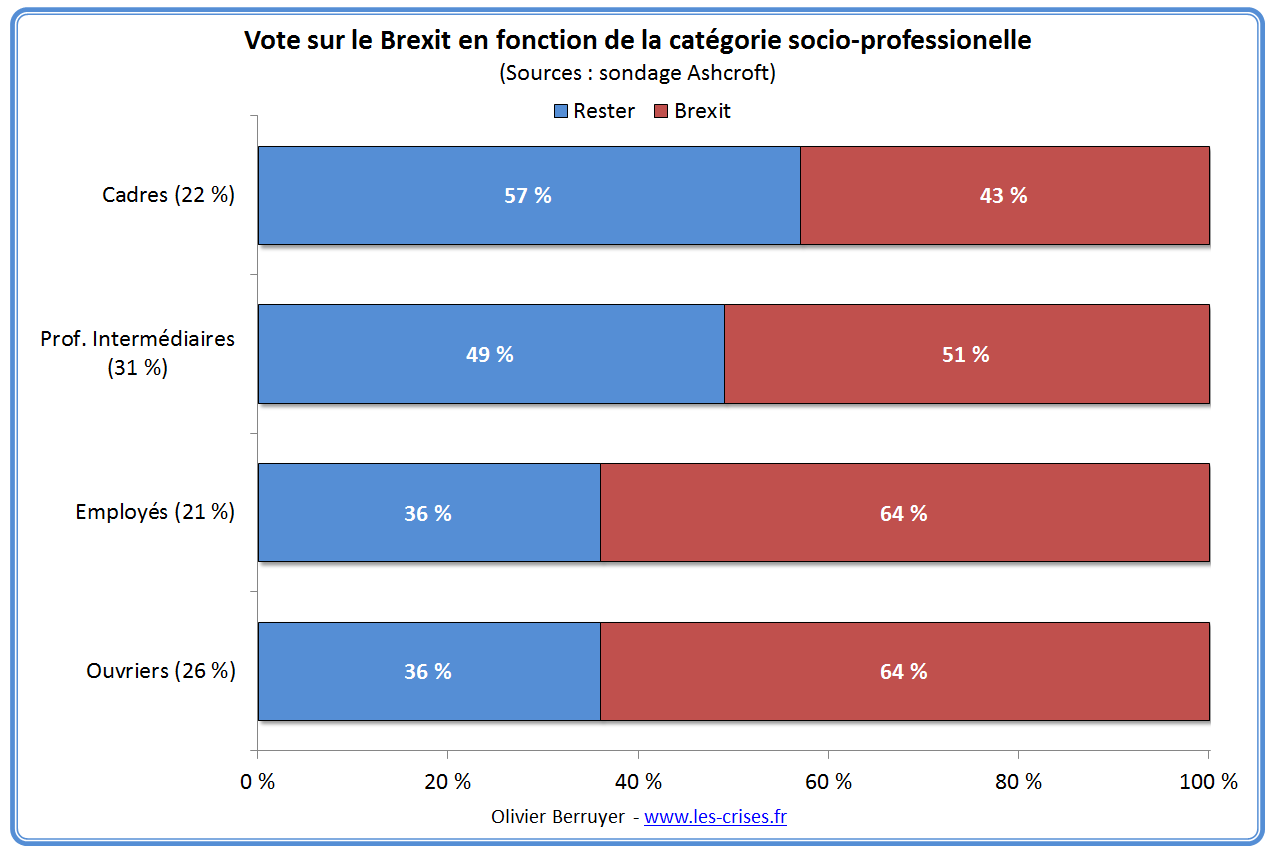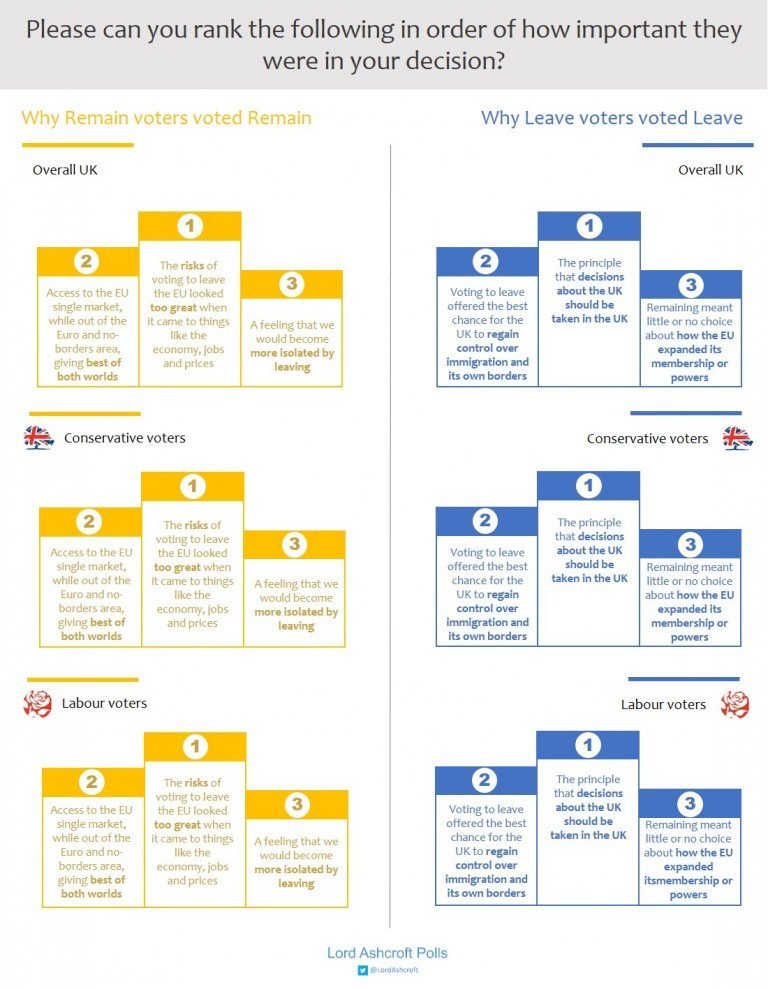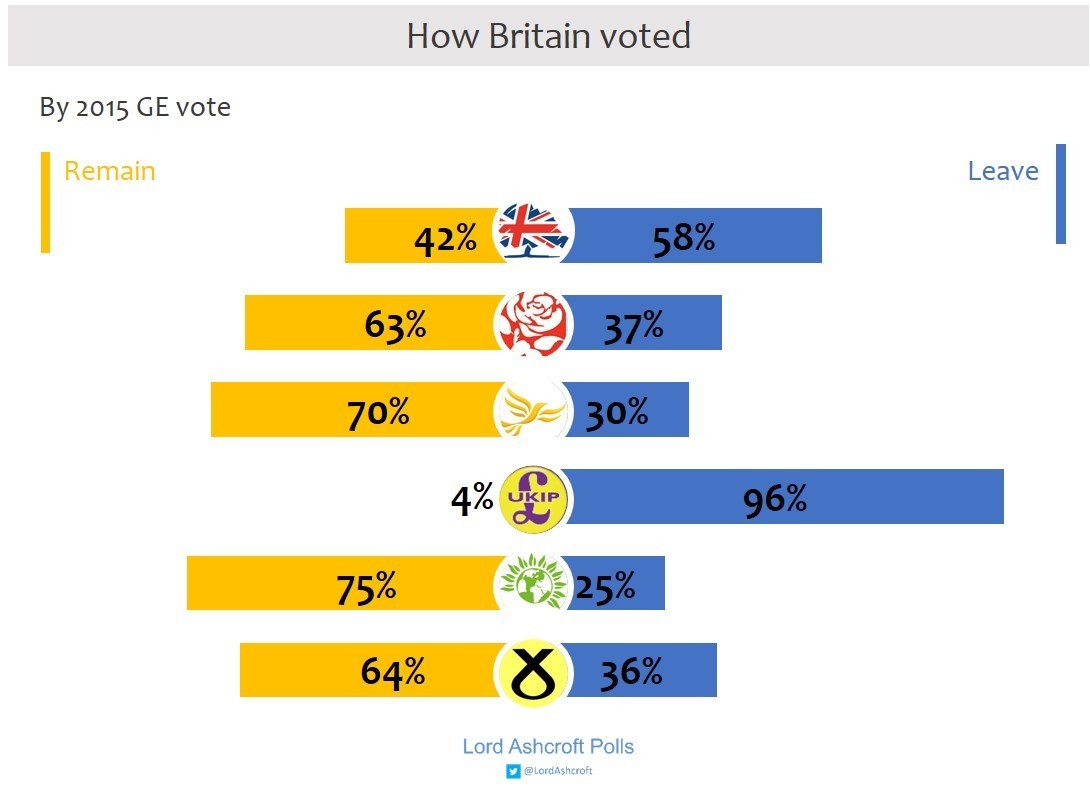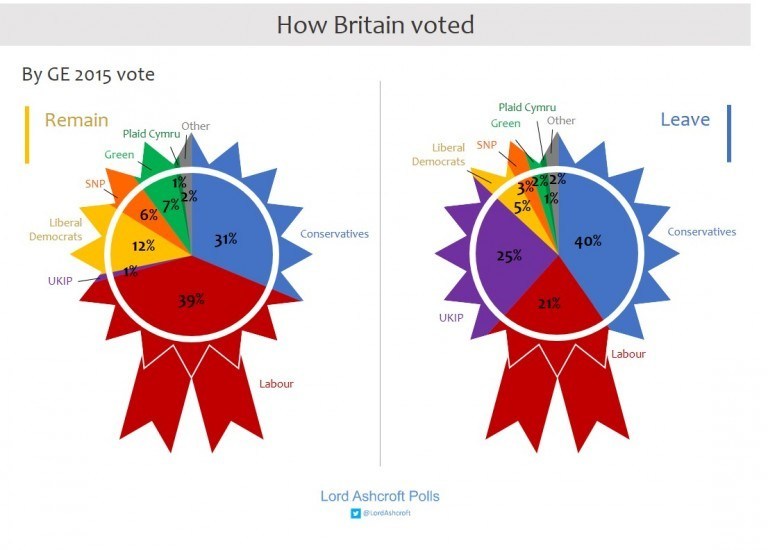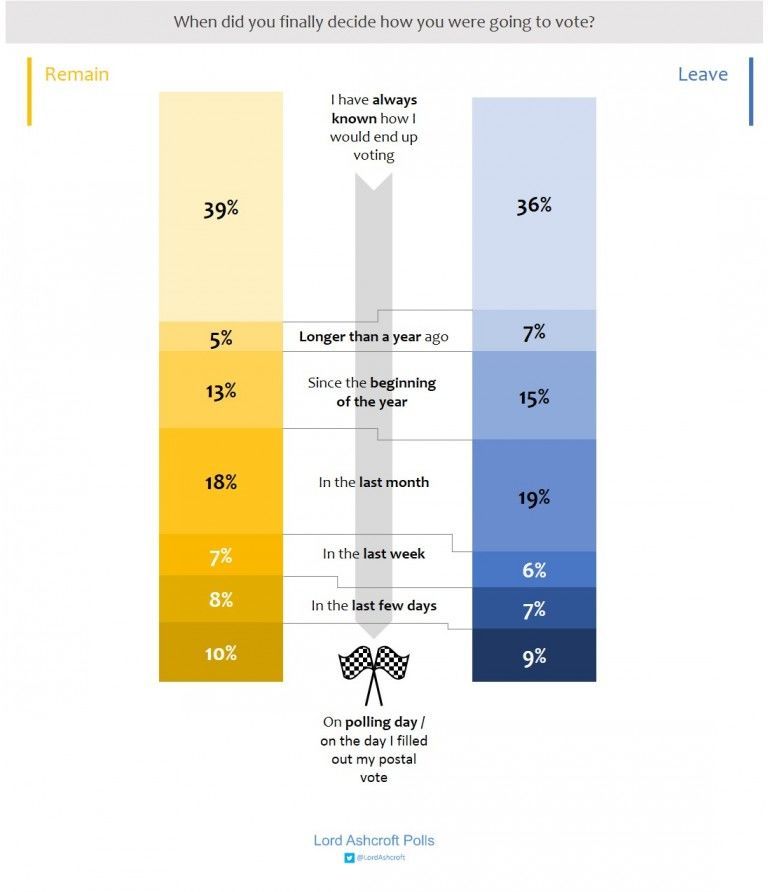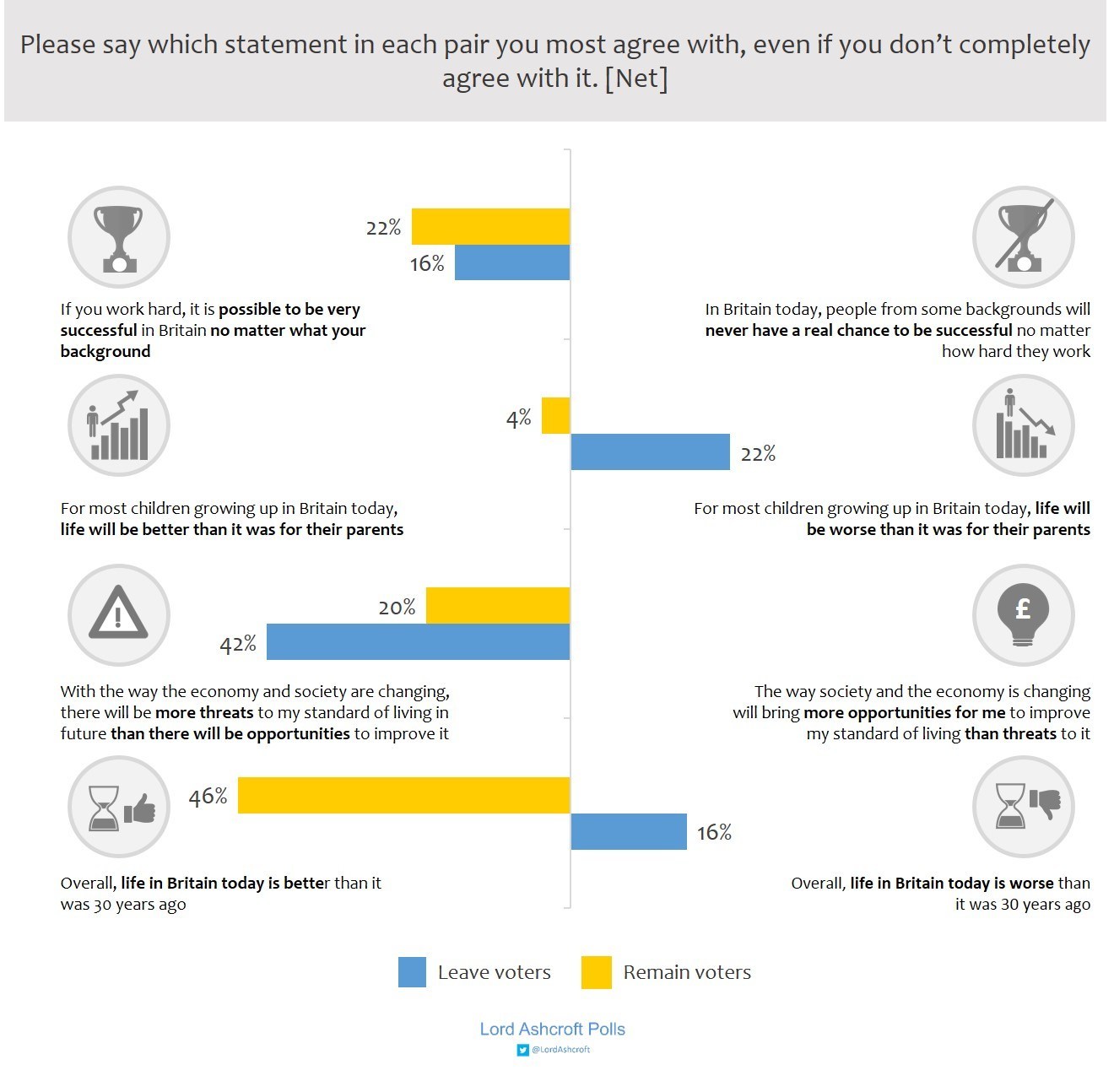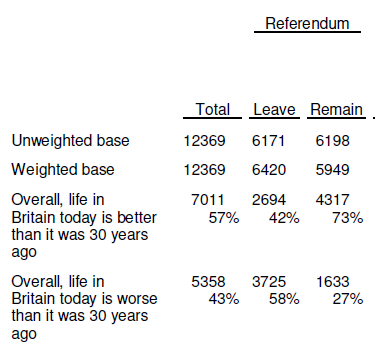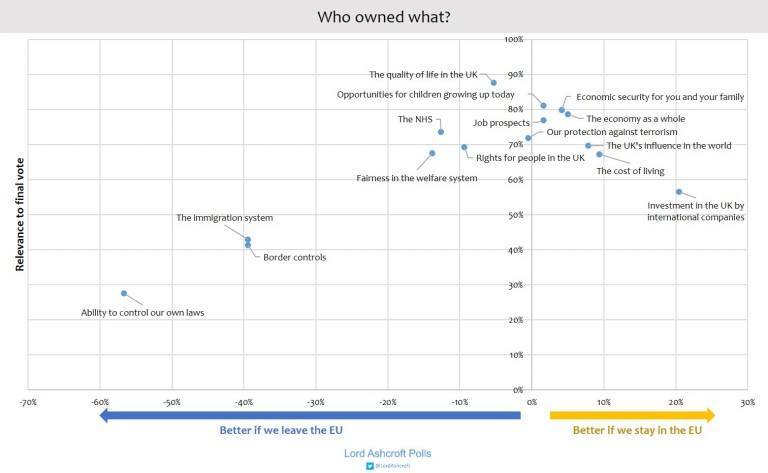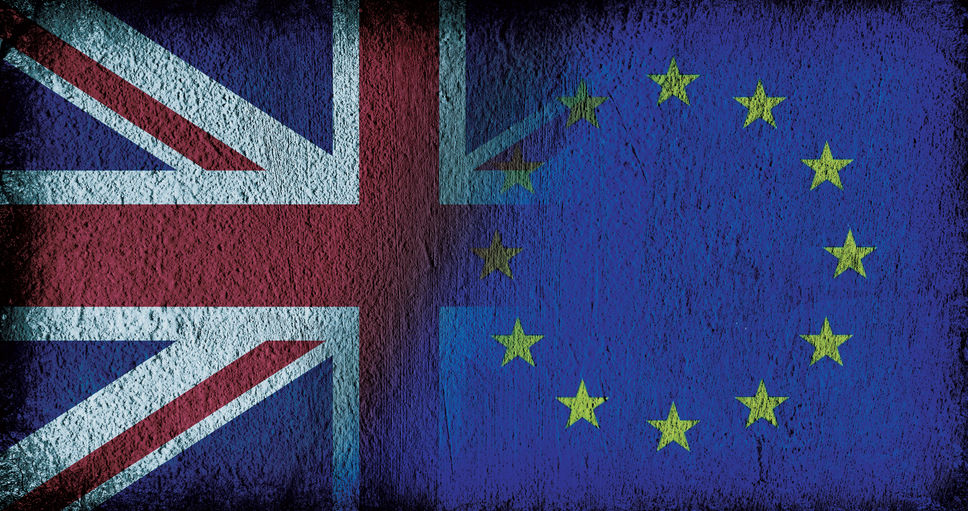Au cours des dernières décennies, le département d’Etat des Etats-Unis qui était jadis une maison raisonnablement professionnelle et réaliste en matière de diplomatie est devenu un repaire de bureaucrates guerriers possédés par des obsessions impériales, un phénomène dangereux souligné par la récente « dissidence » de masse en faveur de nouvelles tueries en Syrie.
51 « diplomates » du Département d’Etat ont signé une note de service distribuée par un « canal de la dissidence » officiel, demandant des frappes militaires contre le gouvernement syrien de Bachar al-Assad dont les forces ont mené la contre-offensive contre les extrémistes islamistes qui cherchent à contrôler cette importante nation du Moyen-Orient .
Le fait qu’un si grand nombre de fonctionnaires du Département d’Etat plaident en faveur d’un élargissement de la guerre d’agression en accord avec l’agenda néoconservateur, qui a placé la Syrie sur une liste noire il y a vingt ans, est révélateur du degré de folie qui s’est emparé du Département d’Etat.
Le Département d’Etat semble être devenu un mélange de néoconservateurs pur jus, de libéraux interventionnistes et de quelques arrivistes qui ont compris qu’il était dans leur intérêt de se comporter comme des proconsuls globaux qui imposent leurs solutions ou recherchent un « changement de régime » plutôt que de se comporter en diplomates respectueux à la recherche de véritables compromis.
Même certains fonctionnaires du Département d’Etat, que je connais personnellement et qui ne sont pas vraiment néoconservateurs ou libéraux-faucons, agissent comme s’ils avaient avalé la pilule et toute la boîte avec. Ils parlent comme des durs et se comportent avec arrogance envers les populations des pays sous leur contrôle. Les étrangers sont traités comme des objets stupides tout juste bons à être soumis ou soudoyés.
Il n’est donc pas tout à fait surprenant que plusieurs dizaines de « diplomates » étasuniens s’en prennent à la position plus modérée du président Barack Obama sur la Syrie tout en se positionnant en prévision de l’élection d’Hillary Clinton, qui devrait autoriser une invasion illégale de la Syrie – sous couvert d’établir des « zones d’exclusion aérienne » et des « zones de sécurité » – ce qui signifie en clair, tuer d’avantage de jeunes soldats syriens. Les « diplomates » demandent l’utilisation d’ « armes à longue portée et aériennes ».
Ces faucons sont si avides guerres que le risque d’un conflit direct avec la Russie ne les dérange pas. D’un léger revers de la main, ils balaient la possibilité d’un conflit avec une puissance nucléaire en affirmant qu’ils ne préconisent pas « d’emprunter une pente glissante qui se terminerait dans une confrontation militaire avec Russie. » Dis comme-ça, ça rassure.
Risquer une victoire Djihadiste
Il y a aussi le risque qu’une intervention militaire directe des Etats-Unis pourrait faire s’effondrer l’armée syrienne et ouvrir la voie à une victoire du Front Al-Nusra/Al-Qaïda ou de l’Etat Islamique. La note ne précise pas comment ils comptent réaliser la délicate opération d’infliger suffisamment de dégâts à l’armée syrienne tout en évitant une victoire pure et simple des djihadistes et une confrontation avec la Russie.
On peut supposer que, quels que soient les dégâts infligés, ce sera à l’armée US de nettoyer après, en supposant que l’abattage d’avions militaires russes et la mort de militaires russes ne dégénérera pas en une conflagration thermonucléaire à grande échelle.
En bref, il semble que le Département d’Etat est devenu un asile de fous dont les malades auraient pris le contrôle. Mais cette folie n’est pas une aberration temporaire qui pourrait être facilement corrigée. C’est quelque chose qui vient de loin et il faudrait un nettoyage de fond en comble du « corps diplomatique » actuel pour rétablir le Département d’Etat dans son rôle traditionnel qui est censé être celui d’éviter les guerres plutôt que de les provoquer.
Bien qu’il y ait toujours eu des cinglés au sein du Département d’Etat – généralement placés aux échelons les plus élevés – le phénomène d’aliénation mentale institutionnelle n’est apparue qu’au cours des dernières décennies. Et j’ai vu le changement.
J’ai couvert la politique étrangère des Etats-Unis depuis la fin des années 1970 quand il y avait nettement plus de gens sains d’esprit au sein du corps diplomatique. Il y avait des gens comme Robert White et Patricia Derian (tous deux décédés) qui défendaient la justice et les droits de l’homme, et tout ce qu’il y avait de meilleur aux Etats-Unis.
Mais la déchéance du Département d’Etat des Etats-Unis devenu un repaire de petits voyous bien habillés, beaux-parleurs et serviteurs zélés de l’hégémonie US, a commencé sous l’administration Reagan. Le Président Ronald Reagan et son équipe avaient une haine pathologique des mouvements sociaux d’Amérique centrale qui cherchaient à se libérer des oligarchies oppressives et leurs forces de sécurité brutales.
Pendant les années 1980, les diplomates US dotés d’intégrité ont été systématiquement marginalisés, harcelés ou écartés. (Derian, qui était Coordinatrice des Droits Humains, a quitté ses fonctions à la fin de l’administration Carter et a été remplacée par le néoconservateur Elliott Abrams. Blanc fut congédié comme ambassadeur US en El Salvador, en expliquant : « Le Secrétaire d’Etat, Alexander M. Haig Jr. , m’a demandé de recourir aux canaux officiels pour couvrir la responsabilité de l’armée salvadorienne pour les meurtres de quatre sœurs religieuses américaines. J’ai refusé » )
La montée des néoconservateurs
Au fur et à mesure des départs des professionnels de la vieille garde, une nouvelle génération de néo-conservateurs agressifs prenaient leur place, des gens tels que Paul Wolfowitz, Robert McFarlane, Robert Kagan et Abrams. Après huit années de Reagan et quatre années de George H.W. Bush, le Département d’Etat avait été remodelé en un foyers de néo-conservateurs, mais quelques poches de professionnalisme avaient résisté aux assauts.
Alors que l’on aurait pu s’attendre à ce que l’administration Démocrate de Clinton inverse la tendance, ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, la « triangulation » de Bill Clinton fut appliquée aussi bien en politique extérieure qu’en politique intérieure. Il était toujours à la recherche de ce « juste milieu » confortable.
Vers fin des années 90, la décimation des experts en politique étrangère de la trempe de White et Derian n’a laissé que quelques survivants du côté Démocrate avec le courage ou les compétences pour défier les néoconservateurs profondément enracinées. De nombreux démocrates de l’ère Clinton se sont acclimatés à la domination des néo-conservateurs en se réinventant comme « progressistes interventionnistes », en partageant l’amour des néoconservateurs pour la force militaire mais justifiant les tueries par des raisons « humanitaires ».
Cette approche était une façon pour les « progressistes » de se protéger des accusations de « faiblesse » lancées par la droite, une accusation qui avait profondément marqué les Démocrates pendant les années Reagan / Bush. Mais cette posture de « Démocratique dur » n’a fait qu’isoler un peu plus les diplomates sérieux favorables à une politique de donnant/donnant avec les dirigeants étrangers et leurs peuples.
Il y avait donc des Démocrates comme l’Ambassadrice auprès des Nations Unies (et plus tard secrétaire d’Etat) Madeleine Albright qui justifiait les sanctions brutales de Bill Clinton envers l’Irak, sanctions qui selon l’ONU ont provoqué la mort de 500.000 enfants irakiens, comme « un choix très difficile, mais le prix – nous pensons que cela en valait le prix ».
Les huit années de la politique du « juste milieu » de Bill Clinton, qui comprenait la guerre aérienne brutale contre la Serbie, ont été suivies par huit années de George W. Bush, qui a renforcé encore plus l’influence des conservateurs sur la politique étrangère des Etats-Unis.
A ce stade, ce qui restait des anciens Républicains « réalistes » tels que Henry Kissinger et Brent Scowcroft, vieillissait ou était tellement compromis que les néo-conservateurs n’avaient plus d’opposition significative dans les cercles républicains. De plus, la politique étrangère officielle des Démocrates était presque impossible à distinguer de celle des néoconservateurs, à l’exception de leur recours à des arguments « humanitaires » pour justifier les guerres d’agression.
La capitulation des médias.
Avant l’invasion de l’Irak par George W. Bush, une grande partie de l’élite des médias « progressistes » – du New York Times au New Yorker – s’est alignée derrière la guerre, et n’a posé que quelques rares questions gênantes sans offrir de véritable résistance. Etre favorable à la guerre devint un plan de carrière « sage ».
Mais un mouvement anti-guerre surgit des rangs démocrates, propulsant Barack Obama, un Démocrate opposé à la guerre en Irak, à la nomination du parti pour l’élection présidentielle de 2008 au détriment de la va-t-en-guerre Hillary Clinton. Mais les sentiments pacifistes de la « base » du parti Démocrate n’ont pas eu grand effet chez les ténors Démocrates en matière de politique étrangère.
Lorsque Barack Obama est entré à la Maison Blanche, il a du faire face à un défi difficile. Le Département d’Etat avait besoin d’une purge complète des néoconservateurs et des faucons/libéraux, mais les experts en politique étrangère qui n’avaient pas vendu leur âme aux néoconservateurs étaient devenus rares. Une génération entière de décideurs politiques démocrates avait été élevée dans un monde dominé par des conférences, des réunions, des éditoriaux et des think tanks néoconservateurs, où un discours musclé passait bien et où un discours diplomatique plus traditionnel vous faisait passer pour un mou.
En revanche, de plus en plus de gens au sein de l’armée US et même de la CIA étaient favorables à des approches moins agressives, en partie parce qu’ils avaient effectivement combattu dans la « guerre mondiale contre le terrorisme » sans espoir de Bush. Mais le haut commandement, soigneusement désignée par Bush et aux penchants néo-conservateurs – comme le général David Petraeus – sont restés en place et ont favorisé l’extension des guerres en Irak et en Afghanistan.
Obama a ensuite pris l’une des décisions les plus fatidiques de son mandat. Au lieu de nettoyer le Département d’Etat et le Pentagone, il a prêté l’oreille à certains conseillers qui ont brandi la notion, astucieuse sur le plan de la communication, d’ « Equipe de Rivaux » – une référence au premier cabinet d’Abraham Lincoln pendant de guerre civile [des Etats-Unis] – et a maintenu à leurs postes la direction militaire de Bush, y compris Robert Gates comme secrétaire à la Défense, et a tendu la main au sénatrice belliciste Hillary Clinton en lui proposant le poste de secrétaire d’État.
En d’autres termes, non seulement Obama n’a pas pris le contrôle de l’appareil de politique étrangère, il a renforcé le pouvoir des néo-conservateurs et des faucons libéraux. Il laissa alors ce puissant bloc Clinton-Gates-Petraeus l’entraîner dans une contre-insurrection téméraire en Afghanistan dont le seul bilan fut la mort de 1.000 soldats US supplémentaires ainsi que de nombreux autres Afghans.
Obama a également laissé Clinton saboter sa tentative de rapprochement avec l’Iran en 2010 sur la question de son programme nucléaire et il a succombé à sa pression en 2011 pour envahir la Libye sous le faux prétexte d’établir une « zone d’exclusion aérienne » pour protéger les civils, et qui se transforma en une catastrophique « changement de régime » qu’Obama a désigné comme sa plus grande erreur de politique étrangère.
Le conflit syrien
Obama a résisté aux appels du Secrétaire Clinton pour une autre intervention militaire en Syrie tout en autorisant un certain soutien militaire limité aux rebelles prétendument « modérés » et a permis à l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie de faire beaucoup plus pour soutenir les djihadistes liés à Al-Qaïda et même à l’État islamique.
Sous Hillary Clinton, le bloc néoconservateur / libéral-faucon a consolidé son emprise sur le corps diplomatique du département d’Etat. Sous la domination néo-conservatrice, le Département d’Etat est passée d’une « pensée collective » à une autre. N’ayant rien appris de la guerre en Irak, la pensée unique continua sa lancée en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, en Russie, en Chine, au Venezuela, etc.
Partout, l’objectif était le même : imposer l’hégémonie des Etats-Unis, forcer les populations à se plier aux diktats US, les orienter vers des solutions néo-libérales et de « marché libre » qui étaient souvent assimilées à la « démocratie », même si la plupart des gens concernées n’étaient pas d’accord.
Le double-discours et la double-pensée prirent la place d’une pensée politique axée sur des réalités. Le terme « Communications stratégiques », à savoir l’utilisation agressive de la propagande pour faire avancer les intérêts étasuniens, devint un mot d’ordre. Un autre fut « Smart Power » [« pouvoir intelligent » – NdT], à savoir l’application de sanctions financières, de menaces d’arrestations, des frappes militaires limitées et d’autres formes d’intimidation.
Chaque occasion de propagande, comme l’attaque au gaz sarin en Syrie en 2013 ou l’abattage du vol 17 de Malaysia Airlines dans l’est de l’Ukraine, fut exploitée au maximum pour pousser les adversaires sur la défensive, même si les analystes du renseignement US doutent que les éléments présentés constituent des preuves.
Le mensonge au plus haut niveau du gouvernement des Etats-Unis – mais surtout chez les hauts fonctionnaires du Département d’Etat – devint une épidémie. Peut-être pire encore, le « diplomates » étasuniens semblaient croire à leur propre propagande.
Pendant ce temps, les médias traditionnels étasuniens ont connu une dérive similaire pour finir dans l’orbite de domination des néoconservateurs et du carriérisme professionnel, ce qui exclut les principaux organes de presse que tout type de contrôle sur des mensonges officiels.
Les nouvelles têtes d’affiche
La nouvelle star du Département d’Etat – qu’on attend à être nommée à un poste important par la Présidente Clinton – est la néoconservatrice et Secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes, Victoria Nuland, qui a orchestré le putsch de 2014 en Ukraine qui a renversé un président élu, pro-russe pour le remplacer par un régime nationaliste ukrainien dur qui a ensuite lancé des attaques militaires dans l’est du pays contre les Russes ethniques qui résistaient aux putschistes.
Quand la Russie est venue en aide à ces citoyens ukrainiens retranchés, y compris en acceptant la demande de la Crimée de rejoindre la Russie, les médias du Département d’Etat et des États-Unis ont parlé d’une seule voix pour dénoncer une « invasion russe » et soutenir les manoeuvres militaires de l’OTAN sur les frontières de la Russie pour dissuader toute « agression russe. »
Toute personne qui ose remettre en question cette dernière « pensée de groupe » – qui plonge le monde dans une dangereuse nouvelle guerre froide – est accusé d’être un « apologiste du Kremlin » ou un « larbin de Moscou », tout comme les sceptiques de la guerre en Irak ont été raillés comme des « apologistes de Saddam. » Pratiquement tous ceux qui comptent dans les milieux officiels à Washington sont sur le sentier de la guerre. (Victoria Nuland est mariée à Robert Kagan, ce qui fait d’eux l’un des principaux couples de pouvoir à Washington.)
Voilà le contexte de la dernière rébellion du Département d’Etat contre la politique plus tempérée d’Obama en Syrie. En prévision d’une probable élection d’Hillary Clinton, ces 51 « diplomates » ont paraphé une déclaration « dissidente » qui préconise le bombardement de l’armée syrienne pour protéger les rebelles syriens « modérés » qui – en admettant qu’ils existent – se battent pour la plupart sous les couleurs du front Al-Nusra, une filiale d’al-Qaïda, et son proche allié, Ahrar al Sham.
La pensée confuse dans cette « dissidence » affirme qu’en bombardant l’armée syrienne, le gouvernement US pourra accroître l’influence des rebelles et forcer Assad à négocier son retrait. Mais il n’y a aucune raison de penser que ce plan pourrait marcher.
Au début de 2014, lorsque les rebelles occupaient une position relativement forte, les pourparlers de paix initiés par les Etats-Unis se sont transformés en une conférence dominée par les rebelles et posait comme condition préalable le départ d’Assad, tout en excluant les alliés iraniens de la Syrie. Sans surprise, le représentant d’Assad est rentré chez lui et les négociations ont échoué.
Désormais, avec Assad dans une position relativement forte, soutenue par la puissance aérienne russe et les forces terrestres iraniennes, les diplomates étasuniens « dissidents » disent que la paix est impossible parce que les rebelles ne sont pas en mesure de contraindre Assad de partir. Ainsi, les « dissidents » recommandent que les États-Unis étendent leur rôle dans la guerre pour donner un nouveau coup de main aux rebelles, ce qui entraînera de nouvelles exigences maximalistes de leur part.
Risques graves
Ce projet de guerre élargie présente de très graves risques, dont celui d’un effondrement de l’armée syrienne, ce qui ouvrirait les portes de Damas au front al-Nusra/Al-Qaïda (et ses alliés) ou à l’État islamique – un scénario qui, comme le souligne le New York Times, « n’est pas abordé dans le memo »
À l’heure actuelle, l’État islamique et – dans une moindre mesure – le Front Al-Nusra sont sur la défensive, pourchassés par l’armée syrienne avec le soutien de l’aviation russe et par certaines forces kurdes avec le soutien des Etats-Unis. Mais ces avancées pourraient facilement être renversées. Il y a aussi le risque de déclenchement d’une guerre plus large avec l’Iran et / ou la Russie.
Mais faire des étincelles près d’un baril de poudre n’a jamais fait peur aux néo-conservateurs et aux faucons libéraux. Ils ont toujours concocté des plans qui peuvent paraître séduisants lors d’une conférence ou dans un éditorial, mais échouent face à la réalité du terrain où les des soldats étasuniens sont censés réparer les dégâts.
Nous avons vu comment cette pensée magique a mal tourné en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Ukraine et même en Syrie où, après l’accord d’Obama de fournir des armes et une formation aux soi-disant « licornes » – ces rebelles « modérés » difficiles à observer – on a vu les combattants rejoindre avec armes et bagages les rangs d’Al-Qaïda ou de l’État islamique.
Pourtant, les néo-conservateurs et faucons libéraux qui contrôlent le Département d’Etat – et qui attendent avec impatience l’élection d’Hillary Clinton – ne cesseront jamais de sortir de nouvelles idées folles de leurs chapeaux tant qu’un effort concerté ne sera pas entrepris pour évaluer leurs responsabilités dans tous les échecs subis par la politique étrangère des États-Unis.
Tant qu’il n’y aura pas de responsables – tant que le président des Etats-Unis ne freinera pas ces bellicistes – cette folie ne fera que s’amplifier et deviendra de plus en plus dangereuse.
Robert Parry
Traduction “et dire qu’on a les mêmes chez nous” par VD pour le Grand Soir avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles.
Source : Le Grand Soir, Robert Parry, 19-06-2016