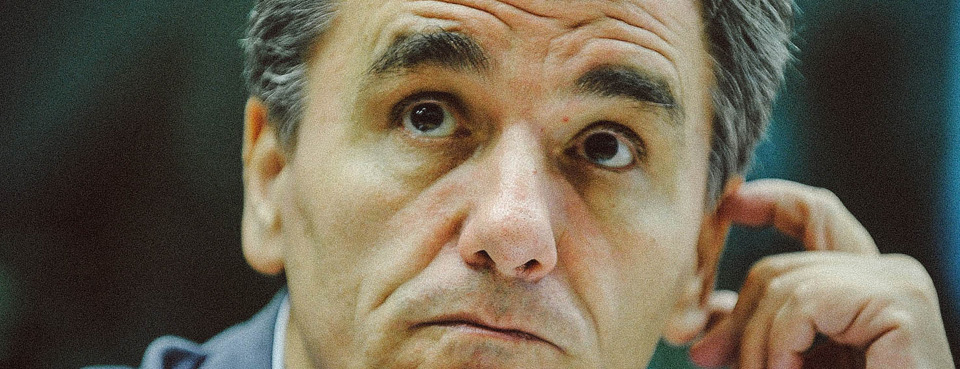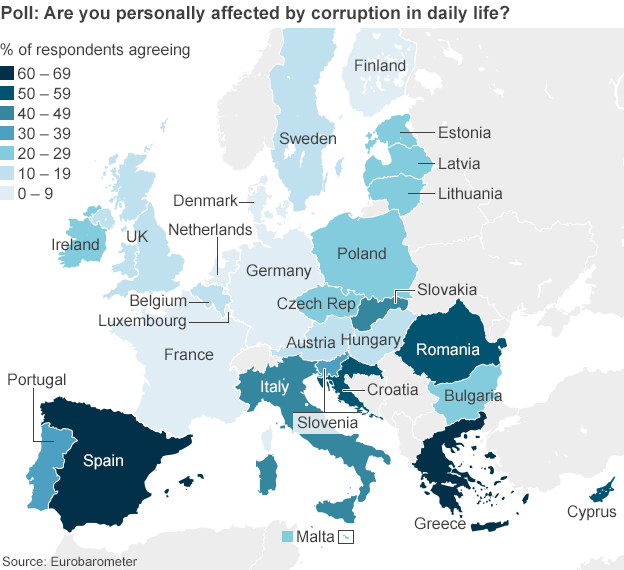Un billet de 2014, très intéressant…
Aux origines de la monnaie commune européenne : les différends entre la France et l’Allemagne sur fond d’hégémonie américaine
En cette nouvelle année, alors que 2015 sera vraisemblablement emplie de défis pour l’Europe, pour l’euro et tous ceux qui doivent vivre avec, Yanis Varoufakis nous offre un extrait fort à propos de son prochain livre, qui fait suite au Minotaure planétaire. En voici un fragment qui relate la première fois où l’euro fut proposé aux plus hauts échelons du pouvoir politique européen.
Une proposition indécente
Kurt Schmücker était un homme peu habitué aux émotions fortes. Mais en ce matin du 23 mars 1964, il eut du mal à en croire ses oreilles et parvint avec beaucoup de difficultés à contenir son étonnement.
En tant que ministre allemand de l’Economie,[1] Herr Schmücker rencontrait régulièrement son homologue français, Valéry Giscard d’Estaing, le ministre des Finances du Président Charles de Gaulle, qui deviendrait lui-même, dix ans plus tard, Président de la République française. Donc, lorsque Giscard se rendit au bureau de Schmücker, à Bonn, pour une discussion de deux heures, le ministre allemand était parfaitement détendu, anticipant une autre de ces réunions anodines, dont le véritable objectif, à l’instar de tous les raouts précédents, était d’afficher l’unité européenne entre les deux ennemis d’autrefois endossant la lourde responsabilité de construire une Union Européenne dans les premières étapes de son développement.[2]
Normalement, Schmücker et Giscard échangeaient d’aimables points de vue sur la manière dont chacun percevait la politique économique de l’autre, comment les deux pays s’accommodaient des mouvements monétaires transfrontaliers, les taux d’intérêt et les balances commerciales, leurs dispositions à l’égard de la fiscalité des entreprises et, bien sûr, les efforts qu’ils déployaient conjointement pour cimenter une Union Européenne qui en était encore à ses premiers balbutiements. Ils se racontaient occasionnellement leurs infortunes vis-à-vis de leurs banquiers centraux, la Bundesbank et la Banque de France, et les relations tendues qu’ils entretenaient avec eux. Autrement dit, rien n’aurait pu préparer Herr Schmücker à ce qu’il allait entendre. Mais, ce matin-là, une fois passées les mondanités du protocole, Giscard sortit une proposition choquante : La France et l’Allemagne devraient créer une monnaie commune, invitant les quatre autres membres de l’Union Européenne à s’y joindre lorsqu’ils y seraient prêts.
Il fallut à Schmücker quelques instants pour recouvrer ses esprits. De quoi l’aristocrate français était-il en train de lui parler ? L’Allemagne et la France partageant les mêmes billets de banque, les mêmes pièces de monnaie, la même banque centrale ? Laquelle ? La Bundesbank ? Grands Dieux !, a-t-il certainement dû s’écrier intérieurement. Mais il ne laissa filtrer aucune émotion à l’extérieur, conservant un visage de marbre, plutôt sombre. Effectivement, le compte-rendu officiel montre qu’il a réagi comme s’il n’avait pas entendu cette proposition sismique. Pourquoi ne pas être plus modestes, riposta-t-il ? Pourquoi ne nous contenterions-nous pas de stabiliser nos taux de change à travers nos banques centrales et sur la base d’une « stricte discipline » (la grande obsession des conservateurs allemands) et de « règles contractuelles » ?[3]
Giscard n’en avait que faire : « Pourquoi choisir ce système qui ne fonctionne que tant que tout le monde l’accepte ? » répliqua-t-il énergiquement, ajoutant que sa proposition venait de tout en haut – du Président Charles de Gaulle lui-même. Sidéré, Schmücker essaya d’alerter le ministre des Finances français sur la signification plus profonde de ce que de Gaulle proposait : La France proposait de renoncer à sa souveraineté nationale ! Paris était-il vraiment sérieux ? Giscard ni ne confirma ni n’infirma cette évidence exprimée par Schmücker. Il contourna cette remarque en préconisant une action rapide afin qu’une monnaie commune franco-allemande puisse être créée dans les plus brefs délais, laissant les autres membres de l’Union Européenne libres de s’y joindre ou non.
Et c’est ainsi qu’une monnaie commune européenne fut présentée pour la première fois, brièvement discutée et. spectaculairement ignorée. Schmücker savait que ce n’était pas un sujet sur lequel il avait la moindre autorité pour s’y impliquer sérieusement. Il passa consciencieusement la proposition du Général de Gaulle à Ludwig Erhard, son Chancelier.
En lisant le résumé que lui rédigea Schmücker, le Dr Erhard flaira quelque chose de louche. Il était impossible que la France abandonne aussi facilement son pouvoir d’établir les taxes, de dépenser ses fonds publics, de fixer ses taux d’intérêt, de poursuive sa chère « planification ». De Gaulle devait, une fois de plus, avoir quelque chose derrière la tête, pensa Erhard. Après tout, la seule raison pour laquelle Ludwig Erhard avait accédé au plus haut poste du pouvoir en Allemagne, quelques mois plus tôt, était à cause du rôle qu’il avait joué pour contrecarrer les desseins du Président de Gaulle. Sa proposition insensée de monnaie commune, pensa Erhard, ne pouvait avoir de sens qu’en tant que prolongement de ces mêmes desseins.
Ne souhaitant pas entrer dans une confrontation publique et officielle avec la France, le Chancelier Erhard « égara » consciencieusement le résumé de Schmücker et prétendit ne l’avoir jamais reçu. Néanmoins, lorsqu’il fut obligé de quitter la Chancellerie, en 1966, parmi les rares documents qu’il emmena avec lui dans sa retraite se trouvait ce résumé – une note sur la première idée officielle de l’euro.[4]
Valéry Giscard d’Estaing n’a jamais été le larbin de de Gaulle. Pour preuve, le Général le vira du ministère des Finances en 1966 et Giscard dût attendre trois ans jusqu’à ce qu’un nouveau président, Georges Pompidou, accède au Palais de l’Elysée, pour récupérer le ministère des Finances – d’où, en 1974, il accédera lui-même à la Présidence de la République française. Bien sûr, à l’époque, en 1964, Giscard s’efforçait de servir loyalement de Gaulle, souvent contre son meilleur jugement concernant certaines idées fixes de l’ancien général.[5] Cependant, à cette occasion, le 23 mars 1964, la « proposition indécente » qu’il portait à Bonn était totalement en accord avec sa propre pensée. Giscard partageait avec de Gaulle un jugement crucial. Ils étaient d’accord sur le fait que l’hégémon demandait la lune. A la fois littéralement et métaphoriquement. Les Américains déclenchaient des guerres en Indochine. Ils annonçaient de coûteux et extraordinaires programmes sociaux chez eux. Leurs grandes entreprises rachetaient de vénérables sociétés européennes et les traitaient de façon scandaleuse.[6] « Et comment payaient-ils tout cela ? En imprimant des dollars qui, une fois sortis de l’imprimerie, inondaient les économies européennes et forçaient les Européens à payer les largesses américaines par une inflation plus élevée. Le fait que la France fut plus susceptible que les autres pays à ces forces inflationnistes pesait aussi lourdement sur la pensée de de Gaulle et de Giscard.
Du point de vue de Giscard, les Américains forçaient les Européens à leur prêter l’argent avec lequel ils achetaient l’Europe et déstabilisaient la finance mondiale. Giscard résuma ce verdict d’une façon restée célèbre avec ces deux mots : « privilège exorbitant » ; un avantage démesuré dont bénéficiaient les Etats-Unis, et leur monnaie qu’ils dilapidaient ; un avantage qui devait être éliminé avant que le capitalisme mondial ne soit déstabilisé pour de bon et que les opposants à la bourgeoisie au pouvoir, en particulier en France, ne prennent le dessus.
La formule de Giscard, « privilège exorbitant », devint immédiatement un signifiant de la puissance financière américaine, et le reste à ce jour.[7] Mais que pouvait-on faire pour réduire ce privilège exorbitant ? Dès 1964, dans l’opinion de Giscard, il était possible d’imaginer que la seule façon de mettre fin à la domination monétaire imprudente des Etats-Unis était que la France et l’Allemagne, les deux nations prédominantes de l’Europe, s’attèlent ensemble à forger une monnaie commune afin de surmonter leur dépendance vis-à-vis d’Etats-Unis d’Amérique devenus incontrôlables. Mais cela ne mettrait-il pas en danger, comme Schmücker avait prévenu, la souveraineté de la France ? Bien sûr que si. Mais c’était un prix qui avait peu d’importance pour Giscard, qui croyait fermement en des Etats-Unis d’Europe.
Il se peut que la perte de la souveraineté nationale de la France importât peu à Giscard. Mais pas à son patron, le Président de Gaulle. L’Europe était importante pour de Gaulle, comme elle l’était pour Giscard. Elle devait être « gagnée ». Mais pas à n’importe quel prix, du moins en ce qui concernait le Général. Et certainement pas au prix de la « perte » de la France dans le processus. Alors, pourquoi de Gaulle envoya-t-il son ministre des Finances à Berlin avec une proposition qui, si elle était acceptée, démantèlerait les leviers du pouvoir économique de Paris ? Une monnaie commune avec l’Allemagne ferait perdre à la France le contrôle de sa propre économie. Mais une proposition de monnaie commune n’est pas la même chose qu’une… monnaie commune !
De Gaulle était, ne l’oublions pas, un tacticien militaire hors pair. Des propositions de traités et de monnaies communes, à l’instar des manœuvres sur le champ de bataille, équivalaient à des mouvements de pions sur un échiquier dans l’intention de faire diversion. Ce n’est qu’assez tard (vers 1958), et seulement lorsqu’il commença à la voir comme ouvrant de nouvelles perspectives de grandeur pour son Etat-nation, qu’une Europe unie commença à séduire de Gaulle. Cela contraste nettement avec l’idée que s’en faisaient les deux premiers chanceliers allemands de l’après-guerre, Konrad Adenauer et Ludwig Erhard, pour lesquels l’Union européenne était une sortie de secours pour leur Etat-nation.
Janvier 1963 fut un mois de politique incendiaire sentant le soufre, avec Paris à son centre. Le 14 janvier, le Président de Gaulle donna une conférence de presse qui se résumait à une déclaration d’hostilités contre l’anglosphère. Contrant les souhaits explicites de Washington, il annonça que la France mettrait son veto à l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Et comme si cela ne suffisait pas, il déclina dans la foulée l’offre américaine d’une coopération nucléaire avec la France au sein d’une force multilatérale.
Huit jours plus tard, le 22 janvier, le Chancelier allemand Konrad Adenauer, se rendit à Paris. Dans les splendeurs du Palais de l’Elysée, en grande pompe et avec une cérémonie considérable, Adenauer et de Gaulle apposèrent leurs signatures sur le Traité de l’Elysée, un traité présenté au monde comme la pierre angulaire du rapprochement franco-allemand, un témoignage de la cessation permanente des hostilités entre les deux nations prédominantes de l’Europe, et le commencement d’une « merveilleuse amitié ». Washington était outré. George Ball, le sous-secrétaire au Département d’Etat, écrivit plus tard : « Il m’est difficile de surestimer le choc que cet acte produisit à Washington ou la spéculation qui suivit, en particulier dans la communauté des services de renseignements ».[8]
L’ire de Washington n’avait rien à voir avec une opposition à ce que la France et l’Allemagne enterrent la hache de guerre, se rapprochent et renforcent l’unité européenne. Le gouvernement américain s’inquiétait que de Gaulle eût « quelque chose derrière la tête », « quelque chose » visant le Plan mondial d’ensemble d’après-guerre des Etats-Unis. Plus précisément, ils craignaient que de Gaulle tentât d’attirer par la ruse Adenauer dans une alliance stratégique ayant un double objectif : au niveau de la finance internationale, saper le système de Bretton Woods centré sur le dollar, et , au niveau géopolitique, contourner l’OTAN en offrant à Moscou un pacte de non-agression, écartant les Etats-Unis de cet accord.
La marque la plus forte de de Gaulle était sa grande vision d’une Europe s’étendant « de l’Atlantique à l’Oural ». Cela séduisait une pluralité d’Européens qui tenaient à supprimer la menace nucléaire qui planait sur leur continent (en particulier après la crise des missiles cubains qui s’était déroulée le mois précédent, en octobre), et qui gardaient bon espoir de lever le Rideau de Fer qui le séparait si brutalement. Pour les Allemands, en particulier, une Europe de « l’Atlantique à l’Oural » était chargée d’une importance supplémentaire, puisque cela faisait allusion à la réunification de l’Allemagne. Washington était convaincu que de Gaulle appâtait Adenauer dans une alliance qui mettrait fin à la domination des Etats-Unis en Europe. Ces craintes étaient renforcées par le fait que le Chancelier allemand était un catholique anglophobe ayant souvent recherché l’unité avec la France.[9]
La veille de la signature du Traité de l’Elysée, un diplomate américain [10] enrôla le seul membre du cabinet d’Adenauer qui avait le pouvoir, et un intérêt pour le faire, de s’opposer à la dérive d’Adenauer vers l’étreinte de de Gaulle : Ludwig Erhard, le respecté ministre des Finances d’Adenauer, qui avait supervisé le miracle économique de l’Allemagne depuis 1949. Erhard n’agit pas dans la précipitation. Il prit son temps. Lorsque Adenauer convoqua le cabinet fédéral à Bonn, le 25 janvier, pour discuter du Traité de l’Elysée, Erhard resta coi. Cependant, quatre jours plus tard, Il fit un discours musclé critiquant la politique étrangère française, prenant l’initiative sans précédent de prédire que, quand bien même le Traité de l’Elysée serait ratifié, il ne serait jamais appliqué.
Lors du conseil des ministres suivant, à Bonn, le 30 janvier, Erhard se lâcha, s’exprimant contre « la dictature française de de Gaulle », comparant même le Président français à Hitler. Dans un article publié dans Die Zeit, le 5 février, Erhard mit en garde ses compatriotes que l’Allemagne « ne peut pas jouer double-jeu », signalant clairement son allégeance à Washington et fustigeant Adenauer pour être devenu trop proche de de Gaulle à son goût. Le même jour, le Président Kennedy prévint l’Allemagne qu’elle devait « choisir entre travailler avec les Français ou travailler avec nous ».[11] Erhard conduisit l’opposition à Adenauer qui fit basculer le cabinet allemand dans le sens des Américains.
A partir d’avril 1963, l’intervention décisive d’Erhard avait affaibli la position d’Adenauer au sein de la Démocratie Chrétienne au pouvoir, qui le proclama unique candidat pour remplacer le Chancelier vieillissant. Le 16 mai, après pas mal de manœuvres dans les coulisses, Erhard et ses alliés réussirent à faire voter au Parlement fédéral un amendement au Traité de l’Elysée, sous la forme d’un Préambule qui mettait fin au rêve de de Gaulle d’une alliance franco-allemande en opposition aux Etats-Unis.[12] Pendant ce temps, certain du fait que de Gaulle avait été « éconduit », le ministère américain des Affaires étrangères re-calibra sa stratégie européenne, évitant d’autres confrontations avec de Gaulle et se concentrant à la place à cultiver des liens plus intenses avec Bonn. Et c’est ainsi que, en octobre 1963, Ludwig Erhard accéda à la Chancellerie, transmettant le ministère de l’économie à Kurt Schmücker. Ayant vu son étreinte si spectaculairement rejetée, il fut assez remarquable que le Président de Gaulle ne tint pas rancune au nouveau Chancelier allemand. Même le fait d’avoir été comparé à Hitler glissa sur lui comme de l’eau sur les plumes d’un canard. Lorsque Erhard fut intronisé Chancelier, il se fit un devoir de se rendre immédiatement à Paris pour réaffirmer « la formidable nouvelle amitié entre les deux nations » et . leurs dirigeants. Le Président de Gaulle l’accueillit à bras ouverts, comme s’il s’était agi d’un ami de toujours. Mais six mois plus tard, il envoya à Bonn son ministre des Finances, l’engageant Valéry Giscard d’Estaing, pour stupéfier Herr Schmücker avec sa proposition d’une union monétaire franco-allemande instantanée.
De Gaulle n’avait-il donc « pas compris » que l’Allemagne répugnerait à une autre de ses étreintes étouffantes ? Quoi qui pouvait trotter dans la tête du Général, une chose est sûre : il ne se faisait aucune illusion. L’idée que de Gaulle espérait qu’Erhard accepte une monnaie commune franco-allemande est aussi absurde que l’idée inverse, à savoir que de Gaulle voulait une telle monnaie. La proposition d’une monnaie partagée avait deux caractéristiques tactiques qui attiraient le Président-stratège français : l’élément de surprise et la capacité (même si la proposition était ignorée ou rejetée) d’enrôler l’Allemagne dans une relation avec la France suffisamment proche pour permettre à de Gaulle une plus grande liberté dans son opposition aux Etats-Unis.
L’élément de surprise, à n’en pas douter, fut là. Erhard et Schmücker avaient toutes les raisons de s’attendre à ce que, après le « départ » d’Adenauer, de Gaulle les laisse tranquilles. La proposition d’une monnaie commune était la dernière chose à laquelle ils s’attendaient. Ainsi que Schmücker le dit à Giscard, rien dans son comportement ne laissait présager que Paris serait prêt à renoncer à sa souveraineté nationale ou même reporter sur des institutions supranationales les décisions importantes en matière d’économie française. Il avait raison. La France, et en particulier de Gaulle, gardait jalousement ses leviers économiques et n’avait aucun intérêt à en laisser partir. Pendant bien plus de dix ans [13], de Gaulle était resté seul parmi les politiciens européens conservateurs en opposition obstinée à la nouvelle relation économique franco-allemande que les New Dealers américains avaient très envie de transformer en colonne vertébrale de l’Union européenne émergente.[14]
Contrairement à beaucoup de ses compatriotes naïfs, qui tiraient une grande fierté du projet d’intégration européenne et qui ne tarissaient pas d’éloges à son endroit en disant que c’était une formidable réussite de l’esprit européen, de Gaulle avait reconnu le projet d’Union européenne comme étant une « conception américaine » qui privilégiait l’industrie allemande afin de cimenter la domination américaine au niveau mondial. Le marché commun européen et le processus d’intégration européenne faisaient partie, à ses yeux, d’un Plan mondial américain que de Gaulle considérait mal fondé, non-viable et, par conséquent, nuisible à la France et à l’Europe.[15]
Finalement, de Gaulle avait adouci sa position vis-à-vis de l’Union européenne, après les promesses américaines répétées, dans les années 1950, que la France resterait le centre administratif de l’Europe. Mais il ne l’embrassait que tant que, selon ses propres mots confiés à un journaliste étranger, l’Union européenne ressemblerait « . à un cheval et un attelage : l’Allemagne étant le cheval et la France. le cocher ».[16]
Hélas, dès 1963, il devint clair que le « cheval » développait un esprit indépendant et que le « cocher » perdait le contrôle. Le déficit commercial de la France avec l’Allemagne allant croissant signifiait que Paris serait forcé de devoir perpétuellement choisir entre deux options insoutenables : soit se présenter régulièrement chapeau bas devant le FMI pour demander la permission de dévaluer le franc, admettant une « faiblesse nationale » permanente, soit compter éternellement sur la Bundesbank pour imprimer des deutschemark avec lesquels acheter des francs, concédant une dépendance incessante vis-à-vis de l’ancien ennemi. Dans tous les cas, les aspirations de la France à une domination politique et diplomatique de l’Union européenne s’effilochaient.
C’était un cauchemar pour de Gaulle, et également pour l’establishment français, qui voyait dans le Général un défenseur intrépide de leurs intérêts et de leurs ambitions, tant au niveau national que dans toute l’Europe. La bravacherie de de Gaulle se heurtait parfois au sens policé de la société pour le décorum mais, lorsqu’il s’agissait de traiter avec les politiciens allemands, les responsables américains et les financiers anglo-saxons, les élites françaises aimaient la méfiance inhérente de leur Président, son empressement à dire ce qu’il pensait, de même que son engagement envers une « monnaie forte » – une devise stable et non-inflationniste qui restaurerait l’image de la France, soutiendrait son secteur bancaire et, ce qui est important, affaiblirait les vindicatifs syndicats français.[17]
De Gaulle a toujours été prudent quant à une union toujours plus étroite avec l’Allemagne. Il voyait l’unité avec l’autre côté du Rhin comme un sentiment admirable rempli de danger, quel que soit son mérite pour la France. Même après 1958, lorsqu’il embrassa l’idée d’une Union européenne érigée le long d’un axe franco-allemand, de Gaulle resta circonspect. Lorsque Henry Kissinger lui demanda, un jour, comment la France empêcherait la domination de l’Allemagne sur l’Union européenne, le Président français répondit : « Par la guerre ! »[18] Le héros de guerre français ne plaisantait pas. En effet, sa proposition indécente d’une monnaie commune avec l’Allemagne, que Giscard transmit à un Schmücker estomaqué, était une forme de guerre par d’autres moyens.
Le Chancelier Erhard le savait. Au premier aperçu de la proposition de de Gaulle d’une monnaie commune, il reconnut un stratagème pour étouffer son pays, neutraliser la Bundesbank et brouiller les relations entre l’Allemagne et Washington.[19] Erhard avait rabaissé Adenauer et tout risqué pour aider son pays à se dégager de la première étreinte de de Gaulle. Il n’allait pas céder à sa deuxième étreinte. Réticent à repousser publiquement, pour la deuxième fois en un an, l’étreinte de de Gaulle, Erhard prétendit ne jamais avoir reçu la note de Schmücker.
Et c’est ainsi que, début mars 1964, l’idée de l’euro éclaira si brièvement les cieux de l’Europe, et de façon invisible pour la plupart des Européens. Ce n’est que lorsque l’Europe fut complètement rejetée de la « zone dollar » qu’elle refit surface.
___________
[1] Kurt Schmücker n’était pas atypique des démocrates-chrétiens qui furent au pouvoir sans interruption en Allemagne de 1949 à 1969. Dans ses jeunes années, à 18 ans, en 1937, il rejoignit le parti nazi et, trois ans plus tard, partit à la guerre, servant dans la Wehrmacht jusqu’au dernier jour. Un an après la fin de la guerre, il rejoignit les démocrates chrétiens et devint le plus jeune membre du parti à siéger au parlement fédéral après les élections de 1949. En 1963, après que Ludwig Erhard (un économiste accompli, ministre des Finances depuis 1949 et qui avait supervisé la très impressionnante reconstruction économique de l’Allemagne, 1949-1963) devint Chancelier, Schmücker prit le ministère de l’Economie. N’ayant suivi qu’une formation d’éditeur, Schmücker nourrissait une grande appréhension à propos de sa capacité de reprendre le rôle d’Erhard. En l’occurrence, les deux hommes (Erhard et Schmücker) furent chassés du gouvernement en 1966, à la suite de la première récession de l’Allemagne après la guerre, qui fut sans doute orchestrée pour des raisons politiques par la banque centrale du pays – la féroce Bundesbank.
[2] A l’époque, l’Union européenne s’appelait la Communauté économique européenne (CEE) et comprenait six membres, les signataires du Traité de Rome (signé le 25 mars 1957) : l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et l’Italie. La CEE fut renommée Union européenne dans le Traité de Maastricht, le 1er novembre 1993 – en même temps que les règles gouvernant la monnaie commune, l’euro, furent acceptées. Tout au long de cet article, pour des raisons de continuité, je me réfèrerai à la CEE par « Union européenne ».
[3] Leur conversation commença avec Schmücker abordant les préoccupations de Giscard selon lesquelles le libre échange au sein de l’Union européenne créerait des déséquilibres commerciaux qui déstabiliseraient le taux de change entre le franc et le deutschemark. Il suggéra que les membres de l’UE (ou de la CEE, comme elle était appelée alors) devraient signer un contrat formel et respecter les règles concernant les politiques budgétaires et monétaires afin que ce système puisse être stable. Giscard avait d’autres considérations : (le dialogue ci-dessous est cité dans Schoenborn, 2014) :
Giscard : C’est trop peu ! Nous n’en avons pas encore parlé au niveau gouvernemental, mais de Gaulle m’a dit que des développements dangereux, tels que nous en connaissons aujourd’hui, ne peuvent être évités ou surmontés sans une monnaie commune aux pays de la CEE. Nous avons besoin d’une monnaie unique pour la CEE ! [Italiques ajoutées par l'auteur]
Schmücker : Afin d’obtenir le même effet, les monnaies peuvent aussi être maintenues nominalement tandis que les politiques monétaires des Etats membres individuels seraient placées sous une discipline stricte à travers des règles contractuelles.
Giscard : Pourquoi choisir ce système, qui ne fonctionne que tant que tout le monde l’accepte ?
Schmücker : Je cherche juste une méthode qui marche sans obliger la France à renoncer à sa souveraineté. Une monnaie européenne unique serait un sujet supranational. Jusqu’à présent, la France s’est opposée bruyamment à quelque sorte d’arrangement supranational que ce soit.
Giscard : De Gaulle m’a dit explicitement qu’il considère qu’une monnaie unique pour la CEE est nécessaire. Il pense qu’il ne reste pas d’autre solution. Si un Etat pousse continuellement un autre dans l’inflation, les seuls bénéficiaires seront les socialistes.
Schmücker : Que ferons-nous si les quatre autres ne veulent pas s’y joindre? La création d’une union monétaire est une étape politique décisive. Une fois l’union monétaire accomplie, des conséquences politiques supplémentaires suivront automatiquement. Les tentatives d’Erhard de faire avancer l’union politique n’ont pas produit les réponses désirées de la part de tous les gouvernements. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cette proposition soit reçue avec scepticisme. Ou imaginez-vous que la France et l’Allemagne devraient aller de l’avant?
Giscard : Un accord entre la France et l’Allemagne ne devrait être considéré que si les autres ne participent pas. Dans ce cas, cet accord devra être établi de telle façon que les autres auront le choix, à la fois légalement et de façon pratique, de nous rejoindre à tout moment.
[4] Voir Schoenborn, 2014.
[5] Giscard était un fervent keynésien qui avait peu de temps à consacrer aux points de vue conservateur de de Gaulle sur la façon dont l’économie devait être dirigée. En particulier, il nourrissait un mépris considérable pour Jacques Rueff, un économiste qui croyait ferment en l’étalon-or et que de Gaulle considérait comme son gourou économique. En conséquence, le temps de Giscard en tant que ministre des Finances du gouvernement de de Gaulle était un mandat précaire.
[6] Pour donner un exemple approprié, en 1962, General Motors licencia les ouvriers automobiles français sans consulter le gouvernement français. Un an plus tard, en 1963, GM racheta Simca et procéda immédiatement à licencier une partie de sa main-d’œuvre. En attendant, General Electric « lorgnait » sur un certain nombre d’usines que Paris considérait comme étant d’importance stratégique pour la France.
[7] La phrase « privilège exorbitant » est fréquemment, et de façon erronée, attribuée à de Gaulle. Son véritable procréateur était Giscard. Voici comment Jacques Rueff, l’économiste français dont Giscard avait rejeté les théories économiques (mais avec lequel il devait travailler, puisque de Gaulle considérait Rueff comme étant son intellectuel économique préféré), expliqua ce que Giscard avait voulu dire par « privilège exorbitant » : « … lorsqu’un pays avec une devise clé a un déficit de sa balance des paiements – disons les États-Unis par exemple – il paye au pays créditeur des dollars, qui finissent dans sa Banque centrale. Mais les dollars ne sont pas d’utilité à Bonn, ou à Tokyo, ou à Paris. Le même jour, ils sont reprêtés sur le marché monétaire à New York, et donc retournent à leur endroit d’origine. Ainsi le pays débiteur ne perd pas ce que le pays créditeur a gagné. Et donc le pays avec la devise clé ne ressent jamais l’effet du déficit sur sa balance des paiements. Et la principale conséquence est qu’il n’y a aucune raison d’aucune sorte pour que ce déficit disparaisse, tout simplement parce qu’il n’apparaît pas.». Rueff & Hirsch (1965).
[8] Voir Ball, 1982, p. 271.
[9] Konrad Adenauer a mis sa marque sur la politique allemande bien avant la Seconde Guerre mondiale, servant en tant que Maire de Cologne de 1917 à 1933. Fervent catholique et opposant engagé contre la domination prussienne de l’Allemagne, il se servit de son poste pour soutenir un nouvel Etat rhénan, au sein de la République de Weimar, libéré du pouvoir de fer de Berlin. Lorsque ses efforts ne menèrent nulle part, il initia des pourparlers avec les responsables français dans l’idée d’établir un « Rhineland » autonome dans le contexte d’un grand concept d’une Europe Centrale qui forcerait à la réconciliation franco-allemande. Bien qu’il acceptât plus tard la montée du parti nazi, qu’il essaya d’héberger dans son hôtel de ville, les Nazis considéraient Adenauer comme un patriote « peu solide » (pour s’être trop rapproché des Français dans les années 1920). A la fin de la guerre, une Cologne détruite par les bombardements se retrouva dans la zone britannique, et l’on demanda à Adenauer de servir à nouveau en tant que Maire de la ville. Il accepta mais, en décembre 1945, il subit l’humiliation d’être révoqué par un général britannique pour « incompétence » – alors qu’en réalité, sa révocation était due à ses déclaration publiques condamnant le bombardement effréné de sa ville par la RAF. Adenauer ne pardonna jamais aux Britanniques cette humiliation.
[10] John Wills Tuthill, à l’époque ambassadeur des Etats-Unis auprès de la CEE.
[11] Voir le NSC Meeting Memo, 5 février 1963, 4.30 pm, FRUS, 1961-1963, vol. 13, pp. 175-179 ; Memorandum of Conversation, Carstens and Rusk, 5 février 1963, 6 p.m., ibid., p. 186; NSC Meeting, 31 janvier 1963, ibid., p. 162, Kennedy Library.
[12] Ce Préambule insistait sur « l’importance suprême de la coopération transatlantique » et était la première idée des responsables américains d’une « solution » au « problème » du Traité de l’Elysée. Ceux-ci ne perdirent aucun temps à faire savoir au cabinet d’Erhard qu’il devait être pris en considération. Ce Préambule, pour l’essentiel, annulait l’esprit du Traité de créer une alliance franco-allemande indépendamment des Etats-Unis. Selon la présentation qu’en avait faite Erhard devant les parlementaires à Bonn, ce Préambule était essentiel afin de « libérer le Traité de l’Elysée de toute fausse interprétation de la politique allemande ».
[13] De 1945 à 1958.
[14] L’opposition de de Gaulle à l’idée d’une Communauté économique européenne conçue par les Américains (qui naquit officiellement en 1950 en tant que Communauté européenne du charbon et de l’acier) était si acharnée qu’il traversa un désert politique jusqu’en 1958, lorsque l’effondrement de la 4ème République lui donna l’occasion de redessiner la constitution française, et la politique française, à son image.
[15] La construction du « Plan mondial » est relatée en détail dans Le Minotaure planétaire : l’ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial (Enquêtes & Perspectives, 2014). Cet ouvrage, sorti en décembre 2014, est disponible en versions numériques (kindle et e-Book) et papier (PoD-amazon).
Le lecteur devrait noter que la violente critique par de Gaulle du Plan mondial américain de l’après-guerre était partagée par d’importants décideurs politiques américains. Par exemple, George F. Kennan (le diplomate dont le Long Télégramme depuis Moscou engendra la logique de « l’endiguement » de l’URSS) et Robert Taft (le président républicain du Sénat américain qui s’opposa au New Deal de Roosevelt) déploraient également la perspective d’un monde divisé entre une sphère américaine et une sphère soviétique, opposées l’une à l’autre. Leur différence avec de Gaulle était que le Président français avait les moyens et la détermination de rendre le « bloc » américain ingérable.
[16] Voir Connolly (1993), p.7.
[17] Leur idée était simple : si l’Etat français renonçait au droit de battre monnaie (soit en retournant à l’étalon-or, soit en adoptant le deutschemark, les prix cesseraient d’augmenter et les syndicats perdraient tout pouvoir de négociation sur les employeurs : avec le gouvernement incapable de stimuler la demande d’ensemble, en particulier durant une crise, les syndicats auraient le choix entre accepter un chômage élevé (qui détruirait leur base de pouvoir) ou accepter des bas salaires. En bref, en renonçant à la planche à billets, l’Etat français s’assurerait que la main-d’œuvre syndiquée deviendrait moins militante, plus « allemande ». Et si cela impliquait une propension plus grande à la récession, c’était considéré comme un faible prix à payer. Aujourd’hui, avec la France en stagnation permanente sous l’euro, les élites françaises ne manifestent aucun regret face aux choix qu’elles ont faits et, simultanément, elles s’inquiètent de la marée montante de mécontentement et d’ultranationalisme raciste et anti-européen.
[18] By war! Voir Connolly (1993), p.7.
[19] La rébellion d’Erhard contre Adenauer devrait être replacée dans le contexte de la crainte de nombreux Allemands d’un retrait américain. Paul Volcker est cité par son biographe officiel pour avoir dit qu’il « … avait rappelé la menace de Kennedy … de couper l’aide militaire à l’Europe à moins que les Européens promettent de ne pas attaquer le dollar en tant que devise mondiale ». Voir Silber (2012), p.55.
Source : Questions Critiques