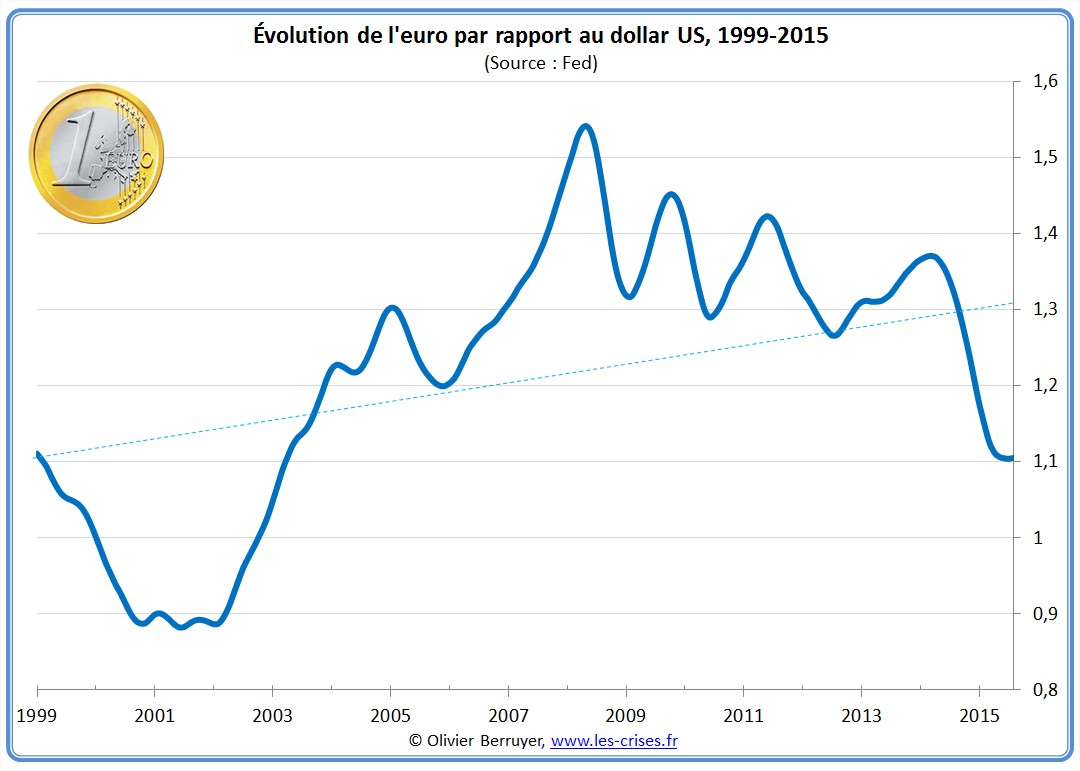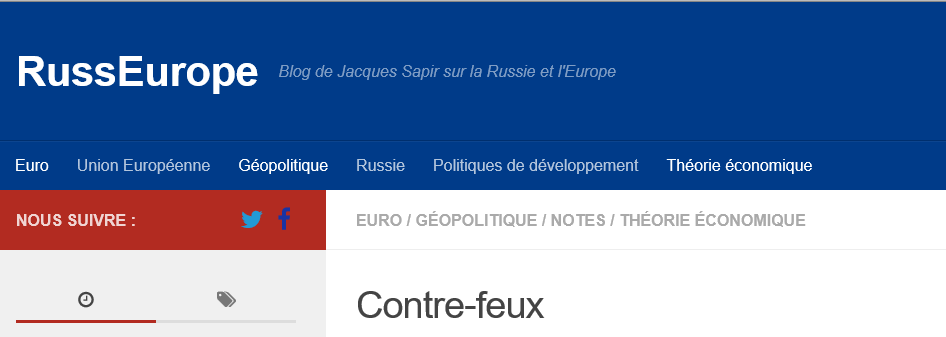Contre-feux
Source : Jacques Sapir, pour son blog RussEurope, le 11 août 2015.
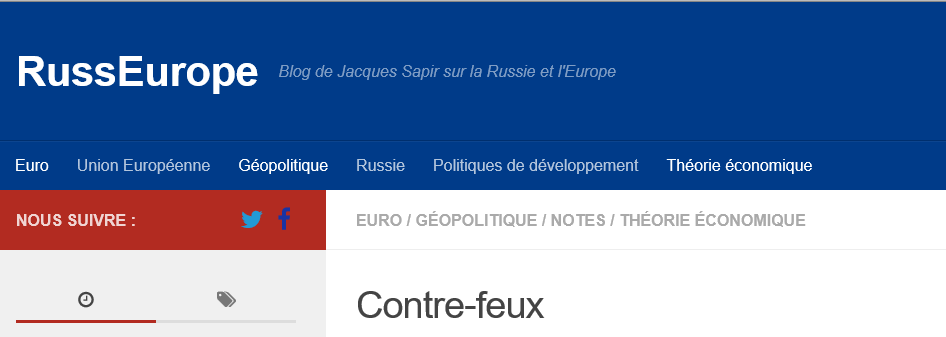
L’accord auquel la Grèce et ses créanciers semblent être arrivé aujourd’hui, mardi 11 août, après de longues négociations est un mauvais accord. Les 85 milliards qui sont prévus dans cet accord sont, aujourd’hui, largement insuffisant. Il ne pouvait en être autrement. Car ce texte est la conclusion logique du diktat imposé le 13 juillet 2015 par les créanciers à la Grèce. Et, ce diktat n’a pas été conçu dans l’objectif d’apporter un réel secours à la Grèce, même au prix d’énormes sacrifices, mais uniquement pour humilier et déconsidérer politiquement son gouvernement. Ce diktat est le produit d’une vengeance politique et n’a aucune rationalité économique.
Les doutes sont d’ores et déjà présent sur cet accord qui doit être ratifié d’ici le 20 août. Il a été longuement dénoncé dans diverses colonnes[1]. Il va accroître l’austérité dans un pays dont l’économie est en chute libre depuis les manœuvres de la Banque Centrale Européenne à partir du 26 juin dernier. L’accroissement des prélèvements fiscaux est un non-sens dans une économie en récession. Il faudrait, au contraire, injecter massivement de l’argent dans l’économie pour faire repartir la production. Tout le monde le sait[2], que ce soit le gouvernement grec ou ses créanciers. Pourtant ces derniers persévèrent dans l’erreur. Pourquoi ?
La responsabilité de l’Allemagne
On pointe souvent la responsabilité de l’Allemagne. De fait, ce pays entend lier cet accord à une stricte conditionnalité et ceci alors que les conditions mises aux précédents plans d’aides qui ont été signés depuis 2010 ont abouti à une chute de 25% du PIB et à une explosion du chômage. De même, l’Allemagne entend imposer une importante réforme des retraites à Athènes, alors que ces mêmes retraites jouent le rôle d’amortisseur à la crise dans un pays où les transferts intergénérationnels remplacent des allocations chômage désormais très faibles. Cela reviendra à appauvrir un peu plus la population, et à provoquer plus de récession. Enfin, l’Allemagne veut encore imposer de larges privatisations. Il est clair que ces dernières permettraient aux entreprises allemandes, qui sont loin d’être blanc-bleu sur la Grèce (la filiale grec de Siemens est au cœur d’un immense scandale fiscal) de continuer une liste d’achat à bon marché. On le voit, l’incompétence semble donner la main au cynisme.
La responsabilité de l’Allemagne est évidente. En fait, le seul espoir – si la Grèce doit rester dans la zone Euro – serait d’annuler une large part, de 33% à 50%, de la dette grecque. Mais, de cela, le gouvernement allemand ne veut rien savoir et ceci au moment où il apparaît qu’il a tiré de larges profits de la crise grecque comme le reconnaît un institut d’expertise allemand[3]. Il y a cependant dans l’obstination meurtrière du gouvernement allemand envers le peuple grec quelque chose qui va bien au-delà d’un attachement aux « règles » d’une gestion très conservatrice ou des intérêts particuliers. En fait, le gouvernement allemand entend punir le peuple grec pour avoir porté au pouvoir un parti de gauche radicale. Il y a ici une volonté clairement politique et non économique. Mais, le gouvernement allemand veut aussi faire de la Grèce un exemple afin de montrer, en regardant en direction de l’Italie et de la France comme le note l’ex-Ministre des finance Yanis Varoufakis[4], qui est le chef dans l’Union européenne. Et cela est des plus inquiétant.
Les déclarations de Romano Prodi
Dans ce contexte, les déclarations de M. Romano Prodi dénonçant dans un journal conservateur de la Vénétie, Il Messagero, ce qu’il appelle le « blitz allemand » doivent être regardées avec attention[5], mais aussi avec une certaine méfiance. Quant Romano Prodi, dont il faut rappeler qu’il fut président de la Commission européenne et Premier-ministre de l’Italie, dénonce le comportement du gouvernement allemand en considérant que ce dernier met en cause le fonctionnement même de la zone Euro, il y a peu à redire. Mais, ce comportement critiquable n’est nullement analysé dans ce qu’il révèle. Certes, le gouvernement allemand, dans la forme comme dans le fond, est en train de détruire la zone Euro. Mais, s’il le fait c’est qu’il n’a guère le choix. En effet, agir différemment reviendrait à accepter ce que propose implicitement Romano Prodi, soit une organisation fédérale de la zone Euro. Or ceci n’est pas possible pour l’Allemagne. Si l’on veut que la zone Euro ne soit pas ce carcan qu’elle est aujourd’hui qui allie la dépression économique à des règles austéritaires, il faudrait en effet que les pays du Nord de la zone Euro transfèrent entre 280 et 320 milliards d’euros par an, et cela sur une période d’au moins dix ans, vers les pays d’Europe du Sud. L’Allemagne contribuerait à cette somme sans doute à hauteur d’au-moins 80%. Cela veut dire qu’elle devrait transférer de 8% à 12% de son PIB, selon les hypothèses et les estimations, tous les ans. Il faut dire ici que ceci n’est pas possible. Tous ceux qui entonnent le grand lamento du fédéralisme dans la zone Euro avec des sanglots dans la voix ou avec des poses martiales n’ont pas fait leurs comptes ou bien ne savent pas compter. On peut, et on doit, critiquer la position allemande vis-à-vis de la Grèce parce qu’elle participe d’une vendetta politique contre un gouvernement légalement et légitimement élu. Mais exiger d’un pays qu’il transfère volontairement une telle proportion de sa richesse produite tous les ans n’est pas réaliste.
Romano Prodi n’est pas un imbécile
Or, Romano Prodi n’est certainement pas un imbécile, et ceux qui se souviennent de son intervention en Russie, au Club Valdaï de 2013 savent qu’il est d’une rare intelligence, et de plus il sait compter. Pourquoi, alors, s’obstine-t-il dans cette voie, et pourquoi appelle-t-il à un axe entre Rome et Paris pour rééquilibrer le rapport de force ? Pourtant, Romano Prodi sait très bien que ce n’est pas dans le gouvernement français que l’on peut trouver un partenaire résolu pour affronter Berlin[6]. Depuis septembre 2012, et le vote sur le TSCG, il est clair que François Hollande n’a aucune envie et aucune intention d’aller au conflit avec Madame Merkel. Son inaction, ou plus précisément son inaction, en témoigne tous les jours.
Alors, il nous faut bien admettre que Romano Prodi fait en réalité de la politique, et qui plus est de la politique intérieure italienne. Il sait que la question de l’Euro est aujourd’hui directement et ouvertement posée en Italie, que ce soit objectivement dans les résultats économiques qui se dégradent ou que ce soit subjectivement dans la multiplication des prises de position Euro-critiques de la gauche (avec l’appel de Stefano Fassina) à la droite et à la Ligue du Nord. Il faut comprendre sa position comme un contre-feu face à un changement, lent mais profond, de l’opinion publique et de l’opinion des politiques sur la question de l’Euro. Mais, pour que ce contre-feu soit efficace, il lui faut bien dire des vérités. D’où, l’analyse, qui n’est pas fausse, sur les conséquences de l’attitude allemande sur la Grèce. Mais, en même temps, on voit que cette analyse n’est volontairement pas poussée à ses conclusions logiques.
Contre-feux
On voit donc le jeu de Romano Prodi. Mais, celui de Wolfgang Schäuble n’est pas différent. Le Ministre des finances allemand a compris le risque pour son pays qu’à partir de la crise grecque se mette en place un puissant mouvement vers le fédéralisme au sein de la zone Euro, avec toutes ses implications. Et, de cela, il ne veut, et sur ce point il est en accord parfait tant avec la Chancelière qu’avec le dirigeant du SPD, Sygmar Gabriel, sous aucun prétexte. Ainsi, qu’il s’agisse de Romano Prodi ou de Wolfgang Schäuble, les deux hommes, les deux dirigeants politiques, en sont réduits à allumer des contre-feux. Mais, ce qui est aujourd’hui nouveau, c’est que leurs actions ne peuvent plus être coordonnées. Elles vont se heurter l’une l’autre, et de cette désarticulation stratégique découle une désarticulation politique du projet de l’Euro.
Romano Prodi cherche à éviter ou à ralentir la constitution de ce front des forces anti-euro, front qui monte dans l’opinion comme dans les milieux politiques tant en Italie qu’en Europe. Wolfgang Schäuble, lui, tient à éviter que l’on entre dans une logique d’union de transfert qui serait mortelle pour l’Allemagne. Ainsi, l’un et l’autre affectent de parler de l’Euro et de l’Europe mais, en réalité, pensent dans le cadre national. Quelle meilleur preuve faut-il de la mort de l’Euro, mais aussi de l’échec d’une certaine idée de l’Union européenne ?
[1] Voir Godin R., « Grèce : pourquoi le nouveau plan d’aide est déjà un échec » in
La Tribune, 4 août 2015,
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-pourquoi-le-nouveau-plan-d-aide-est-deja-un-echec-496415.html ou Robin J-P, « Pourquoi le Grexit est plus que jamais d’actualité » in
FigaroVox, 4 août 2015,
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/08/04/31001-20150804ARTFIG00200-pourquoi-le-grexit-est-plus-que-jamais-d-actualite.php
[2] Même un journal qui nous a habitué à des propos très conservateurs sur ce point l’admet. Voir :
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021256452465-le-3e-plan-grec-pas-meilleur-que-les-precedents-1143735.php#xtor=RSS-52
[3] « Greek Debt Disaster: Even If Greece Defaults, German Taxpayers Will Come Out Forward, Says German Assume Tank » in
Observer,
http://www.observerchronicle.com/politics/greek-debt-crisis-even-if-Greece-defauts-German-taxpayers-will-come-out-ahead-says-german-think-tank/58504/
[4] Voir la transcription de sa téléconférence à l’OMFIF ou
Official Monetary and Financial Institutions Forum http://www.omfif.org/media/1122791/omfif-telephone-conversation-between-yanis-varoufakis-norman-lamont-and-david-marsh-16-july-2015.pdf
[5] Prodi R., « L’Europa fermi l’inaccettabile blitz tedesco »,
Il Mesaggero, 8 août 2015,
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/europa_fermi_inaccettabile_blitz_tedesco/notizie/1507018.shtml
[6] Godin R., « Grèce : y a-t-il un vrai désaccord entre Paris et Berlin ? », in
La Tribune, 3 août 2015,
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-y-a-t-il-un-vrai-desaccord-entre-paris-et-berlin-496193.html
Grèce : le retour à la réalité des créanciers ?
Source : Romaric Godin, pour LaTribune, le 11 août 2015.

Le troisième mémorandum semble plus modéré que les deux précédents. (Crédits : © Yannis Behrakis / Reuters)
L’accord sur le troisième mémorandum offre des conditions modérées au gouvernement grec. Les créanciers ont abandonné leurs objectifs budgétaires intenables, mais le risque d’un échec demeure.
Il ne faut certes pas s’y tromper, ce troisième mémorandum qui sera signé entre la Grèce et ses créanciers sera un défi pour son économie difficile à surmonter. Mais le gouvernement d’Alexis Tsipras pourra se vanter d’avoir obtenu des avancées concrètes dans ce mois de négociations qui a suivi la « capitulation » du 13 juillet. Il semble qu’après avoir exhorté avec hauteur les Grecs à « revenir à la réalité » pendant des mois, les créanciers aient, eux-mêmes, été contraints de se réveiller et de prendre conscience que leurs exigences étaient insoutenables et conduisaient la Grèce dans une nouvelle spirale infernale.
Cadre budgétaire assoupli
Les termes de ce troisième mémorandum semblent donc plus raisonnables que ceux des deux précédents. Selon Reuters, le cadre budgétaire fixé est, du moins pour ce qui concerne 2015 et 2016, conforme à la réalité. La Grèce s’engage à ne pas dépasser un déficit primaire (hors service de la dette) de 0,25 % du PIB en 2015 et à dégager un excédent primaire de 0,5 % du PIB en 2016.
Là encore, il ne faut pas s’y tromper : il ne s’agit pas de dégager des marges de manœuvre budgétaire pour le gouvernement hellénique, mais d’adapter les objectifs à l’effondrement de l’économie. Pour 2015, le PIB grec devrait se comprimer de 2,1 % à 2,3 %. Reste qu’après les mesures votées en juillet, notamment les hausses de TVA et les baisses des pensions et des salaires par une augmentation des cotisations retraites, aucune mesure d’austérité supplémentaire ne sera demandée au cours des deux prochaines années. Et c’est un point important pour le premier ministre grec.
Stopper la spirale austérité-récession
Ces objectifs adaptés, permettront en théorie d’éviter de plonger la Grèce dans une nouvelle course aux mesures d’austérité pour atteindre des objectifs irréalistes comme en 2010-2015.
L’expérience européenne montre que la meilleure méthode, pour une économie comme la Grèce, de retrouver la croissance, c’est de stopper l’austérité aveugle. C’est surtout cela que prouvent les exemples portugais et espagnols. La Grèce va donc pouvoir reprendre une bouffée d’air dont elle a bien besoin.
Compte tenu de la situation, les objectifs imposés par l’Eurogroupe d’un excédent primaire de 1% du PIB cette année et de 2% en 2016 n’avaient aucun sens et auraient conduit le pays dans la même logique qu’en 2010-2013, lorsque l’on demandait de « nouveaux efforts » récessifs au gouvernement grec pour atteindre des objectifs fondés sur des prévisions de croissance irréalistes.
Il faut saluer ce fait, assez peu courant ces dernières années : le « quartet » des institutions (Commission, BCE, FMI et MES) a cherché à éviter cette spirale récessive.
Des objectifs encore élevés pour 2017 et 2018
Certes, les objectifs d’excédents primaires sur 2017 et 2018 : 1,75% du PIB et 3,5% du PIB ont été relevés. Ils semblent encore fort irréalistes, mais, en réalité, ces objectifs ressemblent davantage à une opération de communication permettant aux créanciers de ne pas perdre la face. Leur perspective est encore lointaine et, en fonction de l’évolution de la croissance, il sera toujours temps de les réviser à des niveaux appropriés. En tout cas, le couperet de nouvelles mesures d’austérité semble repoussé à un horizon plus lointain et à des temps meilleurs. Là encore, du moins, en théorie.
Une liste de 35 « réformes » difficile à accepter
La liste des 35 mesures prioritaires réclamées par les institutions, selon le journal grec Kathimerini, pose, elle, un vrai problème. L’essentiel de ces mesures est contraire au programme du gouvernement, et ceci pose ouvertement la question de la valeur et du respect de la démocratie grecque. Le gouvernement devra ainsi revenir sur la loi votée le 2 juillet dernier sur le contrat de travail, ce qui prouve le caractère tutélaire du mémorandum sur la Grèce. D’autres sont inquiétantes (préparer des économies de 0,5% du PIB du système de protection sociale). la plupart représentent les recettes habituelles des créanciers en termes de libéralisations et de privatisations (dérégulation du marché du gaz en 2018, suppression des subventions pour les agriculteurs et ouverture du marché des médicaments), qui sont autant de pilules amères pour Athènes. D’autres, enfin, moins nombreuses, peuvent très bien être acceptées par Syriza (amélioration des recettes fiscales, réduction de la bureaucratie, suppression de certaines professions réglementées).
Cette liste sera difficile à faire accepter par la gauche de Syriza, mais Alexis Tsipras pourra insister sur son caractère non austéritaire a priori. D’autant que le gouvernement a obtenu que le forfait hospitalier de 5 euros ne soit pas rétabli.
La recapitalisation bancaire accélérée, sans contribution des déposants
Les banques grecques devront rapidement être renflouées à hauteur de 10 milliards d’euros pour éviter toute contribution des déposants, comme cela est prévu par l’union bancaire à partir de janvier 2016. C’est un élément important qui ne pénalisera pas les consommateurs et favorisera le retour des dépôts dans les banques, même si la questions des créances douteuses n’est pas encore réglée.
Quant au fonds de privatisation appelé Taiped, il a été convenu qu’il n’y aura pas de ventes d’actifs rapides et à moindre coût. C’est là aussi un élément que réclamait le gouvernement grec.
Une victoire tardive d’Alexis Tsipras ?
Reste que cet accord peut apparaître comme une victoire tardive d’Alexis Tsipras. Il ne manquera, du reste, pas de l’avancer comme un argument lorsque le texte passera devant la Vouli, le parlement grec, jeudi. D’ores et déjà, le ministère des Finances souligne que les mesures demandées sont les mêmes que le 25 juin, lorsque les créanciers proposait un financement de 5 mois de 7 milliards d’euros. Cette fois, ce sera 85 milliards d’euros sur trois ans.
Certes, les concessions qu’a dû accepter le gouvernement sont considérables, tant en matières de réformes qu’en matière de mesures récessives votées en juillet. Mais le Premier ministre pourra proclamer que la politique d’austérité s’est achevée avec les textes votés en juillet et que ceci est le fruit de la capacité de négociation de son gouvernement. Il pourra prétendre avoir obtenu le meilleur accord possible avec les créanciers, ce qui, après tout, était son objectif le 25 janvier dernier lorsque les électeurs grecs lui ont confié le pouvoir.
De nouvelles élections ?
Avec un tel accord, qui améliore singulièrement celui du 13 juillet, Alexis Tsipras semble ne rien avoir à craindre. Si la plateforme de gauche, l’opposition interne à Syriza, décide de rejeter le texte, il pourra en appeler à de nouvelles élections, qui seraient organisées, selon la presse grecque, les 13 ou 20 septembre prochains. L’aspect rassurant du troisième mémorandum et l’absence d’une opposition organisée et proposant des alternatives lui assurera sans doute une large majorité. A moins que l’opposition à l’euro, qui monte, ne se cristallise autour de la plateforme de gauche désormais indépendante.
Ce scrutin lui permettrait aussi d’exclure son opposition de gauche des listes de Syriza. Aussi, désormais, la situation de cette opposition est difficile : elle est menacée de disparaître de la Vouli si elle maintient une position d’opposition au gouvernement.
Mise à nu de l’irréalisme des créanciers durant les négociations
Du côté des créanciers, ce « retour à la réalité » est assez douloureux. Il prouve que les demandes de l’Eurogroupe, notamment en termes budgétaires, durant l’essentiel des négociations étaient irréalistes. Il prouve aussi que la volonté de « faire un exemple » en châtiant Syriza de sa témérité de vouloir secouer le dogme de l’austérité a mené non seulement la Grèce, mais leur propre logique dans le mur. La décision de la BCE d’utiliser le système bancaire comme un moyen de pression sur le gouvernement grec a conduit l’économie hellénique au chaos. Et ce chaos n’a pas conduit, comme les créanciers l’espéraient sans doute, à un changement de majorité, mais a conduit à mettre en avant la caducité de leurs exigences.
L’abandon de l’objectif politique
Ce 11 août marque donc une victoire importante pour Syriza et Alexis Tsipras. D’abord, l’abandon par les créanciers de la logique de la « consolidation fiscale source de croissance » qui avait conduit à minimiser les multiplicateurs budgétaires et à faire entrer les pays périphériques dans des spirales infernales. Et s’ils ont renoncé à pousser plus avant leurs exigences, c’est aussi parce qu’ils ont renoncé à leur objectif politique de changer la majorité politique en Grèce. Ils ont compris qu’en cherchant à s’imposer contre la démocratie grecque, ils risquaient, à plus ou moins long terme de conduire la Grèce à sortir de l’euro. Déjà, un récent sondage réalisé après l’accord du 13 juillet signalait un moindre attachement à la monnaie unique. Cet accord prouve donc que, malgré les rodomontades de Wolfgang Schäuble, les créanciers craignent bel et bien le Grexit. En tout cas, ce mardi, ils ont fait clairement le choix de tenter de l’éviter.
Pas de succès sans investissement, ni restructuration de la dette
Y parviendront-ils ? Ces conditions modérées sont une avancée, mais il convient de demeurer prudent. Rien ne dit que ce sera suffisant pour redresser un pays doublement atteint par l’austérité des années 2010-2014 et par la politique suicidaire de la BCE durant le premier semestre 2015. Les objectifs budgétaires sont de simples adaptations. ils peuvent, malgré leur caractère réduit, devenir des pièges si la croissance demeure plus faible que prévu. Si tel est le cas, les créanciers devront adapter à nouveau leurs demandes plutôt que de demander de nouvelles coupes. Mais le gouvernement d’Alexis Tsipras n’est pas encore entièrement libéré de ce piège.
Par ailleurs, la refonte du système bancaire sera un premier élément clé de cette reprise. Mais, ce troisième mémorandum ne sera un succès qu’à deux conditions. D’abord, la prise en compte de la situation réelle de l’économie grecque et donc du besoin de reconstruction. D’où la nécessité d’un vrai et ambitieux programme d’investissement européen. Ensuite, la reconnaissance que, sans restructuration d’envergure de la dette grecque, ce nouveau plan, qui n’est que la poursuite de la cavalerie financière de 2010, sera un échec en faisant peser dans les décennies à venir un fardeau intenable sur l’économie hellénique. C’est le dernier retour à la réalité que les créanciers doivent accepter. Les négociations sur ce point en novembre s’annoncent donc essentielles.
Reste un problème : le financement de ce plan de 85 milliards d’euros n’est pas bouclé. Le MES ne devrait apporter que 50 milliards d’euros. Le FMI n’apportera sans doute pas les 32 milliards d’euros restants. Si on compte sur le plan de privatisations pour combler ce financement, on entrerait dans une logique de vente rapide à prix bradés des actifs de l’Etat qui serait contre-productif.
Le mystère allemand
Mais, en novembre, comme aujourd’hui, un obstacle de taille s’élève devant la Grèce et Alexis Tsipras : celui de l’Allemagne. Le gouvernement fédéral allemand acceptera-t-il ces conditions modérées et ce retour à la réalité qui est une défaite idéologique pour son ministre des Finances ? Rien n’est moins sûr. Or, cet accord du 11 août ne sera valide que lorsque le directoire du MES l’aura validé. Dans ce directoire, l’Allemagne dispose d’un veto de fait et son représentant ne prend sa décision qu’après le vote du Bundestag. Berlin pourrait donc être tentée de faire monter les enchères et de « négocier » cet accord contre un renforcement de la surveillance budgétaire dans la zone euro, par exemple, qui est désormais un objectif clairement affiché par le camp Schäuble. Du reste, la commission européenne affirmait ce mardi que l’accord n’était que “technique” et qu’il n’y avait pas d’accord “polittique”. Les conséquences de l’affaire grecque pour l’Europe ne sont donc pas terminées.