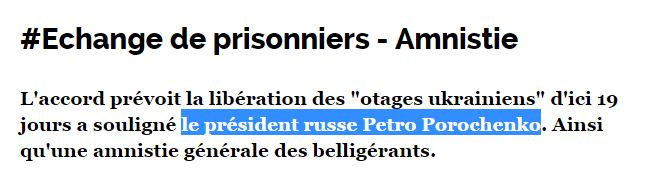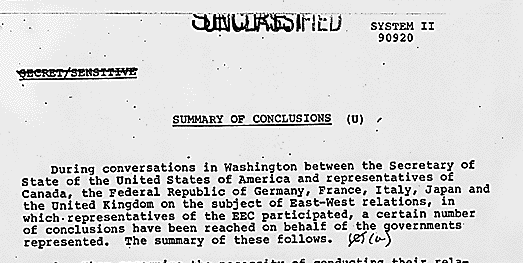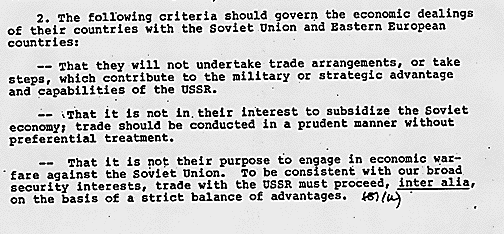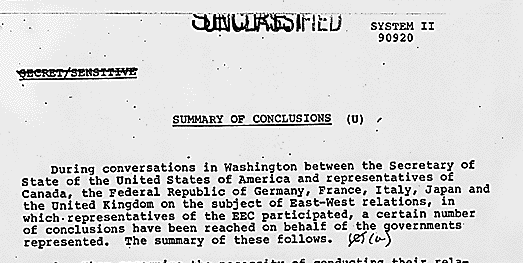Papier juridique suisse très fouillé. Je vous recommande de lire le début sur les sanctions économiques, l’affaire du gazoduc en 1982 et surtout la partie sur la Crimée…
Vous êtes forts les Suisses ! 
Par Arnaud Dotézac, paru dans la revue Market, Genève, numéro 118, septembre-octobre 2014.
Tout le monde sait que l’efficience des sanctions économiques contre la Russie est incertaine. Dans le cas de la Suisse, son évaluation n’est même pas proposée, bien que des effets boomerang sévères puissent apparaître, notamment dans le secteur du trading pétrolier de Genève. On connaît l’effet d’entraînement que l’arrivée de Lukoil a créé dans ce secteur et ce que son départ signifierait. Cette absence de pesée des intérêts est un mode de gouvernement en soi inhabituel, sauf à ce que des enjeux non dévoilés motivent cette décision.
En parallèle, les aspects normatifs restent à l’écart du débat. Les choses iraient-elles de soi, dans une sorte d’impensé collectif ? Ce n’est pas notre sentiment et si la solidité légale des sanctions helvétiques était seulement de façade, alors oui, il y aurait quelque chose d’inepte à les avoir prises. La Suisse s’est donc ralliée aux sanctions économiques américano-européennes contre des citoyens russes ad hominem et contre des intérêts économiques stratégiques de leur pays et ce, dès le 2 avril 2014. Elle l’a fait presque l’air de rien. Son message n’était pas celui de la punition directe et offensante, à l’instar de ses « partenaires commerciaux », mais celui de la sanctuarisation du territoire helvétique. Sa motivation officielle est en effet d’éviter que le pays ne devienne un espace de « contournement » de ces mesures punitives édictées par d’autres, qu’il ne soit pas le refuge de tous les « Sanctionnés de la Terre ». On en serait presque à se retrouver dans un discours de pure neutralité. Pourtant, à y regarder de près, c’est exactement le contraire qui est à l’œuvre.
Gardons à l’esprit que les sanctions internationales non militaires[1] ne sont pas des verdicts judiciaires mais des décisions gouvernementales, qui matérialisent donc des choix politiques. Contrairement à une méprise fréquente, le fait d’être sanctionné par un État ou un groupe d’États, ne repose sur aucune procédure ou condamnation pénale préalable, c’est-à-dire sur aucun crime ou délit qui soit judiciairement avéré. Ces mesures ne « sanctionnent » donc pas des faits punissables selon le droit commun, mais plutôt une relation politique entre États. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une même situation sera traitée différemment selon la nature des relations choisies entre deux ou plusieurs Etats.
On a vu ce double standard fonctionner pour le Kosovo, une province arrachée à la Serbie sans même un vote populaire et que Berne s’était empressée de reconnaître comme Etat souverain. Il ne s’agit pas ici de contester le choix de Berne mais simplement de rappeler que le double standard est possible en droit international public.
Le double standard est possible en droit international public
Tout l’édifice de ce droit a ceci de particulier qu’il n’est pas construit par une autorité législative supérieure mais qu’il repose sur le principe essentiel de sa libre appréciation par chaque État souverain. Chaque Etat apprécie pour lui-même sa situation juridique à l’égard des autres Etats et chaque interprétation étatique est aussi licite qu’une autre. En pratique, aucun État n’est lié juridiquement par la position d’un autre État, sauf par la voie de l’accord volontaire qu’est le traité ou l’adhésion à une organisation internationale, ou encore par le consensus explicite.
Ceci nous amène à la nature de la sanction. Dès lors qu’un État censeur en sanctionne un autre, il rompt symboliquement cette égalité de souveraineté, qui est pourtant protégée par le principe d’immunité de juridiction des Etats agissant dans leur souveraineté. Dans le fait même de punir, le censeur se déplace donc mécaniquement au-dessus de l’Etat puni, il s’attribue une autorité supérieure, quasi-judiciaire, puisque d’une part, il trace la frontière entre ce qui est fautif et ce qui ne l’est pas et que d’autre part, il apprécie seul l’opportunité de la sanction, son calendrier et son intensité. Le discours politique passe alors au registre du dominant-dominé avec tous les ingrédients de la belligérance qui s’y trouvent. C’est ce que fait la Suisse à l’égard de la Russie.
Pour oser cette rupture d’égalité, le censeur doit pourtant disposer d’une plus grande puissance économique et/ou militaire que l’Etat puni, faute de quoi il pourrait se retrouver à devoir subir des représailles à la mesure du différentiel de puissance. C’est en cela que les mesures restrictives traduisent toujours l’affirmation d’un rapport de force[2]. Le premier constat qui s’impose est que la Suisse s’est placé dans un rapport de force défavorable avec la Russie. 1) les sanctions comme rapport de force Pour nous convaincre de ce rapport de force, comparons l’effet que produirait un ukase annoncé en grande pompe par l’île de Tobago[3] à l’encontre des Etats-Unis, avec l’effet que provoquerait la décision réciproque des Etats-Unis, à l’encontre de Tobago. Pas besoin d’aller plus loin.
Lord Ellenborough, célèbre juge anglais contemporain de Napoléon 1er, s’en amusait déjà en ces termes : « Can the island of Tobago pass a law to bind the rights of the whole world? Would the world submit to such an assumed jurisdiction? [4]». Inutile de préciser que, même s’ils sont aujourd’hui rattrapés par l’Union européenne, les États-Unis furent les champions toutes catégories dans ce domaine. Durant les deux mandats de Bill Clinton, ils auront mis en œuvre près de la moitié de leurs 170 procédures de sanctions décidées au cours du XXè siècle.
Cette « culture de la rétorsion[5] » dans les relations internationales remonte à la présidence de Woodrow Wilson (1913 à 1921). Ce dernier voyait dans l’embargo, le boycott et la mise au ban des nations déviantes (rogue states, déjà), la panacée du règlement des conflits. Pour lui, « une nation qui est boycottée est une nation sur le point de capituler. Appliquez ce remède économique, pacifique, silencieux et meurtrier et il ne sera pas nécessaire de recourir à la force ». Dans l’idéalisme wilsonien, les États-Unis conservaient néanmoins leur position dominante. Au nom du modèle américain de la démocratie et des vertus du capitalisme, ils étaient les vecteurs et les garants d’une propagation « sécurisée » de cette démocratie américaine dans le monde[6]. Un schéma qui semble toujours en vigueur dans la doxa diplomatique actuelle.
Les choses ont-elles fonctionné comme il le prévoyait ? La réponse est non. La recette de l’embargo s’avéra beaucoup moins efficace que Wilson ne l’espérait. On sait bien aujourd’hui que la mise sous embargo d’un État n’annonce pas l’imminence de sa capitulation (cf. Iran, Cuba, Corée du Nord et aujourd’hui la Russie) ; que l’embargo n’évacue pas davantage l’usage de la force, mais qu’il en est au contraire le prélude assuré (Ex-Yougoslavie, Irak, Haïti, Libye, Syrie, Russie ?) ; qu’enfin, sa mise en œuvre à géométrie variable (double standard) et son incompatibilité intrinsèque avec les principes fondamentaux du droit international et des droits de l’Homme, en ont fait un instrument qui exacerbe les tensions plus qu’il ne les apaise[7].
Les sanctions actuelles adoptées contre la Russie n’échappent pas à la règle. Les dernières mesures des 11 et 12 septembre 2014 qui attaquent notamment les plus grosses banques russes ainsi que les capacités de développement du secteur énergétique, créent de facto les conditions d’un conflit majeur et frontal avec la Russie. Les américains, les européens, et la Suisse avec eux, savent très bien que les Russes ne se convertiront pas à un modèle imposé de l’étranger, même au titre de la plus extrême menace militaire. Par conséquent, le but officiel des sanctions, qui est de modifier un comportement allégué comme déviant, n’est qu’une façade. Le véritable objectif est ailleurs. Dans quel scenario catastrophe la Suisse s’est-elle ainsi trouvé un rôle ? La déstabilisation avéré et reconnue de l’Ukraine, par Washington et quelques capitales européennes, dès 2013 (sans parler des Révolutions Orange), n’en est que l’avant-goût.
Les sanctions créent de facto les conditions d’un conflit majeur et frontal avec la Russie.
Cette situation rappelle d’ailleurs à beaucoup d’égards la stratégie qui fut déjà adoptée par Ronald Reagan en 1981, dans l’affaire dite du « gazoduc euro-sibérien ». Sauf qu’à l’époque, l’Europe s’était opposée très fermement à Washington. Un épisode qui mérite d’être rappelé (cf. Focus1 : Affaire du Ggazoduc euro-sibérien)
———– [Focus 1] Affaire du gazoduc euro-sibérien (1981-1982)
Dès 1980, la France et la RFA ouvrent des négociations visant à doubler la fourniture de gaz soviétique à l’Europe, depuis le gisement d’Ourengoï en Sibérie. Informés, les États-Unis expriment leur réticence, refusant une dépendance énergétique trop forte de l’Europe vis-à-vis de Moscou, trop de transferts technologiques et par-dessus tout l’enrichissement de l’URSS. Le secrétaire d’État Alexander Haig résuma ainsi l’équation : « pas question que l’Europe subventionne l’économie de l’URSS alors que les États-Unis dépensent des milliards de dollars en armement pour se protéger de la menace soviétique [8]». Les premiers contrats sont néanmoins signés en octobre 1981, incluant la participation de l’Europe à la construction du gazoduc. Une vingtaine de sociétés européennes, dont 13 filiales de sociétés américaines, participent à ce consortium.
À la suite de l’instauration de la loi martiale en Pologne, Ronald Reagan décrète des sanctions économiques contre l’URSS le 13 décembre 1981, qui interdisent notamment aux sociétés américaines de réexporter vers l’URSS la technologie américaine liée au secteur énergétique, lorsqu’elle était destinée à un pays tiers. C’est l’asphyxie graduelle des relations énergétiques euro-soviétiques qui est en réalité planifiée, comme le révéla Roger Robinson, un jeune banquier de la Chase Manhattan, déjà actif en URSS, et travaillant pour la CIA[9] . On se croirait en 2014, sauf que là, la CEE s’opposa vertement aux sanctions américaines !
En janvier 1982, Français et Allemands signent avec Soyouz gaz, malgré les très fortes pressions US. Le 18 mars, un émissaire américain exige de la France « la suppression de toute subvention de crédits à l’exportation à destination de l’URSS et la suspension de toute garantie publique aux crédits accordés à ce pays ». Le 14 mai, François Mitterrand déclare à Hambourg devant un parterre d’industriels : « Nous ne sommes pas en guerre [contre l’URSS] ; le blocus économique est un acte de guerre [souligné par nous] qui, d’ailleurs, ne réussit jamais, sauf s’il représente la première phase d’une guerre gagnée ; isolé, il n’a pas de sens[10] ». Le 18 juin 1982, Reagan décrète cette fois l’embargo total contre l’URSS sur le secteur gaz-pétrole, y compris pour les sociétés étrangères travaillant sous licence US. Les sanctions sont qualifiées de « vexatoires, injustes et dangereuses » et attentatoires au principe de «souveraineté», par François Mitterrand.
Le 29 juin 1982, le Conseil européen déclare que : « le maintien d’un système ouvert de commerce mondial serait gravement compromis par des décisions unilatérales, avec effet rétroactif [et] par des tentatives d’exercer une compétence juridique extraterritoriale (…) ». Non seulement les Dix refusent d’appliquer les sanctions, au nom de leur souveraineté, mais ils adoptent des contre-mesures draconiennes, allant de la réquisition pure et simple du matériel destiné à l’URSS, jusqu’à des poursuites pénales contre ceux qui appliqueraient les sanctions américaines.
Les États-Unis réagissent à leur tour en révoquant toutes les licences d’exportation, notamment de Dresser-France, de Creusot-Loire et de leurs filiales. Finalement, des inconvénients économiques se font sentir aux États-Unis mêmes, où les initiatives de Reagan apparaissent plus comme des sanctions contre l’Europe que contre l’URSS. Prenant prétexte de la libération de Lech Walesa en Pologne, Reagan lève les sanctions le 13 novembre 1982 et rétablit les licences. Cette affaire illustre l’étendue des territoires perdus de la souveraineté depuis 30 ans. [fin du texte du focus 1]

Illustration1 : Ronald Reagan au Congrès du G7 à Versailles, 4-6 juin 1982.
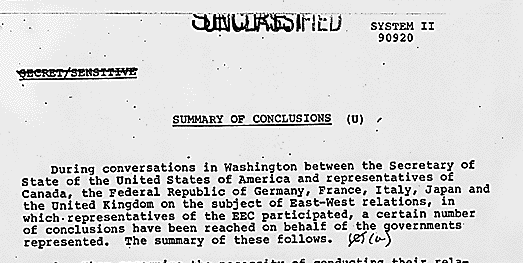
Archives MB1
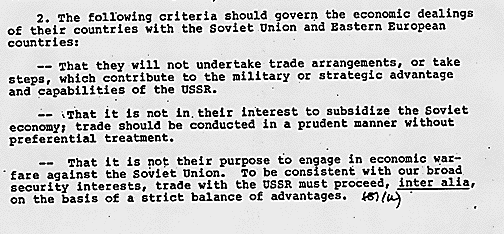
Archives MB2
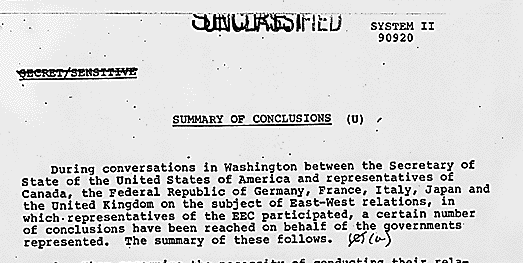
Archives MB1
Illustration 2 : Un exemple de pression sur l’Europe : l’organisation de la tutelle américaine imposée sur les relations commerciales Est/Ouest. Fac-similé de la « National Security Decision Directive 66 », édictée par Ronald Reagan le 29 novembre 1982, source : archives déclassifiées de la Maison Blanche.]
———
Cette culture, qui devient à présent celle de la provocation, est-elle bien conforme au modèle helvétique ? Rien n’est moins sûr. Elle a effectivement comme un goût d’ailleurs, loin de la neutralité bienveillante qui caractérisait la Confédération, spécialement depuis que l’empereur de Russie Alexandre 1er avait su l’imposer en faveur des Suisses, il y a exactement 200 ans. Un bicentenaire qu’on aurait dû fêter dans la bonne humeur et l’affabilité culturelle mais qui fut entaché d’humiliations à courte vue. Nous pensons notamment à la révocation sine die de la visite de Sergueï Narychkine, président de la Douma (chambre basse du parlement russe), par son collègue Ruedi Lustenberger du Conseil national. Une révocation doublée d’une dérobade, en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucun débat, d’aucune explication, sauf la béance du parti pris[11].
On oublie trop souvent que c’est justement pour éviter de tomber dans un tel piège que les autorités helvétiques avaient décliné l’adhésion de la Confédération à l’ONU en 1945. Elles savaient que sa participation aux sanctions économiques était incompatible avec sa politique de neutralité. Et puis on a commandé des consultations académiques expliquant que la neutralité n’avait de sens qu’en rapport avec des conflits armés, qu’il était donc loisible de s’en départir s’agissant des mesures restrictives. On voit qu’en réalité les conflits armés (chauds) et économiques (froids) sont inséparables.
Mais les sanctions ne visent pas seulement les Etats, elles s’appliquent aussi à des individus. Elles ont droit à l’euphémisme de « smart sanctions », sans doute parce que ce sont ceux qui les infligent qui sont « smart » ? 2) Les smart sanctions L’écart de PIB entre les pays censeurs et leurs cibles est le plus souvent abyssal, de sorte que les populations des pays visés peuvent en souffrir de manière indiscriminée. L’embargo contre l’Irak, dès 1990, sera l’occasion de prendre en compte l’impact humanitaire collatéral de ces mesures. Devant les protestations des organisations humanitaires, les pressions des milieux économiques affectés, les avis de droit, jugements et autres résolutions de l’ONU, les Etats-Unis se décideront à rationaliser l’usage des sanctions générales en leur substituant des mesures ciblées sur les dirigeants des pays ou des organisations en cause (mafieuses ou terroristes) et leurs réseaux d’influence.
Dès le 13 avril 1995, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité adresseront une lettre à son président, lui demandant de systématiser le volet humanitaire dans les sanctions prononcées par l’ONU. C’est dans ce contexte que le concept de « smart sanctions » va naître officiellement et revenir en boucle dans des dizaines de rapports, articles et conférences, utilisant toutes les caisses de résonnance offertes à la sphère de communication américaine. La Suisse n’échappera pas à ce mouvement, qui se traduira par l’organisation du « Processus d’Interlaken » et dont le résultat sera l’adoption de la loi sur les embargos de mars 2002. Un texte dont on voit, avec le recul, qu’il fut taillé sur mesure pour entrainer la Suisse dans une application quasi automatique des sanctions américaines. (Cf. Focus 2 : Lois sur les embargos en fin d’article)
En pratique, on dresse des listes noires d’individus qui, sans procès préalable, verront leurs avoirs gelés, leur droit à opérer des transactions refusé, ou encore leurs déplacements interdits. Ils ne bénéficieront d’aucune des protections habituelles des procédures pénales de droit commun. Et comme si cela ne suffisait pas, la norme qui les incrimine sera fatalement promulguée après les faits reprochés, c’est-à-dire qu’on fera une application rétroactive d’une incrimination d’ordre pénal, ce qui est une régression phénoménale de l’Etat de droit[12]. En plus d’une présomption d’innocence renversée et d’une infamie publique assurée, les « blacklistés », se retrouveront le plus souvent punis du simple fait d’avoir une relation avec une personne exposée, une fonction publique ou privée influente, ou seulement soupçonnés, à tort ou à raison, de les avoir. C’est-à-dire qu’ils seront chargés d’une responsabilité pénale du fait d’autrui, cette fameuse « responsabilité collective », que l’on pensait « bannie de la théorie pénale continentale depuis le siècle des Lumières », selon la formule de la professeure Ursula Cassani[13].
Autre régression extraordinaire de l’Etat de droit. Voici donc comment fonctionne ce « droit smart » : sur la base de simples soupçons, le plus souvent non étayés, afin de ne pas dévoiler des sources issues de la communauté du renseignement, des droits fondamentaux garantis par de solides conventions internationales[14], des constitutions et des lois nationales, vont être déniés à des individus qui pourraient être totalement innocents. Très peu de différence en fait avec les lettres de cachet de l’Ancien régime français, qui permettaient d’embastiller quiconque, sans autre forme de procès qu’une signature du roi en bas d’une feuille de papier. Quant aux agents économiques qui s’approcheraient trop près d’eux, c’est le pénal assuré, sans compter les amendes aussi arbitraires qu’exorbitantes infligées directement par l’administration américaine, sans procès.
La CEDH a déjà condamné la Suisse pour ses sanctions
Le Conseil des droits de l’Homme s’insurge régulièrement contre cette pratique qu’il juge parfaitement illégale[15]. Il estime que les toilettages mineurs opérés au Conseil de sécurité comme la création d’un comité chargé d’enregistrer des demandes de radiation des listes noires ou les exemptions éventuelles destinées à couvrir des besoins de base (santé, religion), sont insuffisants. Quant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, elle a déjà condamné des Etats pratiquant les « smart sanctions », en particulier la Suisse. 3) La place de la Suisse dans le concert des sanctions
Comme on l’a dit en introduction, la Suisse ne veut pas apparaître comme un Etat censeur de son propre chef. Elle veut simplement éviter les « contournements ». Cela étant, elle condamne fermement le rattachement de la Crimée à la Russie, qu’elle considère comme une violation grave du droit international. C’est là le fondement juridique interne de son ralliement aux sanctions internationales. Mais si ni l’argument du contournement ni celui de l’illégalité de l’annexion de la Crimée ne s’avéraient corrects, alors les sanctions seraient illicites au regard de l’ordre juridique suisse.
a) L’argument du « contournement »
En général on parle de contournement d’une loi lorsque les destinataires de cette loi organisent l’altération d’un rapport de droit, dans le seul but d’échapper à l’application de cette loi, estimée contraire à leurs intérêts privés. Il s’agit en réalité de la classique fraude à la loi, contre laquelle le législateur va se prémunir par la dissuasion grâce à des dispositions complémentaires. Le cas typique est celui de l’évasion fiscale, contre laquelle on dressera tout un arsenal anti-évasion, anti-blanchiment, anti-corruption, etc. Seulement voilà, l’État qui légifère pour dissuader du contournement d’une norme est toujours celui-là même qui a produit cette norme dans son ordre juridique interne, à l’intérieur de son territoire national.
Ce n’est pas la vocation d’un Etat tiers de prendre en charge une telle dissuasion relevant d’une autre souveraineté. A moins que les deux Etats aient organisé une collaboration internationale à cet effet, via un traité entre eux. Mais s’agissant des sanctions contre les Russes, il n’existe aucun traité obligeant la Suisse à s’aligner sur Bruxelles et Washington. Pas même une infime trace de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui leur eût donné un brin de force obligatoire internationale. Alors pourquoi la Suisse se retrouve-elle subjuguée dans cette obligation du non-contournement ? Cela ne peut signifier que deux choses, qui ne sont pas rassurantes:
- soit le Conseil fédéral s’est subordonné spontanément aux décisions d’Etats souverains et leur a donc abandonné la part correspondante de la souveraineté helvétique, ce qui lui est interdit,
- soit il a mis en œuvre des accords occultes, ce qui l’est tout autant.
Pourtant, à y regarder de près, le Conseil fédéral semble bien s’être déterminé en fonction de ces deux aspects.
On peut le vérifier simplement: si la Suisse avait adhéré à l’Union Européenne, il n’y aurait pas eu de grande différence de contenu avec les sanctions actuelles prises par Berne. Dans ce qui distingue la position helvétique, on peut certes observer l’escamotage du gel des avoirs des personnes et entités « blacklistées », la Suisse se contentant d’une interdiction d’ouvrir de nouvelles relations d’affaires avec ces dernières. Pour autant, il est admis que ce n’est pas le Conseil fédéral qui a élaboré la liste noire (sa nomenclature est un copié collé des documents américains). Ce n’est pas lui non plus qui a arrêté les incriminations associés aux noms, sensées justifier leur présence sur la liste noire. Si c’était lui qui avait été à l’origine de la liste noire, il n’aurait pas manqué de s’interdire l’ajout de certaines personnes. Il s’avère en effet que certaines incriminations ne relèvent pas tant d’un acte potentiellement illicite selon la norme américaine, mais de l’exercice d’un droit protégé selon la norme suisse.
Prenons le cas de monsieur Sergei Mironov, qui est donc puni personnellement par le Conseil fédéral, alors que ce dernier n’avait sans doute jamais entendu parler de lui auparavant. Il est député d’opposition de la Douma. Comme tel, il a soumis un projet de loi autorisant l’ajout de nouveaux Etats au sein de la Fédération de Russie, dans la perspective de protéger des populations russes. Si on se rapporte à notre Constitution fédérale, nous lisons que son article 8 al.2 l’aurait protégé en ces termes : « nul ne doit subir de discrimination du fait notamment (…) de ses convictions politiques (…) ». L’article 16 lui aurait garanti la liberté d’opinion et le droit de la former, de l’exprimer et de la répandre librement. Enfin l’article 162 lui aurait garanti l’immunité de parole et d’opinion du parlementaire, comme c’est toujours le cas dans un Etat de droit, notamment au titre de la séparation des pouvoirs.
Le Conseil fédéral s’autorise donc à promulguer une norme restrictive (les ordonnances de sanction ont valeur législative) extraterritoriale, ce qui est en soi une ingérence illicite dans les affaires intérieures russes et en outre en totale violation du cadre constitutionnel dans lequel il est tenu d’exercer son mandat démocratique. La loi sur les embargos a-t-elle vocation à conférer des pouvoirs anticonstitutionnels au Conseil fédéral ? Ce n’est pas l’avis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a déjà condamné la Suisse à cet égard, notamment par son arrêt du 12 septembre 2012 (Aff. Nada). Alors même que Berne arguait de son obligation à mettre en œuvre ces sanctions du fait qu’il s’agissait d’une résolution contraignante du Conseil de sécurité, la Cour a fait prévaloir la protection de la Convention sur cette résolution. Elle a condamné une violation des articles 8 (atteinte au respect de la vie privée et familiale, à l’honneur et la réputation) et 13 (absence de recours effectif).
Il est clair que la légalité des sanctions suisses autonomes est encore plus contestable et que les messages politiques du Conseil fédéral voilent sciemment cette réalité. Mais l’argument du contournement présente aussi une difficulté majeure sur le terrain de la neutralité. Qu’aurait fait notre Conseil fédéral durant la 2ème Guerre mondiale ? Qu’aurait signifié le fait d’appliquer des mesures de contrainte pour éviter que celles, quasiment identiques, prises par nos voisins en guerre, ne soient « contournées » sur notre territoire ? N’eut-ce pas été par définition un acte de guerre ? La mise en œuvre des mesures restrictives économiques de l’Union Européenne par la Suisse révèle ici, en creux, une négation essentielle du droit de neutralité en cas de conflit armé. Et comme déjà indiqué plus haut, il devient de plus en plus difficile de faire la part de l’économique et du militaire sur le terrain ukrainien. Nul ne peut soutenir sérieusement que la recherche d’un affaiblissement économique de la Russie, essentiellement par les membres de l’OTAN, est totalement étanche et distincte par nature, du soutien militaire et policier apporté par ces derniers au régime de Kiev.
La frontière étant si floue, soit on se retire du jeu, soit on assume d’en faire partie. En toute hypothèse, il est patent que le Conseil fédéral transpose les « mesures restrictives » de Bruxelles comme il le ferait s’il s’agissait d’une directive européenne, c’est-à-dire qu’il internalise ici le principe de primauté du droit européen. Pourquoi ? Le Conseil fédéral ne pouvait-il pas prendre ses propres sanctions de manière vraiment autonome ? Ou au contraire, ne pouvait-il pas résister aux sanctions étrangères au nom du droit de neutralité, comme l’a fait l’Europe dans l’affaire du gazoduc euro-sibérien ? Aurait-on fait pression sur la Suisse ? Mais qui ? Quand ? En quels termes ? Sur quelles bases légales, voire… sous la menace de quel rapport de force ?
Le Conseil fédéral n’aurait évidemment pas le droit de rester muet à ce sujet puisqu’il est garant de l’indépendance du pays (articles 54 et 185 de la Constitution fédérale). Il n’est pas non plus imaginable qu’une pression ait pu être exercée pour le contraindre à conclure un accord occulte. On sait qu’une telle ingérence est prohibée et que les principaux « partenaires commerciaux » de la Suisse devraient être par nature respectueux de ce principe puisque c’est, entre autres griefs allégués, à cause de son irrespect par la Russie qu’eux, et la Suisse, disent vouloir la châtier. Un principe qu’on ne résiste pas au plaisir de relire dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée Générale des Nations Unies : « aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ».
Mais un principe à double tranchant si l’on apprenait que la poudrière ukrainienne fut orchestrée par les censeurs actuels, dès l’hiver 2013, voire avant, ce qui semble avéré à certains égards, faisant de la Suisse leur complice en l’embarquant ainsi dans leurs sanctions. Que dire au final de cet argument du contournement ? Qu’il s’agit d’un excellent révélateur ! Car derrière l’apparence de sa simplicité confinant au bon sens, il se cache à l’évidence des tractations complexes avec à la clé une intégration organique, c’est-à-dire subordonnée, de la Suisse à l’Union européenne, ainsi qu’une mise aux normes de la politique étrangère américaine. Il ne resterait alors de vraiment solide que « la violation du droit international lors de l’annexion de la Crimée », à propos de laquelle « nous ne partageons pas du tout la position de la Russie » disait le président Didier Burkhalter, interviewé le 10 septembre 2014 par Darius Rochebin, sur la RTS.
b) La violation du droit international du fait du rattachement de la Crimée à la Russie
Comme on l’a vu plus haut, une affirmation péremptoire de violation du droit international n’est jamais rien d’autre qu’une allégation politique et non l’expression d’une décision judiciaire indépendante. Le président de la Confédération n’a donc pas tort lorsqu’il rapporte une violation du droit international mais ses opposants non plus. Ce faisant, notre gouvernement prend fermement parti, alors qu’il pourrait créer, fidèle à la vocation de la Suisse, l’espace neutre au sein duquel le contentieux pourrait se purger. Mais c’est d’ores et déjà impossible puisque cet espace est saturé de la thèse officielle.
– La thèse officielle Lorsque l’Ukraine est devenue indépendante en décembre 1991, la Crimée faisait partie de son territoire. En vertu du principe d’uti possidetis[16], les frontières administratives intérieures d’un Etat fédéré qui se sépare de sa fédération d’appartenance, deviennent automatiquement les frontières de l’Etat souverain nouvellement formé. La Crimée n’ayant que le statut de région à l’intérieur de l’ancienne république fédérative d’Ukraine, elle faisait donc partie intégrante de l’Ukraine dès l’indépendance de ce pays. A cela s’ajoute que la Fédération de Russie, nouvellement formée, elle aussi, a reconnu à maintes reprises l’existence de ces frontières et l’intégrité du territoire ukrainien, Crimée incluse, par voie de déclarations autant que de traités.
Sur la validité du référendum d’autodétermination de la Crimée de mars 2014, qui sera l’étape préalable essentielle à sa demande de rattachement à la Fédération de Russie, les experts ont également une position on ne peut plus claire. Le droit à l’autodétermination ne prévaut pas sur la souveraineté étatique et ne permet pas de libre sécession, faute de quoi ce serait un blanc-seing à des recompositions incessantes, d’espaces et de frontières, et la source de tous les conflits qui iraient de pair avec cette instabilité permanente.
[OB : note en passant. C'est certes un cas complexe, mais enfin, il est clair que les conflits naissent JUSTEMENT quand on ne reconnait pas ce droit, cf Ukraine, Catalogne, etc. Je vois mal comment un conflit pourrait naître de votes démocratiques...]
Les rares cas où la sécession peut s’envisager sont le respect d’une procédure constitutionnelle interne au pays, qui dès lors l’autoriserait, comme cela aurait pu se produire pour l’Ecosse à l’égard du Royaume Uni. Il peut également s’agir de l’émancipation des peuples colonisés (dits « non autonomes ») qui ont fait l’objet d’un statut particulier. Et enfin, la « sécession remède », lorsqu’une minorité est opprimée à tel point qu’il ne reste que cette solution, ce qui correspondrait au cas du Kosovo. Et les experts de conclure que la Crimée ne répond à aucun de ces critères. Toutes ces analyses ont en commun de fixer leur axe à la date de déclaration d’indépendance de l’Ukraine : le 1er décembre 1991. Du fait de la spécificité auto-interprétative du droit international, déjà mentionnée, rien n’interdit de changer d’axe, notamment historique et d’en analyser les conséquences.
Tout ne sera au final, qu’une affaire de consensus politique. Nous avons fait l’exercice et c’est l’importance de ce qu’il dévoile qui nous a convaincu d’en publier le cadre général.
La communauté internationale reconnaît la souveraineté de l’Ukraine depuis 1945
- Autre interprétation possible
Premier constat largement négligé, l’Ukraine était considérée comme un pays souverain bien avant le 1er décembre 1991. On oublie en effet qu’elle figure parmi les membres fondateurs de l’ONU en 1945. A ce titre, elle a siégé deux fois au Conseil de sécurité sur une période cumulée de 4 ans, ce qui n’est tout de même pas rien en termes de reconnaissance internationale. Elle a voté souverainement sur quantité de sujets contraignants pour le reste de la planète, parfois différemment de l’URSS. Elle a également voté pour l’entrée de nouveaux membres au sein de l’ONU et signé un grand nombre de conventions internationales, toutes choses qu’un Etat non souverain ne pourrait bien entendu pas faire.
Dans sa relation politique à Moscou, les choses n’étaient pas très éloignée de ce qui dessine pour l’Union européenne. Chaque pays a ses diplomates, dont les membres permanents du Conseil de sécurité, mais les décisions importantes se prennent à Bruxelles. C’est le cas en particulier pour les mesures restrictives. Il n’y avait donc rien d’anormal à ce que la Communauté internationale reconnaisse la souveraineté diplomatique, même partielle, de l’Ukraine et son caractère d’Etats déjà semi-indépendant. Or, lorsque l’Ukraine entre à l’ONU, la Crimée n’en fait pas partie. On le sait, c’est en 1954 que Nikita Khrouchtchev décide du rattachement administratif de la Crimée à l’Ukraine, ce qui apparaît aux yeux de tous comme un simple remembrement interne.
Il nous importe peu ici que ce transfert ne se soit pas déroulé en parfaite conformité avec les règles constitutionnelles de l’URSS de l’époque. Ce qui nous intéresse davantage, c’est la conséquence du changement de frontières pour un membre de l’ONU à part entière et pour sa population. En raisonnant par l’absurde, imaginons que ce soit l’entier de la République Fédérative de Russie, qui pour une raison ou pour une autre, aient été absorbée par l’Ukraine, sur ordre de l’URSS. Peut-on imaginer un seul instant que l’ONU serait restée les bras croisés ? Non. On aurait forcément procédé à un constat formel du redécoupage des frontières, ne serait-ce que pour vérifier si un droit d’option de nationalité avait bien été offert au peuple transféré. Par nature, la même chose aurait dû se produire pour l’Ukraine.
L’arrimage de la Crimée en 1954 n’était pas un simple remembrement administratif mais déjà une succession d’Etat dès lors que la communauté internationale reconnaissait à l’Ukraine un siège à l’ONU et l’entier de ses droits souverains correspondants, sans restriction. Seulement voilà, en URSS, tout le monde avait la nationalité soviétique, donc personne n’a soulevé la question. Ce droit de la population de Crimée à se déterminer s’est-il éteint pour autant? Nous ne le pensons pas. Il serait tout à fait envisageable de considérer que ce droit, né en 1954 soit demeuré simplement suspendu jusqu’à ce que son expression puisse se réaliser, c’est-à-dire en cas de changement de nationalité effective, à un moment ou un autre.
Or, ce moment s’est matérialisé dès 1990. Le 26 avril 1990, Gorbatchev fait modifier la loi qui organise les relations entre le Centre et les sujets de l’URSS. La distinction entre républiques unies et républiques autonomes est supprimée, ce qui ouvre la voie à des proclamations de sécession conformes à la constitution de l’URSS. Au mois de juillet suivant, l’Ukraine déclare sa pleine souveraineté. Comme on vient de le voir, ce n’est pas un changement de statut mais un changement de degré, qui s’opère à l’intérieur de sa souveraineté reconnue depuis 1945. Cette déclaration contient un article 5 qui affirme notamment que cette souveraineté s’exerce sur la totalité du territoire, Crimée comprise. La population de Crimée se trouve donc face à un changement de nationalité très probable à court terme. Cependant, l’URSS existe toujours bel et bien à cette époque et les mouvements constitutionnels en cours à ce moment, permettront de modifier le statut administratif de ses régions, sujets ou républiques.
En septembre 1990, le Soviet suprême de Crimée notifie au soviet suprême d’URSS et de Russie son intention d’abroger la décision de 1945-46 qui avait rétrogradé son statut de république autonome (identique à celui de l’Ukraine donc) en simple région (oblast). La Crimée conteste également la légalité de son transfert à l’Ukraine en 1954. Après quoi le parlement de Crimée proclame son droit de restaurer son statut de République socialiste soviétique autonome (RSSA) de Crimée et il amende sa constitution en ce sens. Ce qui est intéressant, c’est que Leonid Kravchuk, président du soviet suprême d’Ukraine, ne s’oppose pas à l’initiative et se rend à plusieurs reprises en Crimée à cet effet.
Avec l’assentiment du pouvoir de Kiev, et finalement en conformité avec les règles (Kiev approuvera la procédure), un référendum de ratification de ce « rétablissement » du statut de la péninsule comme RSSA au sein de l’URSS, est ensuite convoqué pour le 20 janvier 1991. Il s’agit donc très exactement du vote d’autodétermination ouvert en 1954 et suspendu depuis lors, puisque se dessine un changement de nationalité à zéro option en cas d’indépendance complète de l’Ukraine. En effet, et contrairement aux pays baltes, l’Ukraine s’apprêtait à retirer la nationalité soviétique à tous les habitants de son territoire pour la remplacer par l’ukrainienne. Contre toute attente des autorités ukrainiennes, le referendum remporte un oui massif et incontestable dans sa régularité : 94.3% des votants, qui totalisent un taux de participation de 81,37%, se prononcent en faveur du rétablissement de la RSSA de Crimée au sein de l’URSS, ou dans sa nouvelle formule, c’est-à-dire avec un droit de participer au nouveau Traité de l’Union organisé par Gorbatchev. C’est aussi simple que cela : la Crimée est légalement sortie d’Ukraine ce jour là (Ukraine souveraine quant aux conventions internationales, rappelons-le) et se trouve rattachée de nouveau à l’URSS en tant que république autonome.
Alors que s’est-il passé ? Kiev, qui était déjà conseillée par un comité consultatif mis en place très officiellement par George Soros et composé notamment de talentueux avocats américains, court-circuite le résultat à l’arraché. Elle fait passer en extrême urgence une loi le 12 février suivant, par le soviet suprême d’Ukraine, qui reconnaît la nouvelle RSSA de Crimée, mais à l’intérieur de l’Ukraine. Ce faisant, elle annexe purement et simplement la Crimée, qui venait de se détacher d’elle le plus légalement du monde et en parfaite conformité avec son droit d’autodétermination suspendu depuis 1954. La déliquescence de l’URSS et l’activisme étranger feront le reste, en bafouant les droits légitimes de la population de Crimée, en parfaite connaissance de cause. Les mêmes intérêts qui sont à la manœuvre en ce moment.
Il y avait évidemment à la clé les bases navales stratégiques de Sébastopol et le contrôle de la mer noire. Quels que soient les traités qui aient pu intervenir par la suite, dans une confusion savamment orchestrée, afin de prendre le contrôle politique des réformes à venir, l’annexion de la Crimée par l’Ukraine le 12 février 1991, paraît un fait suffisamment marquant pour ouvrir le débat au sein de la communauté juridique. On pourrait même arguer du fait que la population de Crimée a basculé ce jour-là dans un statut non-autonome, qui a perduré jusqu’au nouveau référendum d’autodétermination du 16 mars 2014.
Quels que soient les sentiments politiques des uns et des autres, il est indéniable que la communauté internationale reconnaissait à l’Ukraine une indépendance diplomatique entière depuis 1945 et que le rattachement de la Crimée en 1954 aurait dû faire l’objet d’un traitement juridique correspondant, notamment en termes de modification du tracé des frontières, en particulier maritimes, et de droit d’option de nationalité de la population locale. Il est également indéniable que le peuple de Crimée s’est déterminé légalement pour une réunification à l’URSS le 20 janvier 1991 et que le statut de la péninsule passait de région à république autonome dans le même temps. C’est-à-dire qu’elle avait encore une deuxième chance de déclarer son indépendance après la dissolution de l’URSS, dans la mesure où son statut de république autonome la plaçait au même rang fédéral que l’Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, etc…
Il est enfin indéniable que l’Ukraine a détourné le résultat de cette autodétermination et de son potentiel futur, par une loi provoquant une annexion de la Crimée. Il en résulte que le débat est largement ouvert pour considérer le référendum du 16 mars 2014 non pas comme une étape vers l’annexion de la Crimée par la Russie, mais comme un fait de désannexion légitime de la Crimée, réitérant le vote du 20 janvier 1991 et réintégrant pacifiquement le peuple de Crimée dans ses droits acquis à cette date. Si une telle analyse avait les faveurs des Etats qui ont la préférence de Berne dans ce conflit, il ne fait aucun doute qu’elle serait déjà consacrée par une reconnaissance officielle. Il n’en demeure pas moins, qu’à l’aune de cette faille critique dans le raisonnement du Conseil fédéral, la violation du droit international est beaucoup moins évidente qu’on le clame et mérite un débat démocratique ouvert, conforme à la vocation historique de la Suisse, et garanti par sa neutralité. Après quoi le retrait de la Suisse du processus des sanctions paraitra sans doute justifié.
——- Focus 2 Loi sur les embargos (LEmb)
La loi sur les embargos (LEmb) est discrète. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, le Conseil fédéral la présenta comme un simple ajustement « technique ». L’idée officielle était d’offrir une loi cadre au gouvernement, prenant en compte la nouvelle facette des « smart sanctions », sans les nommer d’ailleurs. En réalité, c’est une véritable loi de subornation[17] qui fut votée. Auparavant, les sanctions se fondaient directement sur l’article 183-4 de la Constitution qui posait comme condition que : « la sauvegarde des intérêts du pays l’exige ». La LEmb ne pose plus une condition mais un but. Elle est faite: « pour appliquer les décisions (…) des principaux partenaires commerciaux de la Suisse ». Tout est dit, c’est une norme d’application de directives étrangères. Est-elle obligatoire pour la Suisse ? Il semble que oui si on lit son art. 2 : « Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions afin (…) de sauvegarder des intérêts suisses. »
On notera le glissement d’une sauvegarde principale des intérêts suisses en général, à une dérogation pour des intérêts suisses, c’est-à-dire ponctuelle et spécifique. Dérogation à quoi, si ce n’est donc aux intérêts des pays émetteurs ? Certes, la LEmb n’a pas fermé le droit de recourir à l’art. 184-3 Cst. Cela fut fait récemment encore, pour geler les avoirs des familles Moubarak d’Egypte et Ben Ali de Tunisie. Mais si le recours à la LEmb n’a pas eu lieu, c’est justement parce que les « partenaires commerciaux » de la Suisse n’avaient pas encore pris de sanction contre les deux autocrates. C’est une confirmation supplémentaire du fait que la LEmb est une norme d’application seconde de directives étrangères premières. On sait que ce texte est le résultat direct du « processus d’Interlaken », organisé à la demande de l’ONU, en vue de généraliser la technique des « smart sanctions ».
Il s’est déroulé à partir de mars 1998, encadré notamment par des responsables du «Watson Institute Targeted Sanctions Project » (Brown University, Rhodes Island, USA) qui en furent les rapporteurs. Le résultat, connu d’avance, valida l’obligation pour les pays participants de se doter d’une législation identique entre eux, dans le but d’appliquer des sanctions internationales uniformes et sans délai. On le lit noir sur blanc dans un rapport de l’époque, les « lois nationales devraient viser des effets uniformes des sanctions plutôt qu’établir des procédures et des moyens uniformes ». Le processus d’Interlaken a mis sur pied un standard de guerre économique conforme à l’approche américaine et a introduit à cet effet un impératif de synchronisation internationale des sanctions.
Au lieu de signer un traité international, on a créé une « entente », au sens juridique du terme, un cartel des sanctions, en vue d’assurer cet « effet uniforme » des sanctions. Bel exploit ! Il ne restait plus qu’à y ajouter le transfert automatique d’informations aux « partenaires commerciaux ». Depuis 2003, toute sanction édictée à l’étranger ouvre le droit de venir se servir à satiété dans la sphère confidentielle des secrets d’affaires de la concurrence installée en Suisse. La LEmb est très généreuse :
- visite domiciliaires inopinées, contrôle et consultations de tous documents et informations ;
- transfert d’informations même « sensibles » aux autorités étrangères et organismes internationaux qui en auraient besoin.
Un exemple d’application possible d’un tel mécanisme est celui de l’amende administrative faramineuse de $9 milliards, imposée récemment à la BNP sans jugement. Son crime ? La suspicion d’avoir, tiens donc : « contourné » des sanctions internationales américaines contre le Soudan, Cuba et l’Iran. C’est-à-dire pour avoir simplement utilisé le dollar dans ses transactions avec des « ennemis des États-Unis »… En nous souvenant que certaines de ces transactions passaient par la Suisse, il est techniquement possible que la LEmb ait joué la courroie de transmission pour ce nouveau moyen de renflouer leurs caisses US. Explication. Un beau jour, la BNP s’est donc vue notifier de simples soupçons de « contournement » de ses embargos, par les autorités de poursuites américaines. Ces dernières lui ont proposé le « deals of justice[18]» suivant : collaborer ou sortir du marché américain, payer ou disparaître. Pas d’autre choix que le premier car sinon des poursuites pénales seraient ouvertes, avec pour effet immédiat de suspendre les droits de la banque à travailler aux Etats-Unis, c’est-à-dire la sortie assurée du marché. Alors elle dit oui.
Elle doit en premier lieu s’auto-incriminer des soupçons portés contre elle, en violation directe du Vème Amendement. Mais on l’oblige à y renoncer. Vient ensuite une minutieuse enquête obligatoirement à charge, organisée selon les directives des services américains et diligentée contre elle par des avocats et auditeurs, désignés par les services de poursuite, mais intégralement payés par elle. C’est-à-dire qu’elle fait travailler ses avocats contre elle…Exit le procès équitable, les droits de la défense, la présomption d’innocence, la charge de la preuve à l’accusation, etc. Cette « enquête » se traduit en pratique par le pillage systématique de toutes les informations de la banque, pudiquement nommé : « transfert d’informations même sensibles », comme dans la LEmb. Les informations privées de et sur le personnel y sont évidemment incluses sans restriction.
Si la BNP a bien collaboré et renoncé à critiquer ce mode opératoire et à proclamer son innocence, elle passera à la caisse pour le plus grand bonheur des finances publiques américaines fédérales et locales. Sur les $9 milliards d’amende, plus de $2 milliards iront dans les comptes de l’État de New York. Son gouverneur, Andrew Cuomo, se frotte les mains. Son problème (qui fait la une des journaux locaux !) c’est comment partager le butin entre différents postes : la réfection du Tappan Zee Bridge, les routes, l’entretien des écoles ou la réduction de la dette publique ? Alors, notre loi sur les embargos, simple « ajustement technique » ou vecteur utile des deals de justice ?
Arnaud Dotézac est directeur de la rédaction du magazine market, édité à Genève et spécialiste de géopolitique, en particulier du monde arabo-musulman et du sous-continent indien. Il est également chargé de cours en droit comparé à l’Université de Genève et membre du Centre d’histoire et de prospective militaire suisse (CHPM).
[1] « Contre-mesures » dans la terminologie diplomatique d’origine américaine, « mesures restrictives » dans la terminologie européenne.
↩
[2] A moins qu’elle n’émane d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, juridiquement contraignante.
↩
[3] Ile située au sud des Antilles, d’une superficie de 300 km2 et peuplée de 54000 habitants, soit environ la population de Bienne.
↩
[4] « L’île de Tobago peut-elle adopter une loi qui serait juridiquement contraignante pour le reste du monde? Le monde se soumettrait-il à la prétention d’une telle compétence ? »/ Aff. Buchanan v Rucker, Court of King’s Bench, Londres, 1808.
↩
[5] Michel Jobert, L’aveuglement de l’Occident, Paris, Éditions Albin Michel, 1997
↩
[6] « The world must be made safe for democracy » est le titre de son discours célèbre, prononcé au Congrès le 2 avril 1917, afin de justifier l’entrée en guerre des USA contre l’Allemagne.
↩
[7] Charles Leben, « Les contre-mesures interétatiques » AFDI n°28, 1983, pp 9-77.
↩
[8] cf. Hubert Védrine, « Les mondes de François Mitterrand à l’Elysée (1981-1995), Fayard, Paris, 1996.
↩
[9] Il exposa comment, en plus de la coupure du robinet de gaz, les Etats-Unis décidèrent d’agir en parallèle sur la baisse du prix du brut, avec l’aide des Saoudiens, afin d’étrangler les entrées de pétro-devises en URSS, cf. Peter Schweizer, « Victory », Grove Atlantic, New York, 1996.
↩
[10] H. Védrine, op.cit.
↩
[11] ndlr, malgré cela, Sergueï Narychkine s’est rendu à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Genève, le 3 octobre 2014.
↩
[12] Par exemple au regard de l’art 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que: « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
↩
[13] Professeure à l’Université de Genève.
↩
[14] Les sanctions individuelles sont contraires, notamment à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (art. 2, 10, 11, 13, 22, 25), au Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (art. 12, 14), à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (art. 2, 6, 8, 9 ; art. 2 du protocole n°4 et 3 du protocole n°7) ;
↩
[15] Par exemple : résolution 24/14 du 27 septembre 2013, disponible ici : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/A_HRC_RES_24_14_FRE%20(1).pdf.
↩
[16] En simplifiant à l’extrême la formule traduit un « laisser en l’état », d’où l’idée d’intangibilité des frontières à la date de la succession d’Etat, c’est-à-dire de l’indépendance.
↩
[17] Définition : Action par laquelle on amène quelqu’un à faire quelque chose contre son devoir.
↩
[18] Voir la seul étude exhaustive disponible à ce jour : « Les deals de justice », PUF Paris, 2013.
↩
Source : World Peace Threathened