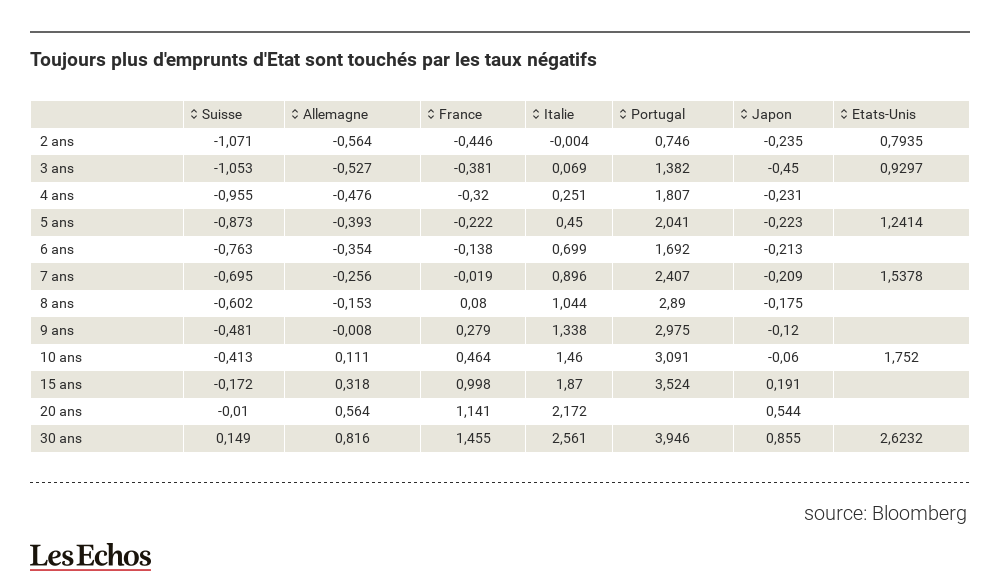Un très vieil article de Soros, mais qui reste fort intéressant..
Source : The Atlantic, le 02/1997
Quel genre de société voulons-nous ? “Laissons le libre marché décider !” est la réponse souvent entendue. Cette réponse, argumente un éminent capitaliste, sape les valeurs dont dépendent les sociétés ouvertes et démocratiques.
GEORGE SOROS | PUBLICATION DE FEVRIER 1997
 Dans The Philosophy of History, Hegel a discerné un modèle historique distributif – la cassure puis la chute des civilisations en raison à une intensification morbide de leurs propres principes fondamentaux. Bien que j’aie fait une fortune sur les marché financiers, j’ai maintenant peur que l’intensification sans entrave du capitalisme du laissez-faire et de la propagation des valeurs marchandes dans les domaines de la vie mettent en danger notre société ouverte et démocratique. L’ennemi principal de la société ouverte, je crois, n’est plus la menace communiste mais la menace capitaliste.
Dans The Philosophy of History, Hegel a discerné un modèle historique distributif – la cassure puis la chute des civilisations en raison à une intensification morbide de leurs propres principes fondamentaux. Bien que j’aie fait une fortune sur les marché financiers, j’ai maintenant peur que l’intensification sans entrave du capitalisme du laissez-faire et de la propagation des valeurs marchandes dans les domaines de la vie mettent en danger notre société ouverte et démocratique. L’ennemi principal de la société ouverte, je crois, n’est plus la menace communiste mais la menace capitaliste.
Le terme de “société ouverte” a été pour la première fois utilisé par Henri Bergson, dans son livre Les deux sources de la morale et de la religion (1932), et mis en lumière par le philosophe autrichien Karl Popper, dans son livre La société ouverte et ses ennemis (1945). Popper montre que les idéologies totalitaires comme le communisme ou le nazisme ont un élément commun : elles prétendent détenir la vérité ultime. Depuis que la vérité ultime est hors de portée de l’espèce humaine, ces idéologies doivent avoir recours à l’oppression afin d’imposer leur vision de la société. Popper a juxtaposé à ces idéologies totalitaires une autre vision de la société, qui reconnaît que personne n’a le monopole de la vérité ; différentes personnes ont des vues différentes et des intérêts différents, et il y a un besoin d’institutions qui les autorisent à vivre ensemble en paix. Ces institutions protègent les droits des citoyens et assurent la liberté de choix et la liberté d’expression. Popper a appelé cette forme de d’organisation sociale la “société ouverte”. Les idéologies totalitaires étaient ses ennemis.
Ecrit durant la Seconde Guerre mondiale, La société ouverte et ses ennemis expliquait ce que les démocraties occidentales défendait et ce pour quoi elles se battaient. L’explication était hautement abstraite et philosophique, et le terme “société ouverte” n’obtint jamais une large reconnaissance. Néanmoins, l’analyse de Popper était pénétrante, et quand je l’ai lu en tant qu’étudiant à la fin des années 40, ayant déjà fait l’expérience à la fois du nazisme et du communisme en Hongrie, cela me frappa telle une révélation.
J’ai été amené à explorer plus profondément la philosophie de Karl Popper, et à me demander, pourquoi personne n’a accès à la vérité ultime ? La réponse est devenue claire : nous vivons dans le même univers que nous tentons de comprendre, et nos perceptions peuvent influer sur les évènements auxquels nous participons. Si nos pensées appartiennent à un univers et leur sujet à un autre, la vérité pourrait être interne à notre compréhension : nous pourrions formuler des affirmations correspondant aux faits, et les faits serviraient de critères fiables pour décider dans quel cas les affirmations sont vraies.
 Il y a un domaine où ces conditions prévalent : les sciences naturelles. Mais dans d’autres domaines de l’activité humaine la relation entre affirmations et faits est moins nette. Sur les questions politiques et sociales les perceptions des acteurs aident à déterminer la réalité. Dans ces situations les faits ne constituent pas nécessairement un critère fiable pour juger de la vérité des affirmations.
Il y a un domaine où ces conditions prévalent : les sciences naturelles. Mais dans d’autres domaines de l’activité humaine la relation entre affirmations et faits est moins nette. Sur les questions politiques et sociales les perceptions des acteurs aident à déterminer la réalité. Dans ces situations les faits ne constituent pas nécessairement un critère fiable pour juger de la vérité des affirmations.
Que la théorie soit valide ou non, cela s’est avéré être très utile pour moi sur les marchés financiers. Lorsque j’ai fait plus d’argent que je n’en avais besoin, j’ai décidé de mettre en place une fondation. J’ai réfléchi à ce qui m’importait vraiment. D’avoir vécu sous les persécutions nazies et l’oppression communiste, j’en suis venu à la conclusion que ce qui était primordial pour moi était une société ouverte. J’ai donc appelé la fondation le Fonds de la Société Ouverte (Open Society Funds), et j’ai défini ses objectifs comme étant d’ouvrir les sociétés, de rendre les sociétés ouvertes plus viables, et de promouvoir un mode critique de pensée. C’était en 1979.
Mon premier engagement majeur fut en Afrique du Sud, mais ce ne fut pas un succès. Le système de l’apartheid était si omniprésent que peu importe ce que j’essayais de faire, cela me rendait partie prenante du système plutôt que n’aidait à le changer. Puis j’ai tourné mon attention vers l’Europe centrale. Là j’eus beaucoup plus de succès. J’ai commencé à soutenir le mouvement tchécoslovaque de la Charte 77 en 1980 et Solidarité en Pologne en 1981. J’ai établi des fondations séparées dans mon pays d’origine, la Hongrie, en 1984, en Chine en 1986, en Union soviétique en 1987 et en Pologne en 1988. Mon engagement s’est accéléré avec l’effondrement du système soviétique. A présent j’ai établi un réseau de fondations qui s’étendent dans plus de 25 pays (sans compter la Chine, où nous avons fermé en 1989).
Opérant sous des régimes communistes, je n’ai jamais ressenti le besoin d’expliquer ce que signifiait “société libre” ; ceux qui soutenaient les objectifs des fondations le comprenaient mieux que moi, même s’ils n’étaient pas familiers avec l’expression. Le but de ma fondation en Hongrie, par exemple, était de soutenir des activités alternatives. Je savais que le dogme communiste prévalant était faux justement en ce qu’il était un dogme, et qu’il deviendrait insoutenable s’il était exposé à des alternatives. L’approche s’est avérée efficace. La fondation est devenue la principale source de soutien de la société civile en Hongrie, et au fur et à mesure que la société civile fleurissait, le régime communiste déclinait.
 Après l’effondrement du communisme, la mission du réseau de la fondation changea. Reconnaissant qu’une société ouverte est une forme d’organisation sociale plus avancée et sophistiquée qu’une société fermée (parce que dans une société fermée il n’y a qu’un seul schéma directeur qui est imposé à la société, alors que dans une société ouverte chaque citoyen n’est pas seulement autorisé mais requis de penser par lui-même). La plupart de mes fondations ont fait du bon travail, mais malheureusement, elles étaient un peu esseulées. Les sociétés ouvertes de l’Occident ne ressentaient pas un besoin pressant de promouvoir les sociétés ouvertes dans l’ancien empire soviétique. Au contraire, la vision prévalente était que les gens devaient être laissés libres de s’occuper eux-mêmes de leurs affaires. La fin de la guerre froide apporta une réponse bien différente de celle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’idée d’un nouveau plan Marshall ne pouvait même pas être envisagée. Quand j’ai proposé une telle idée lors d’une conférence à Potsdam (dans ce qui était alors encore l’Allemagne de l’Est), au printemps de 1989, les gens m’ont littéralement ri au nez.
Après l’effondrement du communisme, la mission du réseau de la fondation changea. Reconnaissant qu’une société ouverte est une forme d’organisation sociale plus avancée et sophistiquée qu’une société fermée (parce que dans une société fermée il n’y a qu’un seul schéma directeur qui est imposé à la société, alors que dans une société ouverte chaque citoyen n’est pas seulement autorisé mais requis de penser par lui-même). La plupart de mes fondations ont fait du bon travail, mais malheureusement, elles étaient un peu esseulées. Les sociétés ouvertes de l’Occident ne ressentaient pas un besoin pressant de promouvoir les sociétés ouvertes dans l’ancien empire soviétique. Au contraire, la vision prévalente était que les gens devaient être laissés libres de s’occuper eux-mêmes de leurs affaires. La fin de la guerre froide apporta une réponse bien différente de celle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’idée d’un nouveau plan Marshall ne pouvait même pas être envisagée. Quand j’ai proposé une telle idée lors d’une conférence à Potsdam (dans ce qui était alors encore l’Allemagne de l’Est), au printemps de 1989, les gens m’ont littéralement ri au nez.
L’effondrement du communisme pose les jalons d’une société ouverte universelle, mais les démocraties occidentales n’ont pas su saisir l’occasion. Les nouveaux régimes qui émergent dans l’ex-Union soviétique et l’ex-Yougoslavie ressemblent très peu à des sociétés ouvertes. L’alliance occidentale semble avoir perdu sa détermination, car elle ne peut se définir elle-même en termes de menace communiste. Elle a montré peu d’envie de venir en aide à ceux qui ont défendu l’idée de société ouverte en Bosnie ou ailleurs. Quant aux personnes qui vivent dans d’anciens pays communistes, elles ont pu aspirer à une société nouvelle lorsqu’elles souffraient de la répression, mais maintenant que le système communisme s’est effondré, elles sont préoccupées par des problèmes de survie. Après l’échec du communisme est arrivée une désillusion générale concernant les concepts universels, et la société ouverte est un concept universel.
Ces considérations m’ont forcé à réexaminer mes convictions concernant la société ouverte. Pendant les cinq ou six ans qui ont suivi la chute du Mur, j’ai consacré pratiquement toute mon énergie à la transformation du monde anciennement communiste. Plus récemment, j’ai réorienté mon attention sur nos propres sociétés. Le réseau de fondations que j’ai créé continue de faire un excellent travail ; toutefois, il me semble urgent de reconsidérer les concepts fondateurs qui ont présidé à sa création. Cette réévaluation m’a conduit à la conclusion que le concept de société ouverte n’a pas perdu en pertinence. Au contraire, il est peut-être même encore plus nécessaire pour comprendre le moment présent et pour fournir un guide pratique à l’action politique, qu’au moment où Karl Popper a écrit son livre – mais il a besoin d’être fortement repensé et reformulé. Si la société ouverte doit servir d’idéal digne d’un combat, elle ne peut plus être simplement définie en termes de menace communiste. Elle doit être dotée d’un sens positif.
LE NOUVEL ENNEMI
 Popper a montré que le fascisme et le communisme ont beaucoup en commun, même si l’un représentait l’extrême droite et l’autre l’extrême gauche, parce que tous deux s’appuyaient sur la puissance de l’État pour réprimer la liberté individuelle. Je souhaite étendre cet argument. Je postule qu’une société ouverte pourrait aussi être menacée, mais d’une autre direction – par un excès d’individualisme. Trop de concurrence et trop peu de coopération peuvent mener à des inégalités intolérables et à l’instabilité.
Popper a montré que le fascisme et le communisme ont beaucoup en commun, même si l’un représentait l’extrême droite et l’autre l’extrême gauche, parce que tous deux s’appuyaient sur la puissance de l’État pour réprimer la liberté individuelle. Je souhaite étendre cet argument. Je postule qu’une société ouverte pourrait aussi être menacée, mais d’une autre direction – par un excès d’individualisme. Trop de concurrence et trop peu de coopération peuvent mener à des inégalités intolérables et à l’instabilité.
S’il existe une pensée dominante dans la société actuelle, c’est l’idée d’un marché magique. La doctrine du laissez-faire en capitalisme prétend que le bien commun est parfaitement atteint par la poursuite sans entrave de l’intérêt personnel. Mais, à moins qu’il soit refréné par la reconnaissance d’un intérêt général supérieur à certains intérêts particuliers, notre système actuel – qui, malgré toutes ses imperfections, peut être défini comme une société ouverte – court à sa perte.
Je souhaite insister sur le fait que je ne place pas le laisser-faire capitaliste dans la même catégorie que le nazisme ou le communisme. Les idéologies totalitaires essayaient délibérément de détruire la société ouverte ; le laissez-faire la met en danger, mais par inadvertance. Friedrich Hayek, l’un des apôtres du laisser-faire, était aussi un défenseur de la société ouverte. Néanmoins, parce que le communisme et même le socialisme ont été profondément discrédités, je considère que la menace venant du laisser-faire est plus grave aujourd’hui que celle des idéologies totalitaires. Nous jouissons d’un marché véritablement global dans lequel les biens, les services, les capitaux et même les personnes circulent très librement, mais nous ne parvenons pas à voir la nécessité de défendre les valeurs et les institutions d’une société ouverte.
La situation actuelle est comparable à celle du début du siècle dernier. C’était un âge d’or du capitalisme, caractérisé par un principe de laisser-faire ; comme aujourd’hui. La période précédente était à bien des égards plus stable. Il y avait un pouvoir impérial, l’Angleterre, prêt à envoyer des canonnières dans des lieux éloignés, parce que, en tant que principal bénéficiaire du système, il avait un intérêt manifeste à le maintenir. De nos jours, les États-Unis ne veulent pas être le gendarme de la planète. La période précédente avait l’étalon or ; de nos jours les monnaies fluctuent et s’effondrent. Et pourtant le système de libre marché qui a prévalu il y a un siècle a été détruit par la Première Guerre mondiale. Des idéologies totalitaires en sont nées, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait quasiment plus de transfert de capitaux entre pays. Voyez comme le régime actuel risque de s’effondrer, si nous ne tenons pas compte de l’expérience passée !
Bien que la doctrine de laissez-faire ne contredise pas autant la société ouverte que pouvaient le faire le marxisme-léninisme ou les idées nazies de pureté raciale, toutes ces doctrines ont un point commun : elles prétendent toutes justifier posséder une vérité finale, par un appel à la science. Dans le cas des doctrines totalitaires, cet appel pouvait facilement être méprisé. L’une des réussites de Popper fut de démontrer que le marxisme n’est pas une science. Le cas du laissez-faire capitaliste est plus difficile, parce qu’il est fondé sur la théorie économique, et l’économie est la science sociale qui jouit de la meilleure réputation. On ne peut simplement pas mettre sur le même plan l’économie de marché et le marxisme. Néanmoins, je soutiens que l’idéologie du laisser-faire constitue une perversion d’une vérité pseudo-scientifique tout autant que le marxisme-léninisme.
Le principe scientifique le plus important qui soutient l’idéologie du laisser-faire est la théorie selon laquelle le marché concurrentiel amène l’offre et la demande à leur point d’équilibre et ainsi assure la meilleure allocation possible des ressources. Ceci est généralement accepté comme une vérité éternelle, et dans un certain sens, cela en est une. La théorie économique est un système axiomatique : tant que ses hypothèses sont vérifiées, ses conclusions sont exactes. Mais lorsque l’on examine de près ses hypothèses, on s’aperçoit qu’elles ne s’appliquent pas au monde réel. Telle qu’elle fut formulée originellement, la théorie de la concurrence parfaite – de l’équilibre parfait entre offre et demande – supposait une connaissance parfaite, des produits homogènes et facilement divisibles, et un nombre suffisamment important de participants sur le marché pour qu’aucun participant individuel ne puisse seul influer sur les prix. L’hypothèse de connaissance parfaite est impossible à vérifier, si bien qu’elle fut remplacée par une construction astucieuse. L’offre et la demande ont été considérées comme des données indépendantes. Cette condition a été présentée comme un prérequis méthodologique plutôt que comme une hypothèse. On a prétendu que la théorie économique étudie la relation entre offre et demande ; ainsi, les deux devenaient une donnée du problème.
Comme je l’ai montré par ailleurs, l’hypothèse que l’offre et la demande pourraient être des données indépendantes ne se vérifie pas dans la réalité, en tout cas pas dans le cas du marché financier – et le marché financier joue un rôle crucial dans l’allocation des ressources. Les acheteurs et les vendeurs sur le marché financier parient sur l’avenir sur la base de leurs propres décisions. Les courbes de l’offre et de la demande ne peuvent pas être des données du problème car elles incorporent toutes les deux des attentes à propos d’évènements qui sont eux-mêmes influencés par ces attentes. Il y a un mécanisme de retour à deux voies entre le mode de pensée des participants au marché et la situation à laquelle ils pensent – la “réflexivité”. Cela tient compte à la fois de la compréhension imparfaite des participants (un élément dont la prise en compte est l’une des bases de la société ouverte) et du caractère indéterminé du processus auquel ils participent.
Si les courbes de l’offre et de la demande ne sont pas des données indépendantes, comment les prix du marché sont-ils déterminés ? Si l’on analyse le comportement des marchés financiers, nous voyons que, plutôt que de tendre vers un équilibre, les prix continuent de fluctuer en fonction des attentes des acheteurs et des vendeurs. Il existe des périodes pendant lesquelles les prix s’éloignent de tout équilibre théorique. Même s’ils montrent une tendance à y revenir, l’équilibre n’est pas le même que ce qu’il aurait été sans la période de turbulence. Et pourtant le concept d’équilibre perdure. Il est facile de voir pourquoi : sans lui, l’économie ne pourrait dire comment les prix sont fixés.
En l’absence d’équilibre, la prétention du libre-marché d’amener à l’allocation optimale des ressources perd sa justification. La théorie prétendument scientifique qui a été utilisée pour la valider devient une simple structure axiomatique dont les conclusions sont contenues dans ses hypothèses, et qui n’est pas nécessairement démontrée par des preuves empiriques. La ressemblance avec le marxisme, qui lui aussi prétendait au statut de science, est assez dérangeante.
Je ne prétends pas que la théorie économique a délibérément déformé la réalité pour des besoins politiques. Mais en essayant d’imiter les réussites (et d’acquérir le prestige associé) aux sciences naturelles, la théorie économique a tenté l’impossible. Les théories des sciences sociales ont une relation réflexive à leur sujet d’étude. Cela signifie qu’elles peuvent influer sur le cours des évènements d’une façon que les sciences naturelles ne peuvent faire. Le célèbre principe d’incertitude d’Heisenberg implique que tout acte d’observation peut interférer dans le comportement des particules quantiques ; mais c’est l’observation qui crée l’effet, pas le principe d’incertitude lui-même. Dans la sphère sociale, les théories ont la capacité d’altérer le sujet d’étude lui-même. La théorie économique a délibérément exclu la réflexivité de ses considérations. Ce faisant, elle a déformé son sujet d’étude et s’est ainsi exposée à l’exploitation par l’idéologie du laisser-faire.
Ce qui a permis de convertir la théorie économique en une idéologie hostile à la société ouverte est l’hypothèse de la connaissance parfaite – dans un premier temps ouvertement formulée, puis déguisée en outil méthodologique. Le mécanisme du marché a une très grande qualité, mais ce n’est pas d’être parfait ; c’est plutôt d’être, dans un monde dominé par la compréhension imparfaite, de fournir un moyen efficace d’évaluer le résultat de ses décisions et de corriger ses erreurs.
Sous n’importe laquelle de ses formes, l’assertion d’information parfaite entre en contradiction avec le concept de société ouverte (qui elle reconnaît que notre compréhension de chaque situation est intrinsèquement imparfaite). Comme ce point est abstrait, je dois décrire des exemples spécifiques dans lesquels le laissez-faire représente une menace à la société ouverte. Je me concentrerai sur trois sujets : la stabilité économique, la justice sociale et les relations internationales.
STABILITE ECONOMIQUE
La théorie économique a réussi à créer un mode artificiel dans lequel les préférences des participants et les opportunités auxquelles les participants sont confrontés sont indépendantes l’une de l’autre, et dans lequel les prix tendent vers un équilibre qui amène les deux forces à l’équilibre. Mais dans un marché financier les prix ne sont pas simplement le reflet passif de la donnée indépendante de l’offre et de la demande ; ils jouent aussi un rôle dans la formation des préférences et des opportunités. Cette interaction réflexive rend les marchés financiers foncièrement instables. L’idéologie du laissez-faire nie cette instabilité et s’oppose à toute forme de gouvernement qui chercherait à rétablir la stabilité.
L’histoire montre que les marchés financiers s’effondrent parfois, provoquant dépression économique et agitation sociale. Chaque effondrement a conduit à des évolutions des banques centrales et d’autres formes de réglementation. L’idéologie du laissez-faire aime faire accroire que les effondrements sont dus à de mauvaises régulations, pas à l’instabilité des marchés. Leur argument n’est pas totalement faux, puisque si notre compréhension est foncièrement imparfaite, toute réglementation présente des défauts. Mais leur argument sonne creux, car ils oublient d’expliquer pourquoi la réglementation fut mise en place en premier lieu. Ils esquivent la difficulté en utilisant un autre argument qui se résume à ceci : comme toute régulation est défectueuse, alors un marché dérégulé est parfait.
Cet argument s’appuie sur l’hypothèse de parfaite information : si une solution est fausse, la solution opposée doit être correcte. En l’absence d’information parfaite, toutefois, le marché libre comme la règlementation sont défectueux. La stabilité ne peut être préservée que si un effort conscient est fait dans ce but. Malgré cela des effondrements auront lieu, parce que les politiques publiques sont souvent imparfaites. S’ils sont profonds, de tels effondrements peuvent donner naissance à des régimes totalitaires.
L’instabilité s’étend bien au-delà des marchés financiers : elle affecte les valeurs qui nous guident dans nos actions. La théorie économique prend les valeurs pour des constantes. A l’époque de la naissance de la théorie économique, à l’époque d’Adam Smith, de David Ricardo et d’Alfred Marshall, c’était une hypothèse raisonnable, car les peuples avaient, en effet, un système de valeurs assez fermement établi. Adam Smith lui-même a combiné des éléments de philosophie morale avec sa théorie économique. Au-delà des préférences personnelles qui s’exprimaient dans leur comportement sur le marché, les personnes étaient guidées par une série de principes moraux qui trouvaient leur expression en dehors du périmètre des mécanismes du marché. Profondément ancrés dans la tradition, la religion et la culture, ces principes n’étaient pas forcément rationnels au sens de choix conscients parmi des alternatives possibles. A vrai dire, bien souvent ces choix n’étaient pas forcément très défendables lorsque des alternatives apparaissaient. Les valeurs du marché ont fini par saper les valeurs traditionnelles.
Il y a un conflit évident entre les valeurs du marché et les autres valeurs plus traditionnelles, ce qui a provoqué des débats passionnés et de forts antagonismes. A mesure que le mécanisme du marché a gagné du terrain, la fiction selon laquelle les gens agissent en fonction d’un nombre de valeurs non liées au marché est devenue de plus en plus difficile à défendre. La publicité, le marketing et même les emballages cherchent à influer sur la formation des préférences personnelles, plutôt que de simplement, comme le prévoit la théorie du laissez-faire, répondre au besoin. Incapables de définir un point de référence, nous utilisons de plus en plus souvent l’argent comme critère d’évaluation. Ce qui est plus cher est considéré comme meilleur. La valeur d’une œuvre d’art est jugée sur le prix qu’elle atteint. Des personnes méritent le respect et l’admiration parce qu’elles sont riches. Ce qui n’était qu’un moyen d’échange a usurpé la place des valeurs fondamentales, renversant l’ordre dans la relation postulée par la théorie économique. Ce qui constituait des professions est devenu des affaires. Le culte du succès a remplacé la foi en des principes. La société a perdu ses fondements.
DARWINISME SOCIAL
En tenant l’offre et la demande pour des données et en déclarant toute forme d’intervention gouvernementale malsaine, l’idéologie du laissez-faire a effectivement banni toute forme de redistribution du revenu ou de la richesse. Je reconnais que toute tentative de redistribution interfère avec l’efficacité du marché, mais il n’en résulte pas nécessairement qu’aucune tentative ne doive être faite. L’argument du laissez-faire repose sur le même appel tacite à la perfection que le faisait le communisme. Il prétend que, si la redistribution provoque l’inefficacité et la distorsion, le problème peut être résolu en éliminant la redistribution – exactement comme le communisme prétendait que la duplication qu’implique la concurrence était un gaspillage, et que par conséquent l’économie devait être planifiée de façon centrale. Mais la perfection est inatteignable. La richesse s’accumule en effet entre les mains des possédants, et si aucun mécanisme n’impose la redistribution, les inégalités deviennent intolérables. “L’argent est comme le fumier, inutile s’il n’est pas répandu.” Francis Bacon était un profond économiste.
L’argument du laissez-faire contre la redistribution invoque la doctrine de la survie des plus forts. C’est oublier le fait que la richesse se transmet par héritage, et que la seconde génération est rarement aussi forte que la première.
Dans tous les cas, il ne paraît pas sain de faire de la survie des plus forts le principe directeur d’une société civilisée. Le darwinisme social est fondé sur une version dépassée de la théorie de l’évolution, tout comme la théorie de l’équilibre en économie prend sa source dans la physique newtonienne. Le principe de l’évolution des espèces est la mutation, et la mutation se manifeste de façon beaucoup plus subtile. Les espèces et leur environnement interagissent, et une espèce agit comme une partie de l’environnement pour une autre. Il y a un mécanisme de retour en histoire, très similaire à celui de réflexivité, avec la différence que, dans le cas de l’histoire, le mécanisme n’est pas mû par la mutation mais par erreurs. Je mentionne ceci parce que le darwinisme social est l’une des erreurs qui guident les affaires humaines de nos jours. Le point principal que je veux souligner est que la coopération fait partie du système tout autant que la compétition, et le slogan “la survie des plus forts” déforme cette réalité.
RELATIONS INTERNATIONALES
L’idéologie du laissez-faire partage certaines des déficiences d’une autre science erronée, la géopolitique. Les États n’ont pas de principes, seulement des intérêts, argumentent les géopoliticiens, et ces intérêts sont déterminés par la localisation géographique d’autres fondamentaux. Cette approche déterministe trouve ses origines dans une vision obsolète de la méthode scientifique du XIXe siècle, et elle souffre d’au moins deux défauts flagrants qui ne s’appliquent pas avec la même force aux doctrines économiques du laissez-faire. L’un est qu’il traite l’État comme unité d’analyse indivisible, tout comme l’économie traite l’individu. Il y a quelque chose de contradictoire dans le fait de bannir l’État de l’économie mais dans le même temps de le consacrer comme ultime source d’autorité dans les relations internationales. Mais passons. Il y a un aspect pratique du problème plus impérieux. Que se produit-il lorsqu’un État se désintègre ? Les réalistes géopolitiques se trouvent alors totalement démunis. C’est ce qui est arrivé lorsque l’Union soviétique et la Yougoslavie se sont désintégrées. L’autre défaut de la géopolitique est qu’elle ne reconnaît pas l’intérêt commun derrière l’intérêt national.
Avec la disparition du communisme, la situation actuelle, même imparfaite, peut être décrite comme une société ouverte mondiale. Elle n’est pas menacée de l’extérieur, par quelques idéologies totalitaires à la recherche d’une suprématie mondiale. La menace vient d’un autre côté, de tyrans locaux qui cherchent à établir une domination interne via des conflits externes. Elle peut aussi venir d’États démocratiques mais souverains qui poursuivent leur propre intérêt au détriment de l’intérêt commun. La société ouverte internationale peut être son pire ennemi.
La guerre froide était un arrangement extrêmement stable. Deux blocs de pouvoir, représentant des concepts opposés de l’organisation sociale, se battaient pour la suprématie, mais ils devaient respecter les intérêts vitaux mutuels, car chaque côté était capable de détruire l’autre dans une guerre totale. Cela posait une limite solide à l’extension du conflit ; tous les conflits locaux étaient, dès lors, circonscrits par un plus large conflit. Cet ordre mondial extrêmement stable s’est terminé à la suite de la désintégration interne de l’une des superpuissances. Aucun nouvel ordre mondial n’a pris sa place. Nous sommes entrés dans une période de désordre.
L’idéologie du laissez-faire ne nous prépare pas à relever cet enjeu. Elle ne reconnaît pas le besoin d’un ordre mondial. Un ordre est supposé émerger de la poursuite par les États de leurs propres intérêts. Mais guidés par le principe de la survie du plus fort, les États sont de plus en plus préoccupés par leur compétitivité et réticents à faire tout sacrifice pour le bien commun.
Il n’y a pas besoin de faire d’effroyables prédictions sur l’éventuel effondrement de notre système commercial mondial afin de montrer que l’idéologie du laissez-faire est incompatible avec le concept de société ouverte. Il suffit de considérer l’incapacité du monde libre à tendre la main après l’effondrement du communisme. Le système du capitalisme brigand qui a pris le contrôle de la Russie est si inéquitable que les gens peuvent bien se tourner vers un chef charismatique qui leur promet un renouveau national au prix des libertés civiles.
S’il existe une leçon à tirer, elle est que l’effondrement d’un régime répressif ne conduit pas automatiquement à l’établissement d’une société ouverte. Une société ouverte n’est pas seulement l’absence d’intervention du gouvernement et de l’oppression. C’est une structure sophistiquée et compliquée, et un effort délibéré de la faire naître. Puisque plus sophistiquée que le système qu’elle remplace, une transition rapide nécessite une assistance extérieure. Mais la combinaison des idées de laissez-faire, le darwinisme social et le réalisme géopolitique qui prévalent aux États-Unis et au Royaume-Uni font obstacle à tout espoir de société ouverte en Russie. Si les dirigeants de ces pays avaient eu une vision différente du monde, ils auraient pu établir de solides fondations pour une société ouverte mondiale.
Au moment de l’effondrement soviétique il y avait une opportunité de modeler la fonction de l’ONU telle qu’elle avait été conçue à l’origine. Mikhaïl Gorbatchev a visité les Nations Unies en 1988 et a exposé sa vision des deux superpuissances coopérant pour apporter la paix et la sécurité au monde. Depuis lors l’opportunité a disparu. L’ONU a été complètement discréditée en tant qu’institution gardienne de la paix. La Bosnie fait à l’ONU ce que l’Abyssinie a fait à la Ligue des Nations en 1936.
Notre société ouverte mondiale manque d’institutions et de mécanismes nécessaires à sa préservation, mais il n’y a pas de volonté politique de les créer. Je blâme l’attitude prédominante, qui soutient que la libre poursuite de l’intérêt personnel apportera un éventuel équilibre international. Je pense cette confiance déplacée. Je pense que le concept de société ouverte, qui a besoin d’institutions pour le protéger, peut constituer un meilleur guide pour agir. En l’état actuel des choses, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour réaliser que la société ouverte mondiale qui prévaut actuellement est probablement le signe d’un phénomène temporaire.
LA PROMESSE DE FAILLIBILITE
Il est plus facile d’identifier les ennemis de la société ouverte que de lui donner un sens positif. Pourtant, dépourvue de sens positif, la société ouverte sera victime de ses ennemis. Il existe un intérêt commun dans la conservation de l’unité d’une communauté, mais la société ouverte n’est pas une communauté dans le sens traditionnel du terme. C’est une idée abstraite, un concept universel. Bien sûr, il existe une communauté globale ; il y a des intérêts communs au niveau global, comme la préservation de l’environnement ou la prévention de la guerre. Mais ces intérêts sont relativement faibles en comparaison des intérêts spéciaux. Ils n’ont pas beaucoup d’échos dans un monde d’États souverains. De plus, la société ouverte est un concept universel qui transcende toutes les frontières. Les sociétés assurent leur cohésion grâce à des valeurs partagées. Ces valeurs sont enracinées dans la culture, la religion, l’histoire et la tradition. Dans une société sans frontières, quelles sont les valeurs partagées ? Il me semble qu’il n’y a qu’une source possible : le concept de société ouverte lui-même.
Pour remplir ce rôle, le concept de société ouverte doit être redéfini. Plutôt que d’être une dichotomie entre ouverte et fermée, je vois la société ouverte occuper la place médiane, là où les droits individuels sont sauvegardés mais où des valeurs partagées permettent de tenir la société en un tout. Cette place médiane est menacée de toutes parts. D’un côté, les doctrines nationalistes ou communistes entraînent la domination étatique. Dans l’autre extrême, le capitalisme du laissez-faire amènera vers une plus grande instabilité et finalement un effondrement. Il existe d’autres variantes. Lee Kuan Yew, de Singapour, propose un “modèle asiatique” qui combine l’économie de marché et la répression d’État. Dans bien des endroits sur le globe, le contrôle de l’État est si étroitement associé à la création de richesse privée que l’on pourrait parler de capitalisme voleur ou d’État gangster, une autre menace pour la société ouverte.
J’envisage la société ouverte comme une société ouverte à l’amélioration. Nous commençons par reconnaître notre propre imperfection, qui s’étend non seulement à nos constructions mentales mais aussi à nos institutions. Ce qui est imparfait peut être amélioré, par un processus d’essais successifs. La société ouverte, non seulement permet ce processus, mais l’encourage même, en insistant sur la liberté d’expression et en protégeant l’opposition. La société ouverte offre une vision de progrès illimité. En cela, elle montre une ressemblance avec la méthode scientifique. Mais la science a à sa disposition des critères objectifs – à savoir les faits à l’aune desquels le processus peut être jugé. Malheureusement, dans les affaires humaines les faits ne fournissent pas un critère de jugement fiable, nous avons donc besoin de standards agréés par lesquels le processus d’essais successifs peut être jugé. Toutes les cultures et religions offrent de tels standards ; la société ouverte ne pourra pas s’en passer. L’innovation vient du fait que là où les cultures et les religions voient leurs valeurs comme absolues, une société ouverte, consciente des nombreuses cultures et religions, regarde ses propres valeurs comme un sujet de débat et d’opinion. Pour rendre le débat possible, il doit y avoir un consensus sur au moins un point : que la société ouverte est une forme d’organisation sociale désirable. Les individus doivent être libres de penser et d’agir, seulement limités par l’intérêt commun. Où se trouvent ces limites doit aussi être déterminé par essais successifs.
La déclaration d’indépendance peut être prise comme une assez bonne approximation des principes d’une société ouverte, mais plutôt que déclarer que ces principes coulent de source, nous devrions reconnaître qu’ils sont cohérents avec nos propres imperfections. La reconnaissance de notre imperfection peut-elle servir à l’établissement d’une société ouverte en tant que forme désirable d’organisation sociale ? Je pense que oui, même s’il existe de formidables obstacles. Nous devons conférer à la connaissance de notre imperfection le statut que nous réservons habituellement à la foi en une vérité ultime. Mais si la vérité ultime n’est pas accessible, comment pourrait-on accepter notre imperfection comme vérité ultime ?
C’est un paradoxe apparent, mais il peut être résolu. La première proposition, que nous sommes imparfaits, est compatible avec la seconde : que nous devons accepter cette proposition comme un article de foi. Le besoin d’articles de foi naît du fait même que nous sommes imparfaits. Si nous avions une compréhension parfaite, nous n’aurions nul besoin de foi. Mais pour accepter ce raisonnement, nous devons profondément changer le rôle que nous accordons aux croyances.
Historiquement, les croyances ont servi à justifier des comportements spécifiques. L’imperfection doit entraîner une attitude différente. La foi devrait servir à guider notre vie, pas à nous faire obéir à des règles données. Si nous acceptons que la foi est une expression de nos choix, et pas une vérité ultime, nous serons mieux à même d’accepter d’autres croyances et de réviser les nôtres à la lumière de notre expérience. Mais ce n’est pas ainsi que la plupart d’entre nous considèrent leurs croyances. Ils ont tendance à confondre leur foi avec une vérité ultime. En fait, cette confusion sert bien souvent à définir leur identité propre. Si une société ouverte les oblige à abandonner leur prétention à une vérité ultime, alors ils éprouvent un sentiment de perte.
Cette idée que nous possédons une vérité ultime est profondément inscrite dans nos modes de pensée. Nous pouvons avoir reçu d’extraordinaires qualités, mais nous sommes inséparablement liés à nous-mêmes. Nous pouvons avoir découvert la vérité et la moralité, mais par-dessus tout nous représentons nos intérêts et nous-mêmes. Si bien que s’il existe de telles choses que la vérité et la justice – et nous croyons qu’elles existent – nous voulons en avoir le contrôle. La foi en notre imperfection est un substitut de piètre qualité. C’est un concept hautement sophistiqué, bien plus difficile à manier que des concepts primitifs comme ma patrie (ou ma famille ou mon entreprise), vrai ou faux.
Si l’idée de notre imperfection est si difficile à accepter, qu’est-ce qui la rend attirante ? Le meilleur argument en sa faveur est constitué des résultats qu’elle obtient. Les sociétés ouvertes ont tendance à être plus prospères, plus innovantes, plus stimulantes, que les sociétés fermées. Mais il y a un danger à proposer le succès comme justification à une foi, car si ma théorie de la réflexivité est valide, avoir du succès n’est pas la même chose que d’avoir raison. En sciences naturelles, les théories doivent être justes (dans le sens où les explications et les prévisions qu’elles proposent doivent correspondre aux faits) pour qu’elles fonctionnent (dans le sens qu’elles produisent des explications et des prévisions utiles). Mais en sciences sociales, ce qui est efficace n’est pas forcément ce qui est juste, à cause du lien réflexif entre la pensée et la réalité. Comme je l’ai dit plus tôt, le culte du succès peut être une source d’instabilité, car il peut saper notre compréhension du bien et du mal. C’est ce qui se produit dans notre société de nos jours. Notre sens du bien et du mal est mis en danger par nos préoccupations de succès, mesuré par l’argent. Tout va, à partir du moment où vous ne vous faites pas prendre.
Si le succès était le seul critère, la société ouverte perdrait son combat contre les idéologies totalitaires – comme elle l’a perdu d’ailleurs en plusieurs occasions. Il est plus simple de défendre mon intérêt propre que de m’engager dans la pantalonnade du raisonnement abstrait qui conduit de la notion d’imperfection à celle de société ouverte.
Le concept de société ouverte a besoin d’être plus fondé sur des faits. Il doit y avoir un engagement en faveur de la société ouverte, car c’est la forme la plus adéquate de société. Mais un tel engagement est rare.
Je crois en la société ouverte car c’est celle qui nous permet le mieux de développer notre potentiel, par rapport à un système social qui prétend posséder une vérité ultime. Accepter le caractère inatteignable de la vérité est une meilleure base de départ pour atteindre la liberté et la prospérité, que de le nier. Mais je reconnais qu’il y a là un problème : je suis suffisamment épris de vérité pour reconnaître la société ouverte comme attrayante, mais je ne suis pas sûr que mes congénères vont partager mon point de vue. Etant donné la connexion réflexive entre réflexion et réalité, la vérité n’est pas indispensable au succès. Il peut être possible d’atteindre certains objectifs spécifiques en distordant ou en niant la vérité, et bien des personnes sont plus intéressées d’atteindre des objectifs spécifiques que d’atteindre la vérité.
Ce n’est qu’à un niveau très élevé d’abstraction, lorsque l’on considère le sens de la vie, que la vérité acquiert une importance primordiale. Et même là, la duperie peut être préférable à la vérité, car la vie entraîne la mort, et la mort n’est pas facilement acceptable. En fait, l’on pourrait dire que la société ouverte est la meilleure société pour tirer le meilleur parti de la vie, alors que la société fermée est la meilleure pour accepter la mort. En fin de compte, la foi, dans une société ouverte, est une question de choix, et pas de raisonnement logique.
Ce n’est pas tout. Même si le concept de société ouverte était universellement accepté, cela ne serait pas suffisant pour assurer la liberté et la prospérité. La société ouverte ne fournit qu’un canevas, dans lequel différents points de vue sociaux et politiques peuvent être réconciliés ; elle ne fournit pas une opinion tranchée sur les objectifs sociaux. Si elle le faisait, ce ne serait pas une société ouverte. Cela signifie que le peuple doit avoir d’autres croyances en plus de celle en une société ouverte. Il n’y a que dans une société fermée que le concept de société ouverte est suffisant pour permettre l’action politique ; dans une société ouverte il n’est pas suffisant d’être un démocrate, il faut être un démocrate libéral, ou un social-démocrate ou un démocrate-chrétien ou tout autre type de démocrate. Une conviction partagée de société ouverte est une condition nécessaire mais non suffisante pour la liberté et la prospérité et pour tous les bénéfices que nous promet la société ouverte.
On peut voir que le concept de société ouverte est vraisemblablement une source inexorable de difficultés. On pouvait s’y attendre. Après tout, la société ouverte est fondée sur la reconnaissance de notre faillibilité. En effet, il va de soi que notre idéal de société ouverte est inaccessible. Avoir un schéma directeur pour cela serait assez contradictoire. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas y aspirer. En science également, la vérité ultime est inaccessible. Cependant regardons le progrès que nous avons fait en la poursuivant. De même, la société ouverte peut être approximative à un degré plus ou moins grand.
Obtenir un agenda politique et social d’un argument épistémologique et philosophique semble une entreprise sans espoir ? Pourtant cela peut être fait. Il y a un précédent historique. Les Lumières furent une célébration du pouvoir de la raison, et elles fournirent l’inspiration de la Déclaration d’Indépendance et la Déclaration des Droits de l’Homme. La croyance en la raison a été portée à l’excès par la Révolution française, avec des effets secondaires désagréables ; c’était cependant le début de la modernité. Nous avons maintenant eu 200 ans d’expérience de l’Âge de Raison et comme les gens raisonnables, nous devons reconnaître que la raison a ses limites. Le temps est mûr pour développer un cadre conceptuel fondé sur notre faillibilité. Où la raison a échoué, la faillibilité peut encore réussir.
Illustrations par Brian Cronin.
Source : The Atlantic, le 02/1997
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source.