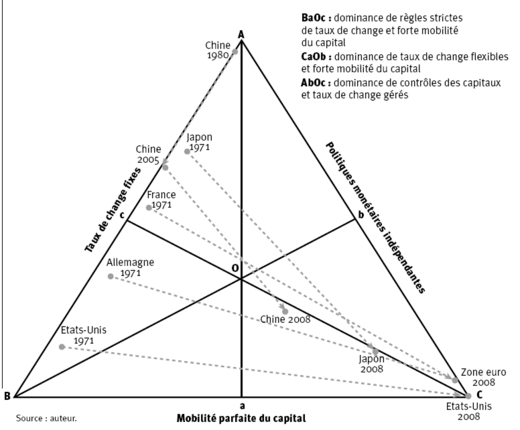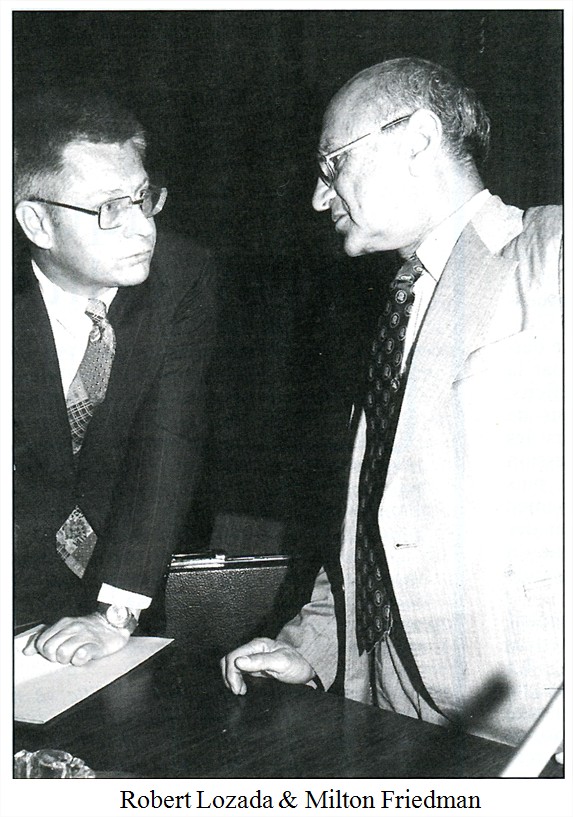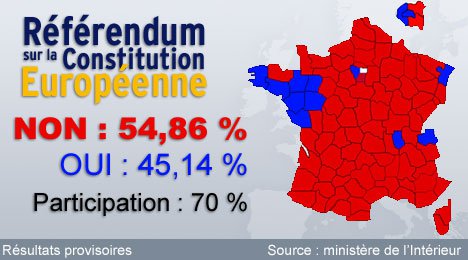Grèce : Angela Merkel a-t-elle cédé ?

Angela Merkel a-t-elle choisi la voie de la conciliation ?
Selon Bloomberg, l’Allemagne ne demanderait plus qu’une “seule réforme” pour convenir d’un accord avec Athènes. Le signe d’une défaite cuisante pour Wolfgang Schäuble ?
On a beaucoup glosé sur les tensions au sein du gouvernement grec et entre Syriza et le premier ministre hellénique Alexis Tsipras. On en a fait la clé des négociations entre la Grèce et ses créanciers. Sans doute trop. Car on a oublié que la véritable clé réside bien plutôt à Berlin, au sein même du gouvernement allemand et de la coalition d’Angela Merkel. Or, ces tensions apparaissent de plus en plus réelles. Le 26 mai déjà, le quotidien conservateur Die Welt révélait que la chancelière et son ministre des Finances étaient sur des positions divergentes concernant l’attitude à tenir face à une Grèce qui refuse de céder aux injonctions de ses créanciers. Ce mercredi 10 juin, c’est un député social-démocrate, vice-président du groupe SPD au Bundestag, Carsten Schneider, qui confirme à la radio Deutschlandfunk que « le groupe parlementaire conservateur est divisé et le gouvernement aussi » sur le sujet grec.
Les deux visions allemandes
Cette division est connue : Wolfgang Schäuble est, depuis fort longtemps, un partisan de l’exclusion de la Grèce de la zone euro, sauf à ce que ce pays se plie aux conditions de ses créanciers. Il voit à cette méthode plusieurs intérêts : un effet « d’exemple » d’abord pour les autres pays qui seraient tentés de « ne pas respecter les règles », une cohérence renforcée ensuite pour la zone euro puisqu’on aura imposé une unique politique économique possible et, enfin, une sécurité pour les contribuables allemands. Face à lui, Angela Merkel refuse de prendre le risque de fragiliser l’euro tant pour des raisons économiques que politiques. Or, plus le blocage actuel de la situation entre la Grèce et ses créanciers oblige le gouvernement allemand à faire un choix entre ces deux positions : ou accepter de faire des concessions à Athènes pour la conserver dans la zone euro ou exiger jusqu’au bout une capitulation grecque au risque du Grexit.
Pourquoi Angela Merkel fait encore monter les enchères
Berlin a déjà lâché un peu de lest en oubliant dans le dernier plan les demandes de réforme du marché du travail et en abaissant les objectifs d’excédents primaires. Mais au prix d’exigences très dures sur les retraites. En fait, dans le jeu auquel se livre Athènes et Berlin, chacun tente de montrer à l’autre qu’il est prêt à la rupture, pour le faire céder en premier. On tente donc d’obtenir de l’adversaire le plus de concessions possibles. Avec le report au 30 juin de l’échéance du FMI, on peut donc encore continuer ce petit jeu. Angela Merkel serait sans doute fort aise de pouvoir présenter à son opinion publique une défaite d’Alexis Tsipras sur le terrain des retraites. Mais si le premier ministre grec ne cède pas et si le défaut se rapproche, il lui faudra nécessairement faire le choix présenté plus haut.
Wolfgang Schäuble sur la touche ?
Or, pour Carsten Schneider, ce choix est déjà fait. « Wolfgang Schäuble peut bien donner des interviews, il ne participe plus réellement aux négociations », a-t-il affirmé dans une autre interview à la chaîne de télévision ZDF. « Angela Merkel lui a retiré son mandat de négociation », ajoute-t-il à la Deutschlandfunk, avant de comparer le sort de Wolfgang Schäuble à celui de Yanis Varoufakis, qui avait été mis en retrait des négociations en mai par Alexis Tsipras. Désormais, donc, Wolfgang Schäuble ne servirait plus que d’aiguillon, jetant volontiers de l’eau sur le feu, évoquant à l’envi dans la presse, le Grexit ou le « Graccident », mais il n’aurait plus aucune prise sur les discussions. Du reste, sa ligne a déjà été largement écornée par les concessions acceptées par les créanciers dans leur dernier plan. Carsten Schneider, qui n’a sans doute pas parlé sans l’accord des dirigeants sociaux-démocrates présents dans le gouvernement, pourrait donc bien avoir raison.
Menace de la SPD
Angela Merkel pourrait donc avoir fait le choix d’une solution de compromis avec Athènes. Le durcissement de ses derniers jours serait tactique. A la fois pour faire céder, si c’est encore possible, Alexis Tsipras et pour montrer aux députés conservateurs allemands sa détermination à le faire. Mais Carsten Schneider se dit certain que « le groupe parlementaire conservateur suivra sa chancelière. » Du reste, prévient-il, si ce n’est pas le cas « ce sera la fin de ce gouvernement. » par la bouche de Carsten Schneider, la SPD met donc directement en garde la chancelière sur une explosion de la « grande coalition » en cas d’échec des négociations avec la Grèce.
Or, si les sondages demeurent encore largement favorables à la chancelière, il n’est pas certain que cette dernière ait envie de se lancer dans une campagne électorale maintenant, alors même qu’elle est engluée dans l’affaire de la collaboration entre les services secrets allemands et étatsuniens qui lui coûte cher en popularité. De même, des élections anticipées sur fond de rumeurs de Grexit pourrait donner une nouvelle vie aux Eurosceptiques d’AfD actuellement en voie de dissolution en raison de leurs divergences internes. Bref, le moment est assez mal choisi, d’autant qu’un accord avec la Grèce bénéficiera sans doute d’une large majorité au Bundestag, les groupes du Parti de gauche Die Linke et des Verts votant sans doute en sa faveur…
« Où il y a une volonté, il y a un chemin »
Dans ce cadre, le refus sec du « plan grec modifié » par la Commission ce mardi 9 juin, ne doit pas être interprété comme le signe d’un blocage irrémédiable de la part des créanciers. C’est bien plutôt un moyen de faire monter la pression. Mais Angela Merkel a, ce mercredi en début d’après-midi, affirmer par une phrase sibylline que les négociations continuaient : « où il y a une volonté, il y a un chemin. » Comprenez : la négociation se poursuit. Au reste, le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis, a reconnu que les créanciers « sont prêts à étudier des alternatives aux coupes dans les retraites. » Or, ces coupes sont le principal obstacle qui empêche aujourd’hui un accord. Selon Bloombergqu cite deux personnes familières des discussions, l’Allemagne se contenterait désormais “d’une seule réforme“. S’il n’est pas sûr qu’un accord soit trouvé la semaine prochaine, comme l’affirme Carsten Schneider, ni même qu’un accord soit in fine trouvé, il semble que la ligne Merkel, celle qui refuse la rupture avec la Grèce et le risque d’un Grexit l’ait bien emporté sur celle de Wolfgang Schäuble. Ce serait incontestablement une victoire pour Alexis Tsipras qui serait le fruit de sa persévérance.
Source : Romaric Godin, pour La Tribune, le 10 juin 2015.
Grèce : le piège tendu par les créanciers

Alexis Tsipras refuse de céder à “l’irréalisme” du plan des créanciers. A raison ?
Un examen des conditions du plan des créanciers montre que ces derniers renouvellent les erreurs d’analyse du passé. Un aveuglement qui a une fonction tactique.
« Les propositions soumises par les Institutions sont clairement irréalistes. » Vendredi 5 juin à la tribune de la Vouli, le parlement grec, Alexis Tsipras, le premier ministre grec, (dont on peut lire ici le discours traduit en français) a clairement repoussé la proposition d’accord de cinq pages soumis par les créanciers de la Grèce à son gouvernement. « Jamais je n’aurais pu croire, surtout, que des responsables politiques, et non des technocrates, échoueraient à comprendre qu’au bout de cinq années d’austérité dévastatrice il ne se trouverait pas un seul député grec pour voter, dans cette enceinte, l’abrogation de l’allocation accordée aux retraités les plus modestes ou l’augmentation de 10 points de la TVA sur le courant électrique », a expliqué l’hôte de Maximou, le Matignon hellénique. Cette réaction a déclenché des cris d’orfraies dans le camp des créanciers qui n’ont pas goûté le rejet sec de ces cinq pages qu’ils avaient eu tant de mal à élaborer. Jean-Claude Juncker a montré sa mauvaise humeur en faisant une de ses habituelles leçons de morale.
Une consommation basse et juste stabilisée.
La colère des créanciers est-elle justifiée ? Les propositions des créanciers sont-elles réalistes et rationnelles ? Peuvent-elles concrètement donner une nouvelle chance à l’économie grecque de rebondir ? Pour y répondre, il faut d’abord rappeler la situation de l’économie grecque. Cette situation est peu lisible aujourd’hui en raison du blocage entre créanciers et gouvernement, mais il est certain que la Grèce doit faire face à un problème de demande et la consommation est son point faible. La consommation des ménages a été en 2014 inférieure à celle de 2005. Elle a reculé en prix constants de 17,5 % depuis 2008 et de 0,4 % par rapport à 2013. Il y avait donc une stabilisation à un niveau bas qui n’assurait guère de base pour une vraie reconstitution de l’économie grecque dont la consommation des ménages représente les deux-tiers du total.
Les propositions sur la TVA
Dans ce contexte, les créanciers proposent certes d’abaisser le taux intermédiaire de 13 % à 11 %, mais ils cherchent à relever le poids de la TVA en supprimant le taux réduit de 6 % et en élargissant, notamment à la restauration et à l’énergie les services et les biens frappés par le taux supérieur de 23 %. En tout, l’alourdissement s’élèvera à 1,8 milliard d’euros dès le 1er janvier. L’effet de cette mesure peut être sensible dans la mesure où l’énergie est une dépense incompressible des ménages et que son renchérissement se fera directement ressentir sur d’autres dépenses. On a vu a contrario que la baisse du prix de l’énergie dans de nombreuses économies européennes, comme l’Espagne ou l’Italie, a permis un rapide redressement de la consommation.
Cercle déflationniste
Certes, en cas d’accord, dans un premier temps, il existera une compensation dans la mesure où la consommation des ménages grecs sera sans doute gonflée par les dépenses qui ont été restreintes durant les « négociations » avec les créanciers : les ménages thésaurisent actuellement pour se prémunir contre un éventuel « Grexit. » Mais, à terme, l’effet de cette hausse de la TVA risque de se faire durement ressentir sur l’économie grecque. Ce serait en réalité le maintien d’une logique déflationniste. Les entreprises ne pourront faire face à cette nouvelle baisse de demande que par des baisses de prix. Or, la Grèce est encore en déflation profonde (les prix ont baissé de 1,8 % en mai sur un an). Ceci présage d’une nouvelle hausse du chômage pour compenser ces baisses de prix. D’où une nouvelle baisse de la demande des ménages à attendre…
Le tourisme en danger
Cette hausse sera d’autant plus sensible qu’elle touche aussi un des derniers points forts de l’économie grecque : le tourisme. Avec la crise, la Grèce est devenue plus dépendante du tourisme qui représente 18 % de son PIB contre 16 % en 2009. Or, les créanciers et les autorités grecques proposent de supprimer les exemptions dont bénéficiaient les services touristiques dans les îles égéennes. Les créanciers veulent également faire passer de 11 % à 23 % la TVA sur la restauration. C’est mettre en danger les avantages compétitifs de la Grèce sur le marché du tourisme méditerranéen. Là encore, la seule parade sera soit de développer l’économie informelle, soit (et les deux options ne sont pas exclusives) de licencier. A la clé, c’est risquer de voir ce secteur important rapporter moins à l’économie, mais aussi aux caisses de l’Etat. C’est pourquoi le gouvernement grec propose de ne lever l’exemption dans les îles qu’après le 1er octobre, afin de pouvoir épargner la saison touristique de cette année.
Des choix qui n’ont rien appris des erreurs de 2010-2012
Cette politique de hausse du poids de la TVA semble contre-productive. Les créanciers renouvellent ici clairement leurs erreurs de 2010 et 2012, alors même que le FMI avait reconnu ses erreurs. En pratiquant une taxation supplémentaire d’une demande affaiblie, on s’assure à coup sûr de recettes inférieures aux prévisions pour l’Etat. Accepter cette logique pour Athènes serait accepter la logique des trois gouvernements précédents : ce serait accepter d’avance de nouvelles coupes budgétaires pour « entrer dans les clous. »
La question des excédents primaires
Voici pourquoi le gouvernement refuse aussi des objectifs d’excédents primaires trop importants. L’affaiblissement économique du premier semestre rend nécessairement caduc l’objectif du mémorandum de 2012 (3,5 % du PIB cette année) qui, du reste, semblait devoir l’être avant même les élections du 25 janvier. L’excédent de 1 % du PIB, soit 1,8 milliard d’euros, proposé par les créanciers semble un objectif atteignable. De janvier à avril, l’excédent primaire grec s’élevait encore à 2,41 milliards d’euros. Mais il convient de prendre en compte dans ce chiffre les arriérés du gouvernement, autrement dit les factures non payées dans les 90 jours, qui sont passées entre décembre et avril 2015 de 157 à 478 millions d’euros. Il faut que le gouvernement puisse payer ses fournisseurs rapidement, ou bien, là encore ce serait un coup dur porté à l’économie. Tout dépendra donc de l’évolution des recettes pour savoir s’il faudra ou non pratiquer de nouvelles coupes franches. Or, en mai, les recettes fiscales ont été mal orientées. L’objectif grec de 0,6 % du PIB, soit 1,1 milliard d’euros, permet de se prémunir contre une mauvaise surprise dans les recettes. Mais surtout, il s’agit de pouvoir libérer quelques centaines de millions d’euros pour mener des politiques de soutien, notamment sociales. Ces excédents sont des garanties pour les créanciers mais ne sont d’aucune utilité pour l’économie grecque. Athènes tente de sauvegarder quelques moyens d’actions. Néanmoins, il peut y avoir sans doute sur ce sujet des bases de discussions possibles sur quelques points de PIB.
De forts excédents pendant des années
Le principal problème vient des objectifs pour les années suivantes. Les créanciers et le gouvernement s’accordent sur un objectif d’excédent primaire de 3,5 % du PIB en 2018 (contre 4,5 % dans le mémorandum), mais les créanciers veulent aller plus vite que les Grecs (2 % contre 1,5 % en 2016, 3 % contre 2,5 % en 2017). On notera cependant qu’Athènes accepte le principe d’une progression de l’excédent primaire. Ceci supposera ou une forte hausse des recettes par la croissance ou l’impôt, soit de nouvelles coupes. Il y a là une acceptation par le gouvernement grec d’une certaine austérité, même si elle est plus « douce » que celle proposée par le mémorandum de 2012 et par les créanciers. C’est une concession douloureuse de la part d’Alexis Tsipras qui accepte en quelque sorte le principe qu’une partie des richesses du gouvernement doit être réservée au remboursement de la dette. Il n’y a donc pas de « rupture » avec ce que l’économiste de la gauche de Syriza Costas Lapavitsas appelait le « péonage de la dette. »
Comment Alexis Tsipras veut compenser l’austérité qu’il a accepté
Mais, Alexis Tsipras espère contrer ces critiques par deux phénomènes. D’abord, cette concession s’accompagnerait d’investissements européens (les créanciers refusent tout plan de ce genre) et de l’intégration de la Grèce aux rachats de titres de la BCE, ce qui devrait favoriser la croissance, donc réduire le poids de l’effort du gouvernement. Ensuite, cet « effort » sera mieux réparti puisque le gouvernement entend modifier le barème du prélèvement de solidarité pour le faire porter sur les plus aisés. Les revenus de plus de 100.000 euros annuels verront ainsi cette contribution passer de 2,8 % à 6 %, ceux de plus de 500.000 euros de 2,8 % à 8 %. A noter cependant que le poids de cette contribution sera aussi fortement relevée pour les classes moyennes puisque le niveau de contribution sera relevée à partir de 30.000 euros de revenus mensuels (de 1,4 % à 2 %) et sera presque doublé pur ceux qui gagnent de 2,1 % à 4 %. L’effort sera donc mieux réparti, mais il touchera une grande partie des ménages et cela peut aussi avoir un effet négatif sur la consommation. Néanmoins, cette hausse de la contribution ne sera que de 220 millions d’euros en 2015, donc inférieur au milliard d’euros d’alourdissement de la TVA contenu dans le plan des créanciers.
Justice fiscale
Enfin, le gouvernement grec entend aussi faire contribuer les grandes entreprises par une taxe extraordinaire et par une taxe sur les publicités. En tout, ceci devrait rapporter 1,16 milliard d’euros. Sans compter sa volonté de lutter contre la fraude fiscale. Par ailleurs, le gouvernement maintient l’impôt sur la propriété Enfia, qui est un poids sur la consommation hellénique, sans objectif de recettes. Les créanciers exigent le maintien de la recette de 2014, ce qui signifie une hausse du taux puisqu’il y a une baisse de la valeur des biens. Rien de plus faux donc que les propos des créanciers qui jugent que la proposition grecque ne contient aucun « effort. » Alexis Tsipras a fait de grandes concessions à la logique de l’austérité exigée par ces créanciers. Il est sans doute allé aussi loin qu’il le pouvait et qu’il le voulait dans ce domaine. Un pas de plus et il accepterait rien d’autre que de prendre la place de ses prédécesseurs…
Le nœud gordien des retraites
Reste un dernier point : les retraites dont on a déjà vu qu’il constituait le nœud gordien de la mésentente avec les créanciers. Ces derniers ont eu la main lourde dans ce domaine, alors même qu’il savait que c’était là un point sensible pour le gouvernement grec. Ils réclament non seulement une baisse de 1 % des retraites, soit 1,8 milliard d’euros de revenus ôtés aux ménages, mais le report de l’âge légal de la retraite à 67 ans. En mars, le taux de chômage en Grèce était de 25,6 %, avec un taux de 19 % pour la tranche d’âge 55-64 ans. En cas de report de l’âge de la retraite à 67 ans, il y aura donc mécaniquement moins d’emplois libérés et cela portera sur les tranches d’âge inférieures où le chômage est plus élevé. Par ailleurs, s’il est plus faible que dans les autres tranches d’âge, le chômage des 55-64 ans a connu la plus forte hausse entre mars 2014 et mars 2015 : alors que le chômage des 15-34 ans reculait, celui des 55-64 ans progressait de 1,6 point. Bref, on fera travailler davantage des gens qui sont davantage au chômage en faisant peser un risque sur le reste des salariés. Le tout sans incitations pour l’emploi. Bien au contraire, comme on l’a vu avec la TVA.
Le rôle social des retraites
Parallèlement, les retraites ont un rôle social important dans la société grecque. Elles freinent clairement les effets sociaux de l’austérité en offrant des revenus notamment aux chômeurs de la famille. En Grèce, seuls 14,4 % des chômeurs sont indemnisés. Ce serait surtout, encore une fois, faire payer les plus fragiles puisque, quoique considérées comme « généreuses » par les créanciers, 45 % des retraités grecs touchent moins de 665 euros, soit le niveau du seuil de pauvreté défini par Eurostat. La pension moyenne grecque est d’ailleurs de 664,7 euros à laquelle il faut ajouter les retraites complémentaires, en moyenne de 168,40 euros. Les créanciers veulent, outre les baisses des pensions, supprimer progressivement ce système d’ici à fin 2016. Ces exigences des créanciers seraient donc très négatives sur la croissance grecque. Or, rappelons-le, tout est lié. Un affaiblissement de la croissance se traduirait, pour tenir les objectifs fixés, par de nouvelles coupes. Comme de 2010 à 2013. C’est précisément ce que les Grecs veulent éviter, car leur stratégie d’une austérité « acceptable » s’effondrerait alors. Ils retrouveraient la logique des gouvernements précédents.
Le piège des créanciers
Le plan des créanciers est donc clairement un plan « politique. » Il entend maintenir une stratégie qui a échoué pour pouvoir mettre à genoux politiquement le gouvernement grec effacer le vote grec contre l’austérité du 25 janvier. Aucune logique économique ne peut réellement soutenir un tel plan. Même la volonté de « prendre des garanties » pour le remboursement futur des dettes ne tient pas. L’affaiblissement de la croissance grecque ne peut en aucun cas constituer une quelconque garantie. Les deux restructurations de 2011 et 2012 le prouvent. De surcroît, on a vu qu’Alexis Tsipras acceptait des concessions qu’il a, lui-même, qualifié de « douloureuses » (on pourrait aussi évoquer l’acceptation d’une partie des privatisations). Les créanciers ont déjà obtenu beaucoup et Alexis Tsipras aura déjà bien du mal à redresser le pays avec ces concessions.
Apprentis sorciers
Mais le maximalisme des créanciers, leur volonté d’imposer les erreurs du passé, prouvent qu’ils ne visent pas un objectif financier ou économique. En réalité, ce plan des créanciers n’est qu’un piège. En l’acceptant, Alexis Tsipras retomberait dans l’erreur de ses prédécesseurs. Pris dans le cercle vicieux des objectifs et d’une croissance faible, voire négative, il devrait passer sous les fourches Caudines des coupes budgétaires. La politique « alternative » prônée par l’exécutif grec deviendrait impossible. Si le gouvernement de Syriza ne tombe donc pas immédiatement, il subira le sort de tous les gouvernements de gauche « gestionnaires de l’austérité » et le parti disparaîtra comme le Pasok, dont le maintien à la Vouli est désormais incertain. Resteront alors face à face les partis assumant la sortie de l’euro (Parti communiste et Aube Dorée) et les « amis » de l’Europe de Bruxelles de Nouvelle Démocratie. Le but est de prouver qu’il n’y a pas d’alternative aux politiques d’austérité budgétaire. Cette tactique de la « terre brûlée » fait des créanciers aujourd’hui des apprentis sorciers bien dangereux pour l’avenir de l’Europe.
Source : Romaric Godin, pour La Tribune, le 8 juin 2015.
Comment Tsipras coince l’Europe, financièrement

Les Grecs accumulent les réserves hors de leur pays, avec l’aide complice de la BCE: c’est elle qui finance, en fait, la fuite des capitaux hors de Grèce. Va-t-elle mettre fin à cette situation, dont joue le premier ministre grec, Alexis Tsipras? Par Hans-Werner Sinn, président de l’Ifo
Les spécialistes de la théorie des jeux savent pertinemment qu’un plan A n’est jamais suffisant. Il est toujours nécessaire d’élaborer et de pouvoir proposer un plan B crédible – qui, par sa menace, permet de faire avancer les négociations entourant le plan A. Il semble que le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, soit expert en la matière. En effet, consacré « poids lourd » du gouvernement grec, Varoufakis travaille actuellement à la confection d’un plan B (une éventuelle sortie de la zone euro), tandis que le Premier ministre Alexis Tsipras se tient disponible dans le cadre du plan A (extension de l’accord de prêt intéressant la Grèce, et renégociation des modalités de renflouement du pays). Ainsi se retrouvent-ils en quelque sorte à jouer les rôles du « good cop, bad cop » – jusqu’à présent avec une grande réussite.
Le plan B se compose de deux éléments clés. Il revêt tout abord une composante de provocation pure et simple, destinée à échauffer l’esprit des citoyens grecs, afin d’attiser les tensions entre le pays et ses créanciers. On tente de persuader les citoyens grecs qu’en maintenant leur confiance dans le gouvernement, ils pourraient échapper à de grave injustices au cours de la période difficile qui suivrait une sortie de la zone euro.
Le gouvernement grec laisse s’opérer la fuite des capitaux
Deuxièmement, le gouvernement grec provoque parallèlement une hausse des coûts qu’engendrerait le plan B, en laissant s’opérer une fuite de capitaux de la part des citoyens. Dans un tel scénario, le gouvernement pourrait s’efforcer de contenir cette tendance au moyen d’une approche plus conciliante, ou de l’endiguer immédiatement grâce à l’introduction de contrôles sur les capitaux. Néanmoins, une telle démarche viendrait affaiblir sa position de négociation, ce qui est pour lui hors de question.
Cette fuite des capitaux ne signifie pas leur expatriation en termes nets, mais plutôt que les capitaux privés se changent en capitaux publics. Grosso modo, les citoyens grecs contractent des emprunts auprès des banques locales, prêts largement financés par la Banque centrale grecque, qui elle-même acquiert des fonds via le dispositif ELA de fourniture de liquidités d’urgence de la Banque centrale européenne. Ils transfèrent ensuite leur argent vers d’autres pays afin d’acheter des actifs étrangers (ou de rembourser leurs dettes), aspirant ainsi la liquidité des banques de leur pays.
Les autres banques centrales contraintes d’imprimer de nouveaux billets…
Les autres banques centrales de la zone euro sont ainsi contraintes d’imprimer de nouveaux billets afin que soient honorés les ordres de paiement des citoyens grecs, conférant alors à la Banque centrale grecque un crédit par découvert, tel que mesuré par les fameuses dettes TARGET. Aux mois de janvier et février, les dettes TARGET de la Grèce ont augmenté de presque 1 milliard d’euros par jour, en raison d’une fuite des capitaux des citoyens grecs et des investisseurs étrangers. Fin avril, ces dettes atteignaient 99 milliards d’euros.
…et qui perdraient leurs créances en cas de sortie de la Grèce de la zone euro
Une sortie de la Grèce ne viendrait pas affecter les comptes dont ses citoyens disposent dans d’autres États de la zone euro – et encore moins faire perdre aux Grecs les actifs dont ils ont fait l’achat grâce à ces comptes. En revanche, une telle sortie aboutirait à ce que les banques centrales de ces États se retrouvent coincées avec les créances TARGET, libellées en euro, des citoyens grecs vis-à-vis de la Banque centrale de Grèce, qui pour sa part détiendrait des actifs libellés exclusivement dans une drachme fraichement rétablie. Étant donné l’inévitable dévaluation de cette nouvelle monnaie, et sachant que le gouvernement grec n’est pas tenu de parer à la dette se sa banque centrale, il est quasiment certain qu’un défaut viendrait priver les autres banques centrales de leurs créances.
Tsipras renforce ainsi sa position de négociation
Une situation similaire survient lorsque les citoyens grecs retirent des espèces sur leurs comptes pour ensuite les stocker dans des valises ou les emporter à l’étranger. Si la Grèce venait à abandonner l’euro, une part substantielle de ces fonds – dont le total atteignait 43 milliards d’euros à la fin du mois d’avril – se déverserait alors dans le reste de la zone euro, que ce soit vers l’achat de biens et actifs ou vers le remboursement de dettes, ce qui entraînerait une perte nette pour les membres demeurant dans l’union monétaire.
Tout ceci vient considérablement renforcer la position de négociation du gouvernement grec. Il n’est donc pas étonnant que Varoufakis et Tsipras jouent la montre, en refusant de présenter un ensemble de propositions de réformes significatives.
La responsabilité de la BCE
La BCE partage une importante responsabilité dans cette situation. En échouant a rassembler au Conseil de la BCE les deux tiers de majorité nécessaires pour limiter la stratégie de self-service de la Banque centrale grecque, elle a permis la création de plus de 80 milliards d’euros de liquidités d’urgence, qui excèdent les quelque 41 milliards d’euros d’actifs recouvrables dont dispose la Banque centrale grecque. Les banques de Grèce étant ainsi certaines de bénéficier des fonds nécessaires, le gouvernement n’a pas eu à mettre en place de contrôles sur les capitaux.
La rumeur voudrait que la BCE s’apprête à réajuster son approche – et cela très prochainement. L’institution est consciente que l’argument selon lequel les prêts ELA sont garantis s’érode peu à peu, puisque dans bien des cas cette garantie présente une notation inferieure à BBB-, en dessous de la catégorie investissement.
Si la BCE décidait enfin d’admettre l’impasse, et de retirer le filet de sécurité qui sous-tend la liquidité de la Grèce, le gouvernement grec serait alors contraint de commencer à négocier sérieusement, puisqu’il n’aurait aucun intérêt à attendre plus longtemps. Pour autant, le stock d’argent envoyé à l’étranger et détenu en liquidités ayant d’ores et déjà explosé jusqu’à 79 % du PIB, sa position demeurerait solide.
Autrement dit, en grande partie grâce à la BCE, le gouvernement grec serait en mesure d’obtenir une issue plus favorable – notamment accroissement de l’aide financière et réduction des exigences de réforme – que jamais auparavant. Une large part des ressources acquises, mesurées selon les soldes TARGET, ainsi que des liquidités imprimées, se changerait ainsi en un véritable cadeau de dotations vers un avenir d’indépendance.
Beaucoup en Europe semblent considérer Varoufakis, spécialiste de la théorie des jeux mais en même temps néophyte sur le plan politique, comme incapable d’exploiter les cartes que joue la Grèce. Ceux-là feraient bien d’y réfléchir davantage – avant que la Grèce ne s’en aille avec la mise.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Hans-Werner Sinn, professeur d’économie et de finances publiques à l’Université de Munich, est président de l’Ifo Institute for Economic Research, et membre du Conseil consultatif du ministre allemand de l’économie. Il est l’auteur d’un récent ouvrage intitulé The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs.
Source : Hans-Werner Sinn, pour La Tribune, le 5 juin 2015.
Grèce : les coupes dans les retraites jugées inconstitutionnelles

800.000 retraités grecs vont connaître une revalorisation de leurs pensions.
Le Conseil d’Etat grec a cassé les coupes dans les pensions décidées fin 2012 sous la pression de la troïka. Les pensions seront revalorisées. Quelles conséquences pour les négociations ?
C’est une excellente nouvelle pour les retraités grecs, mais c’est aussi un nouveau casse-tête pour le premier ministre hellénique Alexis Tsipras dans les négociations avec les créanciers. Mercredi 10 juin, le conseil d’Etat grec a annulé pour inconstitutionnalité les coupes dans les retraites et dans les retraites complémentaires décidées fin 2012 par le gouvernement d’Antonis Samaras. La plus haute juridiction administrative grecque a considéré qu’aucune étude sérieuse n’avait été menée concernant l’impact de ces coupes. Le Conseil d’Etat n’oblige pas l’Etat à rembourser les retraités qui ont subi ces coupes dans leurs revenus, mais il faudra rétablir le niveau d’avant 2012. Ces coupes concernaient les retraités touchant plus de 1.000 euros de retraites mensuelles, soit 800.000 personnes. La revalorisation va de 5 % à 15 % et coûtera entre 1 milliard d’euros et 1,5 milliard d’euros à l’Etat, soit une facture s’élevant de 0,5 % à 0,8 % du PIB.
La fin de la discussion sur les retraites ?
Cette décision ne va certainement pas manqué d’avoir une certaine influence sur les négociations où la question des retraites est centrale. Alexis Tsipras refusait jusqu’ici avec fermeté l’exigence des créanciers de couper davantage dans le niveau des pensions. Dans leur dernier plan, les Européens et le FMI demandaient des coupes de 1,8 milliard d’euros. La décision du Conseil d’Etat vient d’une certaine façon conforter la position grecque : il sera difficile de reprendre et d’aggraver des mesures déjà jugées inconstitutionnelles.
Du coup, il y a fort à parier (mais ce n’est pas sûr) que le nœud de la discussion se décale vers la question des excédents budgétaires primaires (hors service de la dette). Avec cette charge supplémentaire pour l’Etat, les objectifs budgétaires de l’Etat vont devenir plus difficiles à atteindre. Le plan des créanciers prévoyait un excédent primaire de 1 % du PIB en 2015, 2 % en 2016. Le plan grec « modifié », rejeté sèchement mardi 9 juin par Bruxelles, proposait 0,75 % du PIB. Mercredi, des rumeurs affirmaient que le gouvernement grec était prêt à s’aligner sur les exigences des créanciers, ce qui aurait constitué un effort supplémentaire d’un demi-milliard d’euros. Désormais, il faut ajouter le poids de cette revalorisation des pensions à la facture.
Comment financer ces nouvelles dépenses ?
Comment vont réagir les créanciers ? Réclameront-ils de nouvelles « garanties » sur le détail du financement de ces excédents, notamment de nouvelles coupes budgétaires ou de nouvelles recettes par l’organisation de davantage de privatisations ? Dans ce cas, les négociations pourraient à nouveau se bloquer après la tentative d’avancée dans la soirée du mercredi 10 juin où Alexis Tsipras a de nouveau rencontré Angela Merkel, François Hollande et Jean-Claude Juncker. A moins qu’il n’y ait eu une vraie avancée dans la nature des discussions. Le gouvernement grec a, après ces contacts, indiqué qu’il cherchait à mettre en place une solution qui « permette de faire repartir la croissance et pas seulement de couvrir les remboursements des créanciers. »
Casse-tête en termes de justice sociale
Reste cependant une question que soulève le blog grec Keep Talking Greece : cette revalorisation des pensions moyennes et élevées ne va-t-elle pas se faire au détriment des petites pensions de moins de 1000 euros qui ne sont pas concernées par cette mesure et que Syriza avait promis de revaloriser en décembre prochain ? Ce serait un coup de canif dans le programme du gouvernement et cela ne manquera pas de poser des problèmes de justice sociale. C’est là, à coup sûr, un casse-tête pour Alexis Tsipras.
Croissance ou nouvelles coupes budgétaires ?
Mais la clé du problème est bien la suivante : seule le retour de la croissance peut permettre au gouvernement grec de remplir ses objectifs budgétaires et de rembourser ainsi ses créanciers dans la durée. En théorie, ce serait donc également dans l’intérêt des créanciers de favoriser cette croissance et, pour cela, de mettre fin le plus rapidement possible au blocage actuel qui, en organisant et maintenant l’incertitude, fait plonger l’économie grecque vers les abymes. Dans ce cadre, la décision du conseil d’Etat peut être une chance en redonnant un coup de fouet à la consommation des ménages. A condition toutefois que les incertitudes soient levées, donc qu’un accord permettant une certaine visibilité soit obtenu. Dans ce cas, une partie des versements sur les pensions reviendront à l’Etat sous forme de TVA et d’impôts divers. C’est une logique encore étrangère aux créanciers. S’ils ne finissent par l’admettre, les maux de la Grèce sont loin d’être terminés.
Caractère sauvage de l’austérité des années 2010-2013
Mais la décision du Conseil d’Etat grec rappelle aussi une vérité trop souvent oubliée : le caractère « sauvage » qu’a pris l’austérité dans les années 2010-2013. Les créanciers ont exigé des mesures souvent inconstitutionnelles ou illégales sans s’en soucier. La cour constitutionnelle portugaise avait déjà dû casser par deux fois des mesures adoptées sous la pression de la troïka. Ces décisions hâtives, conduites par la seule logique du retour rapide à l’équilibre budgétaire, se sont révélé en réalité des pièges à long terme. Elles montrent aussi l’existence déjà d’une « zone euro à deux vitesses » que redoutaient Alexis Tsipras dans son texte publié dans le Monde le 1er juin dernier. Compte tenu de la sensibilité, par exemple, de l’Allemagne, au respect de ses règles constitutionnelles, on peut constater que ce type de mesures n’est possible que dans les pays « périphériques. » Si le gouvernement grec entend réellement ne plus accepter cet état de fait, la décision du Conseil d’Etat peut être plus qu’un casse-tête budgétaire. Ce peut être une chance de prouver qu’une décision juridique grecque a autant de valeur d’une décision de la Cour de Karlsruhe dans la zone euro. Et qu’il convient donc d’apprendre des erreurs du passé.
Source : Romaric Godin, pour La Tribune, le 11 juin 2015.
Grèce : le FMI quitte la table des négociations

Le FMI a rompu les négociations avec la Grèce
Le FMI a annoncé que ses équipes avaient quitté Bruxelles. L’institution de Washington exige que la Grèce accepte les réformes exigées par ces créanciers.
Les négociations entre la Grèce et ses créditeurs sont à nouveau stoppées. Jeudi 11 juin vers 16h, le FMI a annoncé qu’il avait quitté la table des discussions. Les équipes de l’institution internationale ont quitté Bruxelles et sont retournées à Washington. Un signe de mauvaise humeur qui, selon le FMI, s’explique par le refus du gouvernement grec d’accepter le régime que demandent les créditeurs : coupes dans les retraites, réformes du marché du travail et objectif ambitieux d’excédents budgétaires primaires (hors services de la dette). « Il existe des différences majeures entre nous sur la plupart des sujets clé. Il n’y a eu aucun progrès pour réduire ces différences récemment », a souligné a indiqué Gerry Rice, le porte-parole du FMI. « La balle est à présent vraiment dans le camp de la Grèce », a-t-il conclu.
Ce durcissement du FMI vient stopper net les espoirs qui étaient nés dans la soirée du mercredi 10 juin. Alors que des informations de Bloomberg laissaient entendre que l’Allemagne était prête à accepter « une seule réforme », des contacts, rompus depuis près d’une semaine, avaient été repris. Alexis Tsipras avait rencontré Angela Merkel et François Hollande dans la nuit, et, par deux fois, Jean-Claude Juncker. Ces rencontres n’ont cependant rien donné. Selon Reuters, citant un « officiel européen », la rencontre de jeudi entre les deux hommes était « la dernière tentative » de parvenir à un accord. Ce dernier détail viendrait alors confirmer que le FMI n’est pas seul en cause dans la rupture des négociations. Les créanciers européens ont également rompu les ponts. Les marchés européens ont fortement réagi à cette nouvelle. Le DAX-30 de Francfort a perdu brutalement près d’un point de pourcentage de gains.
Négociations fermées ?
Tout espoir serait donc perdu ? Rien n’est sûr évidemment. Depuis plus de quatre mois, les négociations ont cessé, puis reprises. Mais, évidemment, plus on se rapproche de la fin du mois de juin et plus la situation devient critique. Sans accord, la Grèce devrait inévitablement ne pas payer les 1,6 milliard d’euros qu’elle doit rembourser au FMI avant la fin du mois. On entrera alors dans une autre phase de la crise, où la présence de la Grèce dans la zone euro ne tiendra plus qu’à un fil. Le FMI est-il prêt à prendre le risque de devoir faire face à un défaut grec ? Les Européens oseront-ils soutenir la Grèce sans l’institution de Washington ? Pour le moment, le mouvement du FMI est un énième moyen de faire pression sur Athènes pour lui faire accepter ce qui reste inacceptable pour le gouvernement grec.
Il n’est cependant pas à exclure que les discussions se poursuivent malgré tout. Comme l’a précisé Gerry Rice, « le FMI ne quitte jamais la table. » Et Christine Lagarde est attendue pour la réunion de l’Eurogroupe les 18 et 19 juin prochains. Les sujets qui empêchent toujours l’accord restent les mêmes : les retraites et les excédents primaires. A la mi-journée, jeudi, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, avait indiqué qu’il n’y avait pas d’accord sur l’objectif de 1 % du PIB pour l’excédent primaire de 2015. Cet objectif est lié pour les Grecs a un accord plus global, intégrant un prolongement du programme d’aide et un échange de dettes entre la BCE et le MES. Quant aux retraites, l’équation est rendu encore plus délicate par la décision du conseil d’Etat de rétablir certaines retraites à leur niveau de 2012.
Reste à savoir quelles seront les réactions à ce nouveau coup de théâtre côté grec. Il semble que le gouvernement hellénique soit allé jusqu’au bout de sa capacité de compromis. En allant plus loin, Alexis Tsipras mettrait en danger la cohérence de sa majorité et sa survie politique. Si les créanciers demeurent sur leur position consistant à réclamer une capitulation, les négociations ne reprendront plus.
Source : Romaric Godin, pour La Tribune, le 11 juin 2015.